L’inquiétante Amérique enchantée d’Eric Oliver et Thomas J. Wood edit
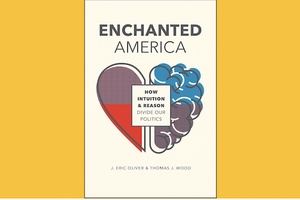
Enchanted America est sorti en 2018 aux presses de l’université de Chicago. Sous-titré How Intuition and Reason Divide Our Politics, il dresse le portrait d’un pays qui s’abîme dans l’irrationnel. Avec une question clé : l’agrégat des antivax, des conspirationnistes, et de ceux qui croient plus à la Bible qu’à la raison a fini par acquérir un poids politique. Mais a-t-il une consistance sociale ?
Les réflexions d’Eric Oliver et Thomas J. Wood, qui sont politologues, font écho, de ce côté de l’Atlantique, aux interrogations du sociologue Gérald Bronner sur le retour en force de l’irrationnel dans les sociétés contemporaines[1]. Néanmoins leurs grilles d’analyse divergent, en partie, mais pas seulement, parce que les sociétés qu’ils étudient ne sont pas les mêmes.
Gérald Bronner soutient que le retour de l’irrationnel résulte d’un déséquilibre cognitif né de la surcharge informationnelle propre à l’ère numérique : les croyances infondées prolifèrent plus vite que la pensée critique. Il montre que les marchés de l’attention, qui se sont épanouis sur les grandes plateformes numériques mais aussi dans les médias dits traditionnels, favorisent les récits émotionnels, complotistes ou magiques.
Eric Oliver et Thomas J. Wood partent de la même interrogation : comment expliquer la montée des croyances irrationnelles — conspirationnisme, rejet de la science, méfiance envers les experts ? Dans le contexte américain, toutefois, ils s’inquiètent davantage des effets politiques de ce phénomène, avec une polarisation sociale qui prend l’apparence d’une guerre culturelle structurant désormais l’ensemble du champ politique.
L’intérêt de leur travail est, pour appréhender cette « guerre culturelle », de se dégager de la grille d’analyse centrée sur les nouvelles radicalités politiques, disons pour simplifier la gauche « woke » et la droite réactionnaire dont le trumpisme est une des versions. Ils montrent que nombre de phénomènes de polarisation politique s’expliquent plus profondément par une divergence épistémologique entre deux modes cognitifs : l’intuition et la raison.
Les auteurs proposent ainsi de repenser la fracture politique américaine non pas seulement en termes d’idéologies (libéraux vs conservateurs), mais comme une scission entre deux manières de concevoir le monde. Les rationalistes valorisent la raison, les preuves empiriques, la science. Les intuitionnistes s’appuient sur le « gut feeling », sur l’usage de règles mentales simplificatrices (« heuristic » : un raccourci cognitif que les individus utilisent pour juger ou décider sans analyse approfondie), et plus largement les croyances « magiques » ou métaphysiques. Les « intuitionnistes » forment aujourd’hui, selon les auteurs, une catégorie sociale consistante qui, sans être pour autant unifiée ni même consciente de son existence, pèse de tout son poids dans l’Amérique contemporaine.
La force explicative de ce modèle développé pendant le premier mandat de Donald Trump apparaît avec netteté aujourd’hui, notamment dans le domaine de la santé ou du rapport à la science : l’administration investie en 2025 est finalement beaucoup plus au diapason avec les sensibilités des électeurs trumpistes que ne l’était celle de 2017. Et la raison n’en est pas seulement, comme on le lit régulièrement, le choix du président de s’entourer de fidèles, en privilégiant la loyauté sur la compétence : l’enjeu est aussi de coller davantage aux attentes et aux croyances d’un électorat dont l’une des bases les plus larges correspond précisément à cette « enchanted America » qui réaffirme, comme jamais, la légitimité de ses croyances : « You believe in reason, I believe in the Bible. »
Le livre n’est pas qu’un diagnostic. C’est aussi un appel aux rationalistes pour qu’ils trouvent des manières plus efficaces de dialoguer avec les intuitionnistes — faute de quoi, écrivent les auteurs en 2018, la démocratie elle-même est en jeu. La suite des événements leur donne raison (on n’ose dire qu’elle confirme leur intuition !). Mais elle montre aussi que leur appel n’a pas été entendu ; et à cet égard, même dans une société beaucoup plus sécularisée comme la nôtre, les questions qu’ils posent méritent d’être débattues. Savons-nous vraiment dialoguer avec nos antivax ? Le voulons-nous ? Et avons-nous bien conscience du progrès continu des croyances et parasciences, y compris chez les diplômés du supérieur[2] ?
Mais revenons au livre, et à cette « enchanted America » qui reste un objet déconcertant. Au-delà de la formule à l’emporte-pièce, comment qualifier les phénomènes étudiés ? Pour outiller leur recherche, Eric Oliver et Thomas J. Wood ont construit une matrice originale, une « échelle d’intuitionnisme » (Intuitionism Scale) qui permet de mesurer la propension à l’intuition (le terme d’intuitionnisme, chez eux, renvoie à des comportements et non à une doctrine philosophique). Trois dimensions y sont incorporées : le trait d’appréhension (apprehension trait ou apprehensive temperament, par exemple vérifier plusieurs fois si les portes sont bien fermées à clé), l’anxiété et le pessimisme quant à l’avenir, et les prédispositions à la pensée magique : scénarios symboliques peu rationnels (préférer subir une activité dangereuse plutôt qu’une « malédiction symbolique »), choix faisant appel à des croyances invisibles.
Cette mesure est ensuite corrélée avec diverses croyances (paranormal, théorie du complot) et positions socio-politiques (orientation partisane, degré de conservatisme, de religiosité). Les auteurs montrent ainsi que l’intuitionnisme « prédit », au sens des sciences sociales, certaines croyances irrationnelles ou conspirationnistes, bien davantage que les variables socio-démographiques classiques comme l’âge, le diplôme, la position sociale ou le niveau de revenu.
Eric Oliver et Thomas J. Wood analysent ensuite la distribution des intuitionnistes dans la population. Ils observent un chevauchement entre cette catégorie et l’idéologie conservatrice, et mettent en évidence son impact politique (et notamment son rôle dans l’élection de Donald Trump en 2016). Ils montrent que l’intuitionnisme est désormais fortement lié à la droite politique : les intuitionnistes sont plus susceptibles d’adhérer à des valeurs autoritaires, nationalistes et complotistes. En ce sens, les auteurs considèrent que la fracture intuitionnistes/rationalistes devient une dimension structurante de la politique américaine contemporaine.
Ce qui distingue Enchanted America de travaux de science politique plus classiques est son approche psychologique et cognitive. Au lieu de se limiter aux variables structurelles (éducation, revenus, position sociale...), Eric Oliver et Thomas J. Wood explorent les mécanismes mentaux sous-jacents qui façonnent la manière dont les individus croient et raisonnent. Cette approche contribue à enraciner la politologie dans les sciences cognitives, une voie prometteuse.
Leur « échelle d’intuitionnisme » est évidemment perfectible, mais elle a l’avantage d’offrir un instrument quantitatif pour mesurer ce que beaucoup d’analystes perçoivent mais ne savent pas comment formaliser rigoureusement : la disposition aux croyances irrationnelles, envisagée comme un fait social. Le fait que cette échelle coïncide avec des convictions politiques et des croyances extrêmes renforce la crédibilité du cadre théorique.
Le livre donne ainsi des clés pour comprendre l’ère étrange de la « post-vérité » dont Trump est l’incarnation et, au-delà, du conspirationnisme viral ou de la vulnérabilité face à la désinformation. Les raccourcis cognitifs qui s’imposent ainsi dans le débat public contribuent à expliquer l’essor des populismes, qui ont en commun de présenter des solutions « magiques », au regard des connaissances disponibles (le lecteur trouvera facilement des exemples français contemporains !). En expliquant que le problème ne se réduit pas à de l’ignorance ou du sectarisme, mais touche bien plus profondément à la manière dont pensent les gens, Eric Oliver et Thomas J. Wood offrent un prisme neuf pour comprendre les dynamiques politiques actuelles. La bataille qui anime le champ politique contemporain n’est pas seulement idéologique : elle est épistémique.
Bien sûr, il ne faudrait pas imaginer une stricte division sociale, et c’est peut-être l’une des faiblesses du livre, qui cède parfois à cette tentation. Au fond, chacun de nous vit et pense dans la tension entre ces deux pôles : la pensée magique est comme l’argent magique, on en trouve dans tous les camps politiques, toutes les sphères sociales, et tous les médias même les plus sérieux !
Par ailleurs, mais c’est ici un problème irrésolu de nombreux travaux de sciences sociales, la relation établie dans Enchanted America entre intuitionnisme et orientations politiques est principalement corrélationnelle. Il est difficile, et les auteurs le reconnaissent, de trancher dans quel sens va la causalité : est-ce que l’adhésion à des doctrines politiques stimule une posture intuitionniste, ou est-ce que l’intuitionnisme préexistant favorise certaines convictions politiques ? On regrette à cet égard que les auteurs n’aient pas eu connaissance des travaux de Yann Algan, Elizabeth Beasley, Daniel Cohen et Martial Foucault qui seraient publiés l’année suivante[3], et qui pointent dans les ressorts du populisme une confiance brisée (envers les institutions chez tous les électeurs des partis populistes, envers les autres chez les électeurs d’extrême droite). Il y a là un déterminant psychologique, sinon cognitif, qui s’articule bien aux catégories d’Eric Oliver et Thomas J. Wood et pourrait enrichir et affermir leur modèle.
Reste qu’Enchanted America est une contribution importante à la réflexion politique contemporaine : ce livre déplace le débat de la simple opposition droite/gauche vers une tension plus profonde sur la façon de penser le monde. En conceptualisant l’intuition comme un opérateur politique, Eric Oliver et Thomas J. Wood mettent au jour des dynamiques invisibles, mais puissantes.
Eric Oliver et Thomas J. Wood, Enchanted America: How Intuition and Reason Divide Our Politics, The University of Chicago Press, 2018.
Did you enjoy this article? close




[1] Voir notamment La Démocratie des crédules, PUF, 2012, mais aussi, avec Jean Baeschler, L’Irrationnel aujourd'hui, Hermann, 2021.
[2] Sur ce point, voir par exemple IFOP, Les Français et les parasciences, rapport d’étude pour Femme actuelle, novembre 2020. Cette étude montre une hausse continue des croyances ésotériques depuis les années 1980-2000 (ex. l’astrologie passe à 41% en 2020, +8 points par rapport à 2000). Elle précise que ces croyances touchent aussi les diplômés du supérieur : 44% des hommes et 62% des femmes ayant un diplôme supérieur au Bac disent croire à au moins une parascience.
[3] Yann Algan, Elizabeth Beasley, Daniel Cohen et Martial Foucault, Les Origines du populisme Enquête sur un schisme politique et social, Seuil, coll. « La République des idées », 2019.


