Une autre histoire de la Russie edit
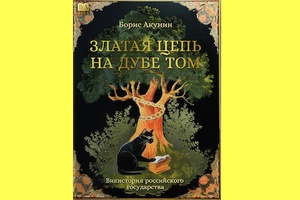
Ce texte est issu d’une allocution prononcée en Sorbonne le 25 août 2025 à la séance d'ouverture du XVIIe Congrès International des slavistes qui avait lieu pour la première fois hors d’un pays slave.
Dans ces temps troublés que nous traversons, j’évoquerai à la fois l’histoire et mes inquiétudes. Je vous raconterai comment et pourquoi, auteur de romans policiers légers, j’en suis venu à écrire des études historiques sérieuses. Je pense que mon parcours d’écrivain m’offre un point de vue adéquat pour étudier les processus en cours dans la littérature russe. En particulier, sa transition, ou pour être plus exact, son retour, d’une période d’insouciance passagère à celle d’une gravité sans fin.
La fin de l’Histoire ?
En fait, le fabuliste Krylov en a déjà raconté l’intrigue : « La sauterelle a chanté l’été rouge, elle n’a pas eu le temps de se retourner que déjà l’hiver la fixe dans les yeux »[1]. L’« été rouge » et l’« hiver » sont ici des époques historiques. J’ai fait mes premiers pas en public en tant que Boris Akounine, romancier, à une époque où tout le monde croyait avec Francis Fukuyama que l’histoire était terminée et que tout irait désormais pour le mieux. Il était si doux de sentir la fin de l’histoire en Russie où il faut vivre longtemps, affirmait Korneï Tchoukovski, en pensant qu’on pourra finalement vivre des jours meilleurs[2]. Korneï Ivanovitch a vécu 87 ans, pas assez pour connaître leur avènement, il est mort à l’époque d’un nouveau refroidissement politique, et ma génération a dû attendre la fin des années 1990, pensais-je. Et c’est avec un immense plaisir que j’ai commencé à écrire une littérature de divertissement pour une classe moyenne naissante. Non seulement je croyais aux thèses de Fukuyama, mais j’adhérais fermement à celles d’Abraham Maslow[3], à l’idée que la Russie avait commencé à gravir sa pyramide et qu’avec le temps tout s’arrangerait.
Dans les années 2000, lorsque le gel est revenu, j’ai dit et écrit à maintes reprises que ces douleurs fantômes allaient passer. L’évolution historique a ses lois, qui s’appliqueraient également à la Russie. Lorsque la proportion de la classe moyenne aura atteint un seuil déterminé, la démocratie l’emporterait sur l’Empire. En 2011-2013, quand le mouvement pour des élections fiables démarra en Russie, j’étais convaincu que nous avions déjà atteint le quatrième étage de la pyramide, c’est-à-dire le moment où la société commence à exiger le respect. J’ai moi-même participé activement à ce mouvement, rayonnant d’optimisme lors de ces rencontres, confiant dans la victoire du progrès sur l’archaïsme. C’est alors que « l’été rouge » s’est achevé et que l’ hiver est arrivé. Les événements de 2014 furent pour moi un grand choc. Non pas tant l’occupation de la Crimée et l’attaque contre l’Ukraine que le soutien populaire massif à cette agression, avec une montée en flèche de la popularité de Poutine. On peut lutter contre un dictateur, mais lutter contre 87% de ses compatriotes qui soutiennent le dictateur devient une entreprise insensée. Et j’ai quitté la Russie. Je ne dirai pas que les événements de 2014 ont été pour moi un coup de tonnerre dans un ciel serein. Dès 2012, lorsque la vague démocratique est retombée, j’ai commencé à soupçonner que la Russie n’érigeait pas la pyramide de Maslow mais une autre construction, que son évolution historique obéissait à d’autres lois que je ne comprenais pas. J’ai une formation d’historien, toute ma vie je me suis intéressé à l’histoire, j’ai lu des livres d’histoire, mais il s’avère que je ne comprends pas mon pays. Et que toutes les interprétations existantes de son histoire ne me satisfont pas, n’expliquent pas l’essentiel. J’ai besoin de comprendre.
Historien malgré moi
Quand un écrivain ne comprend pas, mais qu’il veut absolument comprendre, il commence à écrire des livres sur le sujet. Et j’ai commencé à écrire une histoire de l’État russe en plusieurs volumes. On peut me qualifier « d’historien malgré moi ». Ce travail s’est étendu sur douze années, donnant lieu à dix volumineux tomes (Des origines à l’invasion mongole, La Période de la Horde d(‘or, D’Ivan à Boris Godounov, Le XVIIe siècle, Le Tsar Pierre Alexeïvitch, L’Époque de la Tsarine, La Première Superpuissance, Un médicament pour l’Empire, Après une maladie de longue durée, Destruction et résurrection de l’Empire). Il n’y a rien d’inhabituel à ce que l’histoire d’un pays soit écrite par un écrivain, plutôt que par un scientifique. Le désir d’écrire l’histoire nationale pour un large public, dans un style vivant et non pas savant, est propre aux écrivains depuis au moins deux siècles – sans remonter à l’époque d’Hérodote et de Tacite, qui, au fond, ne peuvent guère être qualifiés d’universitaires. L’auteur de science-fiction Isaac Asimov a écrit des livres d’histoire. Aujourd’hui, le Britannique Peter Ackroyd, volume après volume, donne une remarquable Histoire de l’Angleterre, et mon collègue Pérez Reverte, auteur de romans policiers, a publié une Histoire de l’Espagne. Le premier historien russe, Karamzine, était aussi un homme de lettres, et son Histoire de l’État russe est écrite dans un style romanesque, à destination d’un large public[4]. Dans mon cas, c’est la motivation qui est inhabituelle. En général, l’auteur souhaite raconter quelque chose à ses lecteurs, partager ses connaissances, leur exposer sa conception et les convaincre du bien-fondé de sa vision. Au début du projet, je n’avais pas une connaissance suffisante de l’histoire, et j’en avais encore moins une approche conceptuelle. J’ai donc décidé de mener une expérience. J’avancerais avec mes lecteurs, d’un siècle à l’autre, pour m’orienter dans l’enchevêtrement des mythes et des faits, avec l’espoir de trouver peut-être au cours de ce voyage la réponse à la question qui me préoccupait : qu’est-ce que l’État russe et pourquoi revient-il toujours sur le même chemin ?
Les deux premiers tomes m’ont laissé dans le flou. Je me suis contenté d’examiner consciencieusement ce qui, dans le cadre d’un exposé traditionnel de l’histoire russe, relevait probablement, soit de la vérité, soit du mythe. La lumière a scintillé, lorsque je suis arrivé au XVe siècle. Peu à peu, une conception de plus en plus précise s’est dessinée dans les volumes suivants. En tout cas, elle m’a paru convaincante. Le dernier et dixième tome de mon Histoire de l’État russe n’est pas paru en Russie. Mes livres y ont été définitivement interdits et j’ai été déclaré criminel, notamment à cause de mes études historiques. Vous le savez, dans la Russie de Poutine, le lien à l’histoire est particulier et cette histoire est considérée comme une affaire d’État importante. Contester la version officielle est passible d’emprisonnement. Et cette année, je viens de retracer une fois encore l’histoire de la Russie. Cette fois-ci, en un seul volume. La motivation est la même, celle de partager ma vision avec les lecteurs et, si possible, de les convaincre de sa justesse. Il s’agit de condenser dix volumes en un seul, pour mettre l’accent sur la logique des processus socio-politiques. Et à mon avis, ce qui se passe aujourd’hui en Russie ne s’explique pas par l’idée d’un mauvais Poutine ou d’un mauvais peuple, mais par des raisons objectives. Je suis convaincu que cela ne pouvait pas se passer autrement.
Une histoire interactive ?
Le titre Chaîne d’or sur un chêne vert est emprunté à un texte poétique connu de tous les Russes depuis l’école élémentaire[5] :
Au bord de la mer, un chêne vert,
Une chaîne d’or sur ce chêne,
Et jour et nuit, le chat savant
Ne cesse de tourner autour de la chaîne.
Il va à droite, entonne une chanson,
À gauche, il raconte une histoire...
« Dans ces vers d’anthologie, selon mon interprétation, réside le code permettant de comprendre toute l’histoire russe, ai-je écrit dans ma préface. Le chêne vert, c’est la Russie, et la chaîne d’or, c’est cette part inéluctable qui entrave le pays, la fatalité cyclique de l’histoire russe : à gauche, puis à droite, à gauche, puis à nouveau à droite. Le chat savant, bien sûr, c’est l’historien russe. En période réactionnaire, il va à droite et raconte un récit effrayant sur la grandeur du destin de la Russie, et en période libérale, il entonne une chanson douce sur la Russie née pour la liberté. La Russie agite son feuillage dans le sens du vent, tantôt à gauche, tantôt à droite, mais le chêne reste au même endroit, enchaîné par la même chaîne. »
Mon livre a pour sous-titre La Wiki-histoire de l’État russe. Pour que la thèse ne se noie pas dans les détails, le livre est construit sur le modèle de Wikipédia. Et pour garder un coloris russe, j’utilise le principe des matriochkas : les éléments complémentaires sont cachés à l’intérieur du texte principal. Chaque chapitre est divisé en deux sections. La première s’intitule « Les Fondements », la seconde « Les Détails ». Si le lecteur n’est intéressé que par ma conception, il lui suffit de lire les premières sections du livre, ce qui peut être fait en une heure. Dans un texte concis et laconique, décrivant uniquement l’essence de l’époque en question, certaines phrases, noms ou mots, sont mis en évidence, et chacun d’eux est associé à un récit distinct dans la section « Les Détails ». Il est préférable de lire l’ouvrage de la manière suivante : d’abord ce qui s’est passé, puis comment cela s’est passé.
Le livre présente une autre particularité. Le texte est accompagné d’une annexe intitulée « Galerie de portraits ». L’histoire de la Russie est particulièrement instructive, parce que la construction étatique qui s’est mise en place du fait de l’extrême centralisation du pouvoir a toujours été très dépendante des qualités personnelles de son dirigeant. Les monarchies absolues et les régimes dictatoriaux totalitaires existaient bien sûr dans d’autres pays, mais les premières ont depuis longtemps disparu, et les seconds prennent généralement fin avec la mort du tyran, tandis qu’en Russie, le rôle déterminant de la personne qui se trouve au sommet de la verticale du pouvoir, reste une constante depuis des siècles. Le russe est la seule langue parmi celles que je connais où le mot « État » provient du mot « souverain ». De même que Suétone avait autrefois compilé un recueil de biographies intitulé Les Douze Césars, j’ai choisi treize « Césars » qui ont joué un rôle éminent dans l’histoire russe : un grand-prince (Ivan III), un tsar (Ivan le Terrible), cinq empereurs (Pierre Ier, Alexandre Ier, Nicolas Ier, Alexandre II, Nicolas II), une impératrice (Catherine II) , deux « guides » (Lénine, Staline) et trois présidents (Gorbatchev, Eltsine, Poutine). J’ai essayé de montrer comment les traits de caractère de chacun d’entre eux avaient influencé le destin de tout le pays. Dans mon « nouveau Suétone », le chiffre treize, considéré comme néfaste, n’a pas été choisi pour accentuer l’aspect sinistre, mais par hasard. Il ne s’agit pas simplement des portraits de treize personnes, ce sont treize types différents de dirigeants et de domination.
Une relecture de l’histoire russe
Je résumerai très succinctement les conclusions auxquelles j’arrive dans mon Histoire. L’État russe n’est pas apparu au IXe siècle et à Kiev, comme on me l’a enseigné à l’école et à l’université. Il n’a hérité que de deux éléments de la Rus’ : la religion d’État et la dynastie régnante des Rurikides[6]. Il faut faire remonter l’histoire russe au milieu du XVe siècle, à partir du grand-duc Ivan III de Moscou. L’État qu’il a construit est le successeur en ligne directe du grand empire asiatique autrefois créé par Gengis Khan. Le fondement de l’État russe en est issu, de même que ses piliers porteurs. Et ces fondements sont restés les mêmes, cette prise de conscience est ma principale découverte. Raisons pour laquelle je qualifie ce modèle d’« État de la Horde ». Ses quatre attributs indispensables sont les quatre piliers sur lesquels il repose :
1. Le système de pouvoir est rigoureusement vertical et hypercentralisé. Toutes les décisions sont prises en un seul point, comme il se doit par une seule personne, le souverain.
2. Tous les habitants du pays doivent servir l’État, proclamé comme but suprême et sens ultime du pays.
3. La figure du souverain, quel que soit son nom donné dans le contexte historique, doit être sacrée, inaccessible à toute critique.
4. L’« État de Horde » ne peut pas en principe être un État de droit. Les lois qu’il promulgue sont toujours conditionnelles et s’adressent uniquement « du haut vers le bas ». La volonté du souverain reste supérieure.
Toute violation de cette architecture, l’affaiblissement ou la destruction de l’un des quatre piliers, entraînent la destruction de toute la structure et par la suite le chaos. C’est pour cette raison que chaque tentative historique de libéralisation se termine inévitablement par la restauration fébrile de ses quatre fondements. Sans eux, il est impossible de préserver l’unité de la Russie.
Thomas Jefferson a écrit un jour à propos du nouveau pays qu’était l’Amérique et sa division en États : « Notre pays est trop grand pour que toutes ses affaires soient gérées par un seul gouvernement ». La Russie est beaucoup plus grande que l’Amérique de l’époque, mais « ses affaires » ont toujours été « gérées » par un gouvernement central. Afin de garder cet immense territoire hétérogène sous contrôle, il est contraint – oui, contraint – de s’appuyer sur la force et l’intimidation. C’est là, en somme, l’essence et la raison de cette errance mystique autour la chaîne d’or. Au cours des trente dernières années, nous avons eu une nouvelle confirmation évidente de cette vérité. Il y eut d’abord un élan vers la liberté, les quatre piliers se sont effondrés générant des mouvements centrifuges, susceptibles d’entraîner l’effondrement du pays. Il a fallu rétablir d’urgence l’hypercentralisation, réanimer l’idée d’État, créer un nouveau leader sacralisé et annuler l’indépendance du pouvoir judiciaire. C’est précisément ce qu’a fait Vladimir Poutine en rétablissant le format traditionnel de l’État.
Mais ce n’est pas Poutine qui m’inquiète. Je sais qu’à la fin la chaîne va se tendre à nouveau, la dictature s’effondrer et la Russie reprendre la direction opposée. Ce qui m’inquiète, c’est le caractère inébranlable des « piliers de la horde ». Quel que soit le pouvoir de la nouvelle Russie, aussi démocratique soit elle, elle se retrouvera très vite, comme Eltsine au milieu des années 1990, face à un choix implacable : elle devra renoncer à la domination ou à la démocratie.
Je viens d’écrire un récit terrifiant, L’Avocat du diable, qui raconte comment tout se répète, alors que Poutine n’est déjà plus là : la Russie redevient un Empire et une menace pour ses voisins. N’y a-t-il vraiment aucune issue pour sortir de cette impasse ? Il y en a une. La seule possibilité de briser la fameuse chaîne est de restructurer totalement l’État, d’abandonner l’idée d’hypercentralisation, de devenir les États-Unis d’Eurasie. Ce n’est qu’à cette condition qu’il sera possible de mettre en place un gouvernement fondé, non plus sur la peur et la violence, mais sur une démocratie. C’est pour en convaincre mes lecteurs que j’ai écrit ma Wiki-histoire.
Le livre se termine par un « chapitre inachevé » qui analyse la période post-soviétique, c’est-à-dire la période actuelle. Voici ce que j’écris en conclusion :« En 2025, la situation géopolitique de la planète a commencé à changer. L’ordre mondial établi après la victoire de l’Occident pendant la guerre froide était fondé sur l’existence d’un seul centre décisionnel principal, à Washington. Cependant, la combinaison de deux circonstances, l’une objective – l’émergence d’une nouvelle « deuxième superpuissance », la Chine, l’autre subjective – le pari du président nouvellement élu Trump sur les intérêts nationaux américains – semble marquer la fin d’une époque de trente-cinq ans et le début d’une nouvelle ère, dont les contours ne sont pas encore tout à fait définis. » Il ne fait aucun doute que la situation de la Russie va également changer, mais son avenir est plus facile à prédire que celui du monde dans son ensemble. « La chaîne d’or sur un chêne vert » ne laisse aucune marge de manœuvre. On ne sait pas combien de temps durera la période réactionnaire actuelle, mais on sait clairement comment elle se terminera : comme elle a toujours fini. Lorsque le mouvement vers la droite ira trop loin, la chaîne sera tendue à l’extrême et la Russie fera demi-tour, vers un nouveau « Dégel ». Il existe toutefois une deuxième hypothèse : la fameuse chaîne, à force de tension excessive, finira par se rompre et se briser en maillons. Alors, dans le nord de l’Eurasie apparaîtra un autre type d’État confédéral, ou plusieurs nouveaux pays indépendants. Il sera possible alors de terminer l’écriture ce chapitre. En attendant, c’est une histoire « à suivre ».
Traduit du russe par Caroline Bérenger et Kristian Feigelson. Nous remercions Boris Akounine et les organisateurs du colloque de nous avoir autorisés à traduire et publier la version en français de son texte russe. Romancier russe d’origine géorgienne, exilé à Londres depuis ses prises de positions après l’assassinat de la journaliste Anna Politkovskaïa en 2006, puis lors des manifestations qui suivirent en faveur d’une Russie démocratique, il est désormais sur la liste des « agents de l’étranger » pour avoir condamné la guerre contre l’Ukraine. Traducteur de littérature japonaise, il est aussi l’auteur de très nombreux romans traduits en France aux Presses de la Cité et finalise une volumineuse histoire de la Russie. Depuis 2023, ses livres sont tous interdits en Russie. En juillet 2025 il a été condamné à quatorze ans de prison par un tribunal de Moscou.
Did you enjoy this article? close




[1] Ivan Krylov (1769-1844) est l’auteur de fables, inspirées d’Ésope et de La Fontaine. Nombre de ses vers sont devenus des proverbes populaires. (Toutes les notes sont des traducteurs.)
[2] Korneï Ivanovitch Tchoukovski (1882-1969) était journaliste, poète et traducteur, auteur de livres pour la jeunesse. Il est le père de la romancière Lydia Tchoukovskaya, exclue de l’Union des écrivains en 1974 pour son soutien à la dissidence.
[3] Abraham Maslow (1908-1970), psychologue américain, a montré que la motivation dépendait de la hiérarchie des besoins humains qu’il a représentée sous la forme d’une pyramide
[4] Nicolaï Karamzine (1766-1826), écrivain et historien russe, contribua à propager les idées occidentales en Russie et publia une première Histoire de l’Etat Russe.
[5] Ce sont les premiers vers du long poème d’Alexandre Pouchkine, Rouslan et Lioudmila, paru en 1820, dont le succès fut immédiat et qui frappa les contemporains par le mélange des styles et des tonalités.
[6] En ukrainien Riourikovitchi, soit la dynastie ruthène d’origine varègue (les Scandinaves de Norvège), qui régna sur la Rus’ et la Moscovie de 862 à 1598. L’ancienne controverse est réactualisée aujourd’hui par le discours poutinien, opposant deux visions de l’histoire russe, l’une issue de l’Etat kiévien, l’autre remontant à la Moscovie. (N.d.T)


