La société française à la veille de la Révolution, vue par Hippolyte Taine edit
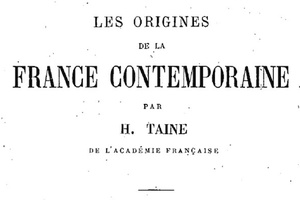
Au moment où la situation du pays exigerait que les Français fassent corps derrière leurs gouvernants pour sortir de la grave crise financière qui menace le pays en acceptant leur plan de réforme, ils ne semblent pouvoir s’unir que pour le rejeter, et, avec eux, ceux qui l’ont élaboré. Cette incapacité des Français à faire peuple n’est pas nouvelle. À la fin du XIXe siècle Hippolyte Taine l’analysait dans ce monument de l’histoire politique française que sont Les Origines de la France contemporaine, tâchant de comprendre les raisons qui ont mené le pays à la situation de 1789. Selon ce républicain conservateur cette incapacité venait de loin. Son analyse mérite d’être rappelée aujourd’hui.
« Depuis longtemps, et par un travail insensible, l’administration de Richelieu et de Louis XIV a détruit les groupes naturels qui, après un effondrement soudain, se reforment d’eux-mêmes. Sauf en Vendée, je ne vois aucun endroit ni aucune classe où beaucoup d’hommes, puissent, à l’heure du danger, rallier autour d’eux pour faire corps. Il n’y a plus de patriotisme provincial ou municipal. Le bas clergé est hostile aux prélats, les gentilhommes de province à la noblesse de cour, le vassal au seigneur, le paysan au citadin, la population urbaine à l’oligarchie municipale, la corporation à la corporation, la paroisse à la paroisse, le voisin au voisin. Tous sont séparés par leurs privilèges, par leurs jalousies, par la conscience qu’ils ont d’être frustrés au profit d’autrui. […] “La nation, disait tristement Turgot, est une société composée de différents ordres mal unis et d’un peuple dont les membres n’ont entre eux que très peu de liens, et où, par conséquent, personne n’est occupé que de son intérêt particulier. Nulle part il n’y a d’intérêt commun visible.” […] Depuis cent-cinquante ans le pouvoir central a divisé pour régner. Il a tenu les hommes séparés, il les a empêchés de se concerter, il a si bien fait, qu’ils ne se connaissent plus, que chaque classe ignore l’autre classe, que chacune se fait de l’autre un portrait chimérique, chacune teignant l’autre des couleurs de son imagination, l’une composant une idylle, l’autre se forgeant un mélodrame, l’une imaginant les paysans comme des bergers sensibles, l’autre persuadé que les nobles sont d’affreux tyrans. Par cette méconnaissance mutuelle et par cet isolement séculaire, les Français ont perdu l’habitude, l’art et la faculté d’agir ensemble. Ils ne sont plus capables d’entente spontanée et d’action collective. Au moment du danger personne n’ose compter sur ses voisins ou sur ses pareils. Personne ne sait où tourner les yeux pour trouver un guide. “On n'aperçoit pas un homme qui puisse répondre pour le plus petit district ; et, bien plus, on n’en voit pas un qui puisse répondre d’un autre homme” (Tocqueville — paroles de Burke). La débandade est complète et sans remède. L’utopie des théoriciens s’est accomplie, l’état sauvage a recommencé. Il n’y a plus que des individus juxtaposés ; chaque homme retombe dans sa faiblesse originelle, et ses biens, sa vie sont à la merci de la première bande qui saura se former. Il ne reste en lui que l’habitude moutonnière d’être conduit, d’attendre l’impulsion, de regarder du côté du centre ordinaire, vers Paris, d’où sont toujours venus les ordres. […] C’est à cela qu’aboutit la centralisation monarchique. Elle a ôté aux groupes leur consistance et à l’individu son ressort. Reste une poussière humaine qui tourbillonne et qui, avec une force irrésistible, roulera tout entière en une seule masse, sous l’effort aveugle du vent ».
Vous avez apprécié cet article ?
Soutenez Telos en faisant un don
(et bénéficiez d'une réduction d'impôts de 66%)


