Les 90 ans de la sécurité sociale (aux États-Unis) edit
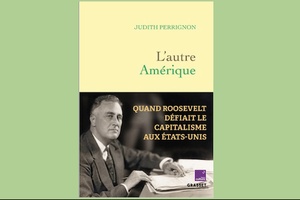
Il y a plusieurs façons de lire l’excellent ouvrage de Judith Perrignon consacré à Franklin D. Roosevelt (FDR)[1]. Organisé en particulier à partir du journal de Henry Morgenthau, secrétaire au Trésor et proche de Franklin et d’Eleanor Roosevelt, ce texte peut se dévorer, « au tamis de l’Histoire », comme la chronique de la vie, des actes et des observations d’un président réélu trois fois, artisan du New Deal et du nouvel ordre mondial, qui aura traversé les suites de la Grande Dépression, les luttes contre les conservateurs et les nazis, la Seconde Guerre mondiale, la maladie personnelle.
Nombre d’éléments opposent frontalement les idées et réalisations de FDR à la perspective trumpienne. Et il est aisé de lire le propos de Judith Perrignon comme un panorama de contrepoints à l’actualité. Il a d’ailleurs été rédigé, en partie, en ce sens. FDR se démarque par son souci d’écoute et de pédagogie (avec ses causeries au coin du feu), son New Deal (justifié davantage par le soutien à la consommation que par une bataille de principes), la promulgation en 1935 d’une sécurité sociale devant permettre de faire face à des « vies de moins en moins sûres ». Il se distingue aussi, malgré l’autocélébration de Donald Trump sur ses 100 premiers nouveaux jours de présidence, par une densité plus importante de réformes menées sur le même laps de temps[2]. D’ailleurs l’intérêt pour les « cent jours » n’est pas uniquement une référence française napoléonienne. C’est aussi une référence américaine rooseveltienne, devenue jalon politique international.
Document savoureux, aussi érudit qu’accessible, le livre original de Perrignon permet de multiples regards sur FDR et l’Amérique, de l’anecdotique (parfois cocasse, quand Churchill se retrouve dans le plus simple appareil face à Roosevelt) au fondamental (souvent tragique quand il s’agit des conflits en Europe et dans le Pacifique) en passant par les figures imposées de la période (Pearl Harbour ou Yalta, par exemple).
Un projet séminal de sécurité sociale
Sous un titre emprunté à un classique des ouvrages relatifs à la question sociale outre-Atlantique, L’Autre Amérique[3] est un excellent portrait humain et historique. C’est, en particulier, une manière de se pencher sur la sécurité sociale américaine.
Signalons d’emblée que celle-ci supporte malaisément la comparaison, terme à terme, avec l’institution française. Les États-providence, aux États-Unis et en Europe, présentent des différences fondamentales de nature et de philosophie[4]. Les formes et les ampleurs de la protection sociale diffèrent actuellement très significativement. Cependant, sur les fonts baptismaux doctrinaux, en particulier pour ce qui relève même de l’idée de sécurité sociale, les États-Unis et l’Europe, au sein de laquelle la France occupe une place singulière, ont en réalité beaucoup en partage.
Il est vrai que si, sous le même nom, on trouve des assurances sociales et des cotisations, avec une affiliation pour la quasi-intégralité de la population, aux États-Unis il s’agit, principalement, d’un système de retraite de base auquel s’ajoutent des prestations pour les invalides, quand, en France, il s’agit d’une institution bien plus large, couvrant les risques vieillesse, santé, accidents du travail, famille et, depuis 2020, autonomie. Du côté américain, un système très décentralisé, du côté français un système très centralisé.
Surtout, le système américain est resté de plus faible voilure alors que l’édifice français s’est étendu et généralisé. C’est d’ailleurs, comme son nom l’indique, le dessein du régime général déployé depuis 1945. En termes financiers, la sécurité sociale outre Atlantique représente environ le quart des dépenses fédérales, quand, en France, les dépenses de sécurité sociale sont bien supérieures à celles de l’État. Autre différence notable, dans l’actualité au sujet précis des retraites, alors que le gouvernement français semble souhaiter taxer davantage, d’une façon ou d’une autre, les retraités, Donald Trump fait exactement le contraire, appelant à supprimer les taxes fédérales portant sur les pensions, ouvrant lui-aussi des débats nourris sur la soutenabilité financière des systèmes[5].
Ces distinctions contemporaines à l’esprit, les développements de Judith Perrignon, à partir, notamment, des rencontres et discussions entre Morgenthau et FDR autorisent un retour intéressant sur des âges anciens de la sécurité sociale.
1935 et 1945: des dates de naissances différentes pour des buts communs
Quand la France commémore, habituellement tous les dix ans, sa sécurité sociale née par ordonnances en octobre 1945, les États-Unis honorent annuellement, certes plus chichement, leur sécurité sociale, issue d’une loi paraphée par FDR en août 1935 dans le cadre du New Deal. Rituellement, la social security administration publie un communiqué. Des études historiques et statistiques sont diffusées. Des événements, plus ou moins denses selon les années et les orientations des gouvernements au pouvoir, sont organisés.
S’arrêter aux festivités intéresse peu. C’est le retour aux fondamentaux qui importe, ne serait-ce que pour rappeler l’antériorité de la sécurité sociale américaine, nourrissant d’ailleurs les projets qui vont suivre, employant l’expression ailleurs qu’aux États-Unis[6].
Lire l’ouvrage de Judith Perrignon c’est revoir combien le projet de FDR, sur le plan social, consistait, selon les mots du président, en « une tentative de réduction des risques et des vicissitudes de la vie ». Début 1935, FDR s’adressait ainsi au Congrès, en soulignant que figuraient parmi les principales visées de son programme « la sécurité des hommes, des femmes et des enfants de la nation contre certains aléas et vicissitudes de la vie ». « Cet objectif, ajoutait-il, est un élément essentiel de notre mission. »
On a presque l’impression, avec ces expressions de 1935, de lire du Pierre Laroque, figure iconique de la sécurité sociale française, qui estimait, en 1945, que « la sécurité sociale répond à la préoccupation fondamentale de débarrasser les travailleurs de la hantise du lendemain ».
FDR assortit la promulgation du texte instituant un retraite fédérale, , le 14 août 1935, d’une déclaration qui mérite d’être largement reprise ici, tant ses accents semblent, disons, laroquiens. Le conseiller d’État français et le président américain diplômé de Harvard se rejoignent dans la légitimation d’une intervention publique qui ambitionne de diminuer l’insécurité sociale.
« Aujourd'hui, un espoir de longue date est en grande partie réalisé. La civilisation du siècle dernier, avec ses bouleversements industriels, a eu tendance à rendre la vie de moins en moins sûre. Les jeunes en sont venus à se demander quel serait leur sort une fois arrivés à la vieillesse. L'homme qui a un emploi se demande combien de temps il va durer. (…) Nous ne pourrons jamais assurer 100 % de la population contre 100 % des aléas de la vie, mais nous avons tenté d'élaborer une loi qui offrira une certaine protection au citoyen moyen et à sa famille contre la perte d'emploi et une vieillesse accablée de pauvreté. Cette loi constitue également la pierre angulaire d'un édifice en construction, mais loin d'être achevé. (…) En bref, c'est une loi qui répondra aux besoins humains tout en dotant les États-Unis d'une structure économique bien plus solide.[7] »
À l’occasion du troisième anniversaire de cette législation, le président fait une déclaration à la radio, le 15 août 1938, indiquant que « un programme de sécurité sociale doit inclure tous ceux qui ont besoin de sa protection ».
Début 1939, dans un message au Congrès, il ajoute : « Nous réaliserons les progrès les plus harmonieux si nous considérons la sécurité sociale comme un développement vers un objectif plutôt que comme un produit fini. Nous réaliserons les progrès les plus durables si nous reconnaissons que la sécurité sociale ne peut fournir qu'une base sur laquelle chacun de nos citoyens peut bâtir sa sécurité individuelle par ses propres efforts. »
Dans son discours sur l’état de l’Union prononcé le 6 janvier 1941, FDR insiste sur quatre libertés présentées comme essentielles. Ce texte, devenu célèbre sous le nom de « Discours des quatre libertés », estime que partout dans le monde les êtres humains devraient pouvoir jouir de 1/ la liberté d’expression, 2/ la liberté de religion, 3/ la liberté de vivre à l’abri du besoin, 4/ la liberté de vivre à l’abri de la peur. Ce discours ambitieux inspirera la Charte de l’Atlantique de 1941 puis, en 1948, la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Les ambitions sociales de FDR culmineront dans un autre célèbre discours sur l’état de l’Union, lui aussi radiodiffusé, le 11 janvier 1944. Il y suggérait que les États-Unis avaient atteint un stade de développement leur permettant une « seconde Déclaration des droits », complétant les droits politiques garantis, par des droits que l’on dirait aujourd’hui proprement sociaux. Le président aurait voulu que soient ainsi garantis un emploi utile et rémunérateur, un foyer décent, une bonne éducation, des soins médicaux adéquats. Dans sa liste de droits, il signale « le droit à une protection adéquate contre les peurs économiques d’un autre âge, la maladie, l’accident et le chômage ». FDR qualifiait ces droits non de sociaux mais d’économiques. « Nous ne pouvons être satisfait, déclarait-il alors, peu importe la hauteur du standard de vie, si une fraction de notre peuple – qu'elle soit d'un tiers, d'un cinquième ou d'un dixième – souffre de malnutrition, de mauvais habillement, de mal-logement et d'insécurité. » Il envisage donc « une seconde déclaration des droits sous laquelle une nouvelle base de sécurité et de prospérité peut être établie pour tous ».
La France n’est pas seule au monde ; les États-Unis ne sont plus ceux de Roosevelt
Judith Perrignon fait de l’implication de FDR dans ce domaine social une analyse politique, au regard du capitalisme. Elle estime, à juste titre, que New Deal et social security visent à ce que le capitalisme fonctionne pour le citoyen moyen. Les réformes rooseveltiennes ne condamnent pas le capitalisme. Elles l’aménagent, dans un contexte qui n’est évidemment pas celui de 1945. Le bandeau choisi pour accompagner le livre de Perrignon va un rien plus loin dans le ton : « Quand Roosevelt défiait le capitalisme aux États-Unis ». Incontestablement FDR ne voulait pas le défaire, mais le transformer, l’ajuster, ce qui passait par du volontarisme et, matériellement, par un édifice comme celui de la sécurité sociale.
Se pencher sur les propositions et réalisations de FDR, quand la sécurité sociale, en France, s’apprête à devenir octogénaire c’est se rappeler que ce sujet n'est pas uniquement un chef d’œuvre français, ou supposé tel. C’est un projet politique éminent, qui dépasse le nombrilisme hexagonal et que pourraient faire trépasser des orientations politiques radicales.
L’autre Amérique, contemporaine, n’est plus celle de FDR. Plus libertarienne et se mouvant dans un capitalisme exacerbé, elle pourrait vouloir réviser des compromis sociaux anciens et plus importants que ce qu’en perçoivent habituellement les Français. Mais il n’est pas certain que cette remise en cause soit vraiment le projet de tous les Américains.
Soulignons, pour finir, qu’en France comme aux États-Unis, même s’ils ne désignent pas la même chose, les programmes de sécurité sociale sont très populaires. Le président Trump ne s’y trompe pas lui-même, puisqu’il a plusieurs fois répété qu’il ne toucherait pas aux prestations, tout en s’attaquant à la gestion[8].
Did you enjoy this article? close




[1]. Judith Perrignon, L’Autre Amérique, Paris, Grasset, 2025, 240 pages
[2]. À ce sujet, voir la chronique très critique de Jamelle Bouie, « The New Deal Is a Stinging Rebuke to Trump and Trumpism », New York Times, 9 mai 2025.
[3]. The Other America est un livre du socialiste américain Michael Harrington paru en 1962. Cet ouvrage sur la pauvreté dans une société d’abondance, vendu à plus d’un million d’exemplaires, sera l’une des sources d’inspiration politique pour le lancement de « la guerre contre la pauvreté » par le président Johnson début 1964. Quand l’ouvrage de Harrington sur l’autre Amérique fait référence à l’Amérique pauvre (l’auteur estimait que 25% des Américains étaient pauvres), Judith Perrignon fait, elle, référence à une Amérique non trumpienne, plus sociale.
[4]. Pour des analyses poussées, voir Alberto Alesina et Edward L. Glaeser, Fighting Poverty in the US and Europe : A World of Difference, Oxford, Oxford University Press, 2004. Traduction : Combattre les inégalités et la pauvreté. Les États-Unis face à l’Europe, Paris, Flammarion, 2006.
[5]. En résumé, voir cette courte note « Eliminating Taxation of Social Security Benefits Would Be Unwise » du Center on Budget and Policy Priorities (CBPP).
[6]. Voir à ce titre les remarques sur la sécurité sociale de 1935 aux États-Unis dans l’ouvrage dirigé par Claire Andrieu, Le Conseil national de la Résistance. Un programme fondateur, Paris, Gallimard, coll. « folio », 2025
[7]. On trouve cette déclaration dans l’ouvrage de Judith Perrignon. On trouve toutes les déclarations de FDR relatives à la sécurité sociale ici : https://www.ssa.gov/history/fdrstmts.html
[8]. Voir, par exemple, ce communiqué de la Maison Blanche : https://www.whitehouse.gov/articles/2025/03/fact-check-president-trump-will-always-protect-social-security-medicare/


