L’avenir de l’UE se joue à l’Est edit
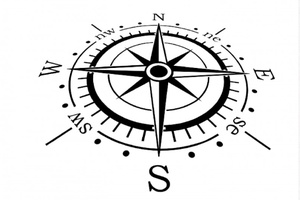
Les problèmes auxquels l’UE est confrontée avec la Pologne, la Hongrie et d’autres pays de l’Est, les difficultés à organiser de manière productive les relations avec d’autres pays candidats, et désormais les conséquences dramatiques de la guerre en Ukraine sont, à juste titre, considérés par beaucoup comme des questions existentielles dans le sens où ils dépassent le conflit d’intérêts normal pour affecter la nature même de la construction commune.
Patience stratégique
Ce n’est pas la première fois que cela se produit, notons-le. C’est le propre de toute grande construction politique que d’être confrontée à des problèmes existentiels ; les États-Unis, qui ont dû traverser une guerre civile, en savent quelque chose. Née il y a seulement soixante-dix ans, l’Union européenne (alors Communauté) est passée de 6 à 28 membres (aujourd’hui 27) en moins de quarante ans sans jamais vraiment clarifier sa nature et sa finalité. Il n’est donc pas surprenant que l’intégration ait connu d’autres problèmes existentiels. D’abord avec la France gaulliste, puis avec la Grande-Bretagne de Margaret Thatcher, et enfin la dialectique Nord-Sud dans la gestion de l’euro. Ces crises ont toujours trouvé une réponse dans des compromis pragmatiques, qui dans le cas de la Grande-Bretagne n’ont pas réussi à éviter la rupture ultime. Dans d’autres cas, les compromis ont non seulement évité la rupture, mais ont permis à l’intégration de faire des progrès inespérés à l’époque. La leçon à en tirer est que pour progresser, l’Europe a besoin de patience stratégique.
Qu’est-ce que cela nous apprend sur les problèmes posés par l’élargissement à l’Est ? Tout d’abord, nous devons analyser les erreurs commises. Dans ce cas précis, la première erreur, fondamentale à bien des égards, a été de gérer cet élargissement déjà quantitativement impressionnant de la même manière que les précédents. En substance, nous avons cru qu’il suffisait d’une aide adéquate et de mesures transitoires pour faciliter l’entrée dans l’UE de cousins un peu plus pauvres et en retard, mais au fond seulement désireux de « devenir comme nous ». Il ne s’agit pas de dire, comme certains le prétendent, que l’élargissement à l’Est était prématuré (il a eu lieu près de vingt ans après la chute du mur de Berlin !), ou même erroné. Le résultat économique est fondamentalement positif, tant pour les nouveaux membres que pour les anciens. D’un point de vue politique, cependant, l’appréciation est différente.
En traitant les conséquences de la chute du mur, nous, Européens « occidentaux », avons ignoré l’histoire et la géographie. En partie par arrogance, en partie parce que nous étions absorbés par des problèmes domestiques urgents, nous avons regardé vers l’Est d’une manière souvent épisodique et distraite. Les peuples qui ont donné naissance au processus d’intégration européenne après la fin de la Seconde Guerre mondiale sortaient d’une longue histoire, souvent dramatique, qui les avait amenés à consolider une identité nationale et un consensus autour d’institutions démocratiques. Ayant tragiquement acquis la conscience que le nationalisme est la pathologie des identités nationales insécurisées, nous avions laissé mûrir les conditions qui pouvaient nous permettre de le surmonter et de partager une partie de notre souveraineté. L’Occident était à l’unisson : mai più, plus jamais, never again, nie wieder ! Sans surprise, l’UE est devenue le principal champion de l’ordre libéral multilatéral. Les peuples de l’Est, qui habitent cet arc de crise s’étendant de la Baltique à l’Adriatique et à la mer Noire, ont connu une histoire différente. Après la fin de la Première Guerre mondiale, ils avaient acquis leur indépendance grâce à la dissolution violente des trois grands empires russe, autrichien et ottoman, avec des frontières tracées par les vainqueurs, de manière parfois artificielle. Puis ils ont été rapidement dépassés par l’immense tragédie de la Seconde Guerre mondiale, qui y a produit des horreurs et une dévastation encore plus grandes qu’en Occident. Comme si cela ne suffisait pas, cette période a été suivie d’un demi-siècle de communisme et de domination russe. Il y a de quoi avoir une perception de la démocratie, de l’identité nationale, en gros de l’histoire du siècle dernier, différente de la nôtre. Comme l’explique Ivan Krastev dans le Financial Times (1er août 2022), le défi majeur pour les pays de l’Est reste de (re)construire une identité nationale fonctionnelle. Il y a ici les conditions préalables à un problème existentiel pour l’Union Européenne beaucoup plus complexe que les crises que j’ai mentionnées précédemment.
Après l’effondrement du communisme, c’est à l’Allemagne qu’aurait dû revenir la tâche de nous guider dans la définition d’une politique orientale efficace. Pour des raisons historiques qu’il n’est pas nécessaire de rappeler, pour les pays de l’Est, y compris la Russie, elle est à la fois le partenaire le plus important mais aussi le plus problématique de l’Ouest ; une relation qui est source de grande attraction, de suspicion constante et de récriminations épisodiques. En attestent les demandes tardives de « réparations » pour les crimes commis pendant la Seconde Guerre mondiale (en Pologne, par exemple, mais aussi en Grèce), qui témoignent moins d’un conflit latent avec l’Allemagne que d’un besoin persistant de compenser sa propre faiblesse par des manifestations grandiloquentes de nationalisme. Absorbée par le rêve de n’être « entourée que d’amis » selon la célèbre formule de Hans-Dietrich Genscher en 1990, l’Allemagne réunifiée d’Angela Merkel a décidé de placer la quasi-totalité de sa politique orientale sous le signe des relations économiques et commerciales et a proposé le même modèle à toute l’Union européenne. Parmi les autres grands pays du continent, l’Italie a largement suivi les traces de l’Allemagne. La politique orientale de la France, en revanche, a toujours été historiquement inspirée par le désir de contenir l’Allemagne ; ayant abandonné cet objectif, elle a semblé se désintéresser de l’Europe orientale, à l’exception d’une focalisation épisodique et parfois irréaliste sur la Russie.
Des questions négligées
La première question majeure qui n’a pas été abordée à temps est celle des nombreux conflits et revendications ethniques à l’intérieur des frontières parfois artificielles qui ont résulté des deux guerres mondiales. On semble presque avoir oublié que le premier acte de la réconciliation franco-allemande a été le règlement définitif des revendications mutuelles sur la Sarre. Les tensions voire ethniques et territoriales à l’Est, longtemps réprimées et jamais réglées et que l’effondrement du communisme a laissé émerger, étaient dans certains cas graves et persistantes. Il suffit de regarder la carte des minorités ethniques disséminées en Europe de l’Est. Ces tensions ne sont pas toutes de la même intensité, mais elles contribuent au difficile processus de construction de l’identité nationale dont parle Krastev. Une Europe occidentale qui avait finalement fait la paix avec sa propre histoire aurait dû apprendre quelque chose de l’explosion de l’ex-Yougoslavie. Au contraire, l’Allemagne et le reste de l’Europe occidentale, qui avaient également compris que l’unification allemande devait s’accompagner de la reconnaissance définitive de la frontière polonaise, se sont lancés dans le processus d’élargissement comme si ces conflits étaient secondaires ou pouvaient être réglés après l’élargissement. Il semble que nous ayons enfin, mais bien tard, retenu la leçon des Balkans.
Le deuxième problème prévisible qui aurait dû être traité à temps concerne la notion même de démocratie et d’État de droit. Elle a explosé avec une force particulière dans le cas de la Hongrie, longtemps dirigée par le régime autoritaire d’Orban, et de la Pologne depuis qu’elle est dirigée par le parti nationaliste PIS. L’importance de ce clivage sur la démocratie et l’État de droit ne doit pas être sous-estimée. Il est cependant très difficile à traiter en raison de la nature imparfaite de la construction européenne. Dans une UE sans constitution fédérale, l’adhésion aux valeurs démocratiques est implicite, considérée comme allant de soi. Il s’ensuit que les instruments permettant de faire face à leurs violations dans un système qui, après tout, est toujours composé d’États souverains, sont faibles, voire inexistants ; dans la pratique, ils se limitent à l’exercice de pressions économiques. Dans ces conditions, il est difficile d’expliquer au public pourquoi l’UE peut intervenir efficacement contre la violation des règles de concurrence mais pas contre celle de valeurs beaucoup plus fondamentales. Tout cela explique pourquoi la Commission et le Conseil européen sont obligés d’équilibrer en permanence fermeté et pragmatisme. Un cas évident de « patience stratégique ».
La gestion de cet équilibre précaire était déjà terriblement difficile lorsque l’invasion de l’Ukraine par la Russie est venue bouleverser les cartes. En Occident, l’effondrement du communisme et la dissolution de l’URSS avaient été accueillis avec un optimisme prudent. On pensait que l’attrait de notre modèle et l’intensification des relations économiques amèneraient une Russie libérée de l’idéologie communiste à évoluer dans une direction compatible avec les valeurs occidentales, rendant ainsi possible une sécurité européenne stable. De fait, au début, l’évolution a semblé encourageante. Les relations économiques avec la Russie se sont intensifiées avec pour conséquence, toutefois, d’accroître notre dépendance énergétique ; les relations politiques se sont également multipliées, avec un accord entre la Russie et l’OTAN et son entrée dans le G8. Lorsque, avec l’arrivée de Poutine au pouvoir, l’évolution de la Russie a pris la voie d’un ethno-nationalisme de plus en plus agressif à l’extérieur et d’un autoritarisme à l’intérieur, cela a été interprété comme une crise de croissance qui incitait à la prudence, mais pas à un changement radical de stratégie. Pour tous et surtout pour la France, l’Italie et l’Allemagne, le slogan allemand de Wandel durch Handel, le changement par le commerce, a continué à s’appliquer. Même l’invasion de la Géorgie en 2008, puis en 2014 celle de la Crimée et du Donbass, qui nous ont contraints à des réponses d’une certaine dureté, n’ont pas changé radicalement la stratégie. Face à cette manifestation de déni visible surtout en Allemagne, le message venant de l’Est, de Pologne, des pays baltes et même des pays scandinaves, était radicalement différent. Le tournant autoritaire et agressif de la Russie n’était pas considéré comme un facteur temporaire, mais comme un choix stratégique conscient, une vision du monde et de la mission assignée à la Russie ; une vision qui ne serait pas facile à changer. Le déni qui prévaut en Occident nous a conduits à rejeter ces analyses avec une complaisance bienveillante et arrogante : on en comprenait la logique, mais on rejetait leurs conclusions, vues comme extrémistes. L’invasion de l’Ukraine le 24 février dernier nous oblige à reconnaître que nos cousins extrémistes avaient raison. Elle a imposé à tous un changement qui n’affecte pas seulement les relations avec la Russie, mais a des implications profondes sur l’attitude des Européens vis-à-vis de leur rôle dans le monde, de la défense commune, des relations entre l’UE et l’OTAN, sans parler de la politique énergétique et de la diversification des approvisionnements.
Le tournant allemand
L’UE a réagi à cette crise avec un degré d’unité que peu auraient cru possible. L’innovation la plus importante est la Zeitenwende, le tournant décisif de l’Allemagne, consacré par le récent discours d’Olaf Scholz à Prague. Le processus de définition de la nouvelle politique allemande sera nécessairement lent et complexe, mais à Prague, Scholz a peut-être jeté les bases d’un dépassement définitif du cauchemar séculaire de nombreux peuples orientaux : celui d’un accord entre les deux impérialismes allemand et russe.
La percée est assurément fragile, en raison de la persistance de fortes tendances pacifistes en Europe et parce qu’elle implique des choix économiques et sociaux difficiles pour pratiquement tous les États membres. Pour autant, même si le passé n’est pas nécessairement un guide pour l’avenir, c’est un fait que depuis le début des hostilités, la solidarité européenne et occidentale s’est renforcée plutôt qu’affaiblie. Le discours d’Emmanuel Macron à l’ONU en est une bonne illustration. Alors que les sondages reflètent des hésitations et des divisions dans l’opinion publique, pour la plupart des gouvernements, ce mouvement est probablement irréversible, sinon par choix, du moins par nécessité. L’absence d’échéances électorales majeures accroît, à cet égard, la liberté d’action des gouvernements. Il y a l’exception italienne avec les incertitudes qu’elle comporte. La probabilité qu’une nouvelle majorité soit prête à rompre avec la solidarité occidentale est toutefois mince.
En outre, malgré les caractéristiques communes décrites ci-dessus, il ne faut pas négliger la diversité des nouveaux membres, ce qui est également un aspect facilement négligé en Occident. Pour mieux faire entendre leur voix au sein de l’UE, certains d’entre eux ont par le passé promu des regroupements tels que le groupe de Visegrad (Pologne, Hongrie, Slovaquie, République tchèque), dont le dénominateur commun est toutefois réduit. La guerre en Ukraine exagère ces différences. L’un des effets a été de créer un profond fossé entre la Hongrie d’Orban, qui maintient une attitude amicale envers la Russie, et la Pologne (et presque tous les autres pays). L’autre effet majeur est qu’il devient maintenant encore plus difficile de traiter les autres cas de désaccord sérieux mentionnés précédemment que nous avons avec la Pologne, qui est non seulement en première ligne sur la question vitale des relations avec la Russie, mais qui a fait preuve d’une grande générosité en accueillant des réfugiés d’Ukraine.
Les conséquences de tout cela sur les relations Est-Ouest au sein de l’UE sont très importantes. Tout d’abord, il y a une pression accrue pour rendre le fonctionnement de l’UE plus agile, y compris jusqu’à une extension du vote à la majorité. Le développement de l’UE au cours des dernières décennies a souvent été le résultat de l’action de pionniers qui ont ensuite entraîné les autres (par exemple, avec l’euro et Schengen). Dans le même temps, des crises comme le Brexit et l’Ukraine montrent combien l’unité des 27 est une valeur à préserver. Aujourd’hui il n’est guère crédible de concevoir un noyau de politique étrangère et de défense commune en s’abstenant de prendre en compte la contribution et les intérêts de la Pologne, des pays Baltes et des pays nordiques. L’agression russe contre l’Ukraine prouve non seulement que l’adhésion à l’UE est vitale pour la sécurité des pays de l’Est, mais aussi que seule leur pleine intégration peut garantir de manière permanente la sécurité de notre frontière orientale et de l’UE dans son ensemble. L’avenir de l’UE se jouera sur la dialectique entre ces différentes exigences. Dans cette perspective un objectif stratégique est de travailler à élargir le fossé entre la Pologne et la Hongrie, en préservant le dialogue avec la première et en augmentant la pression sur la seconde. Tout ceci conduit également à la conclusion qu’il est actuellement irréaliste de croire que la dialectique entre le dynamisme offert par l’avant-garde et la préservation de l’unité peut conduire à des formes structurées à géométrie variable ou à des cercles concentriques. Une lecture attentive du discours de Scholz à Prague, ainsi que du discours sur l’état de l’Union d’Ursula von der Leyen, montre que le maintien de l’unité sans compromettre le dynamisme et sans renoncer aux valeurs fondamentales est également la grande préoccupation de certains des principaux dirigeants de l’UE.
L’équilibre Est-Ouest dans la gouvernance de l’UE est donc destiné à rester une question existentielle majeure, notamment parce qu’il conditionne le prochain défi : celui de l’élargissement désormais inévitable aux Balkans et la perspective désormais officiellement acceptée de l’adhésion de l’Ukraine, de la Moldavie et, à terme, de la Géorgie. Pour l’Union européenne, encore fragile, c’est un défi encore plus difficile que ceux que nous avons connus jusqu’à présent. Parmi les victimes de l’invasion de l’Ukraine figure également l’illusion de résoudre le problème de la sécurité européenne avec de nouvelles « Finlandes ». Quelle que soit l’évolution de la guerre en Ukraine, le rêve de nombreuses personnes d’une architecture de sécurité européenne stable incluant la Russie s’est évanoui pour l’instant. Il ne reste que la possibilité d’un équilibre instable de la dissuasion et, lorsque cela est possible, du dialogue pour éviter que les crises ne dégénèrent en conflit. En quelque sorte, une réédition de la guerre froide, bien que dans des conditions très différentes.
Le discours de Scholz à Prague suggère que le message a été bien compris à Berlin. Il faut espérer qu’il le soit à Rome et à Paris.
Did you enjoy this article? close





