La Russie vue de France, 1880-2022 edit
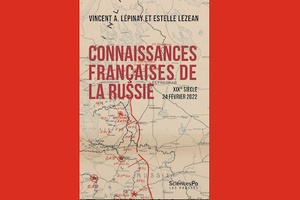
Comment les Français ont-ils constitué la Russie en objet de savoir ? Derrière cette question apparemment simple se cache un chantier considérable, que Vincent A. Lépinay et Estelle Lezean ont entrepris de défricher dans un ouvrage aussi ambitieux qu’original. Fruit d’une véritable enquête au long cours, ce travail de plus de 500 pages explore « la première tentative d’étudier de manière systématique et approfondie la production de ces variétés de discours sur la Russie, des plus articulés aux plus fragiles, entre 1880 et 2024, période pendant laquelle l’objet d’étude a subi des changements massifs et répétés ». Le sous-titre choisit d’ailleurs d’arrêter le curseur au 24 février 2022, signalant que l’invasion de l’Ukraine marque à la fois un nouveau changement et une inflexion dans la manière de produire du savoir. Au croisement de l’histoire des idées, de la sociologie des sciences et des humanités numériques, Connaissances françaises de la Russie renouvelle en profondeur notre compréhension de la façon dont l’université française, ses institutions et ses acteurs ont appréhendé la Russie au long d’un siècle marqué par des bouleversements politiques et épistémologiques majeurs.
Une approche méthodologique et épistémologique novatrice
L’ouvrage de Vincent A. Lépinay et Estelle Lezean se distingue d’emblée par son positionnement épistémologique audacieux. Plutôt que de proposer une énième synthèse sur les relations franco-russes, déjà réalisée sous diverses formes (Pierre Renouvin y consacre un article dès 1959 dans les Cahiers du Monde russe) ou une histoire intellectuelle classique, les auteurs choisissent de prendre la Russie « non pas comme fin en soi à étudier, mais comme objet assemblé qu’il convenait de déconstruire en partant des entités produites par l’œil et l’écrit des pourvoyeurs de connaissances ». Cette perspective constructiviste renverse la question traditionnelle : il ne s’agit plus de demander ce que les Français ont dit de la Russie, mais comment ils l’ont constituée en objet de savoir.
Le travail proposé s’inscrit résolument dans le champ de l’histoire des idées, cherchant « à comprendre l’ensemble de l’écosystème d’énoncés générés autour et au sujet de son objet impliquant à la fois des démonstrations académiques mais également des stéréotypes et des clichés ». Cette approche systémique permet d’embrasser la diversité des discours produits sur la Russie, des plus rigoureux aux plus fragiles, sans établir de hiérarchie a priori entre productions savantes et représentations communes.
L’originalité méthodologique de l’ouvrage tient également au recours massif aux humanités numériques. Les auteurs exploitent une série de bases documentaires qu’ils rendent « interprétables pour l’étude », permettant ainsi de passer d’une lecture impressionniste à une cartographie quantitative des imaginaires. Cette mobilisation d’outils numériques autorise un véritable changement d’échelle : corpus de thèses, monographies de la BnF, articles de presse, émissions audiovisuelles sont traités de manière systématique. L’analyse des réseaux permet notamment de « repérer les cercles littéraires et savants impliqués dans la diffusion des idées sur la Russie » et d’éclairer « la manière dont les stéréotypes circulent ».
Enfin, le choix de concentrer l’analyse sur les productions savantes universitaires plutôt que sur les récits littéraires ou les témoignages à succès, comme ceux d’Astolphe de Custine ou d’Eugène-Melchior de Vogüé, repose sur une justification épistémologique solide. En effet, les travaux universitaires s’inscrivent dans un processus collectif d’accumulation des connaissances : ils citent, discutent et prolongent des travaux antérieurs, produisant un savoir stabilisé et transmissible. La galerie de portraits des acteurs de la production de connaissances françaises de la Russie proposée par l’ouvrage, trop longue pour être reprise ici, est d’ailleurs remarquable par son érudition et sa précision. La production de connaissances reflète des paradigmes dominants, des angles morts, des controverses internes ou des outils d’analyse disponibles à un moment donné, l’étude offrant ainsi une fenêtre privilégiée sur l’évolution des grilles de lecture scientifiques.
Les enseignements d’une enquête au long cours
L’ouvrage constitue « une histoire simultanée de l’enseignement du russe comme langue étrangère, de la Russie comme objet, et de l’université française d’un long XXe siècle et jusqu’aux nouvelles directions qui ont marqué l’organisation de l’enseignement et de la recherche française ».
L’enquête commence par les « défricheurs », notamment avec l’ouverture de la première chaire française de langue russe à l’École des langues orientales en 1876, confiée à Louis Léger (1843-1923), dans le contexte politique de l’Alliance franco-russe (1892-1917), scellant le rapprochement des deux pays. Les auteurs montrent comment s’opère le passage de la langue à l’objet Russie, mettant en lumière le rôle de figures telles qu’Anatole Leroy-Beaulieu, auteur de L’Empire des tsars et les Russes (1882) et directeur de l’École libre des Sciences Politiques de 1906 à 1912, et plus ultérieurement Hélène Carrère d’Encausse au sein de la même institution.
L’importance de la première émigration après la révolution bolchévique apparaît comme un moment décisif, avec la constitution de « petites Russie en France » qui transforment durablement le paysage académique français. L’ouvrage met également en évidence l’influence du Parti communiste français, et de la présence de ses membres et sympathisants dans les différentes institutions, ainsi que le rôle déterminant du CNRS dans les échanges universitaires dès les années 1970-1980.
En outre, un enseignement majeur concerne le développement en France du champ des aires politiques (ou études aréales), qui « partait du postulat que l’ensemble culturel prédominait sur les variations disciplinaires ». L’ouvrage retrace ainsi leur implantation, notamment grâce au rôle de Clemens Heller en lien avec Fernand Braudel, qui contribuèrent à structurer une approche privilégiant l’appréhension globale d’un espace civilisationnel plutôt que le découpage disciplinaire traditionnel. Cette perspective a favorisé une lecture holistique de l’URSS comme système cohérent et stable. Les auteurs expliquent ainsi la « sidération » provoquée par la chute de l’URSS dans les milieux académiques français, incapables d’anticiper un tel bouleversement en raison de leurs présupposés méthodologiques.
La période post-soviétique voit la transformation du rapport à la Russie selon deux modalités : de nombreux Russes viennent dorénavant en France parler de la Fédération de Russie ; mais aussi, l’expertise étrangère s’est déployée pour redresser la Russie après l’effondrement soviétique, développant d’autant le besoin d’expertise. Ce « moment de l’expertise » correspond d’ailleurs à une nouvelle reconfiguration des études russes, bientôt remise en cause en raison d’un durcissement progressif, puis brutal du régime poutinien, qui affecte d’autant les possibilités mêmes de recherche.
Par son approche consistant à questionner les partis pris de l’observateur plutôt que l’objet observé, l’ouvrage déconstruit la vision essentialiste de la « Russie éternelle », cette formule éculée renvoyant à une vision essentialiste qui imagine la Russie comme un bloc immuable, porteur d’une identité profonde et stable. Les études russes scientifiques se construisent au contraire sur l’idée que les sociétés se transforment, que les catégories sont historiquement situées et que les phénomènes doivent être expliqués plutôt qu’essentialisés.
Ouvertures comparatives et perspectives de recherche
Le caractère pionnier de cet ouvrage tient moins à son sujet qu’à une manière nouvelle de poser les questions, de constituer l’objet, voire de mobiliser les matériaux rendus interopérables. Ce travail a permis de produire des concepts opératoires et des typologies (parmi les acteurs des études russes) qui deviennent, à leur tour, réutilisables par d’autres chercheurs. À ce titre, il s’agit d’un travail qui rend possible d’autres recherches, notamment pour confronter ces résultats à d’autres « savoirs européens » de la Russie.
Cette perspective comparative rendue possible par ce travail apparaît comme l’un des horizons les plus stimulants ouverts par l’ouvrage. Ainsi, l’Allemagne possède une tradition très forte d’Osteuropaforschung (recherche sur l’Europe de l’Est), souvent accompagnée d’un travail réflexif sur les représentations allemandes de la Russie et les héritages intellectuels de la Russlandkunde du XIXe siècle. De son côté, la Pologne a développé une abondante littérature critique sur les imaginaires nationaux de la Russie et la construction du « voisin menaçant ». Le Royaume-Uni a produit une réflexion sur l’héritage des récits victoriens et le rôle des think tanks dans la connaissance de la Russie. Les pays nordiques (Finlande, Suède) ont travaillé quant à eux sur la « proximité contrainte » et la construction de l’ennemi. Chaque tradition nationale porte ainsi la marque de son histoire géopolitique et de sa distance, géographique autant que symbolique, avec le monde russe.
Situer la France dans ce paysage européen permettrait de comprendre ce qui est spécifique à la tradition française (moralisation politique, fascination littéraire, rôle des voyageurs aristocrates), et ce qui est partagé avec d’autres pays (peur de l’autocratie, exotisation, mystique de l’âme russe). Les auteurs esquissent d’ailleurs ce chantier, observant qu’« au XIXe siècle, les études slaves ne s’inscrivent pas dans une longue histoire des sciences, comme c’est le cas en Allemagne où les universités sont les lieux de foisonnement intellectuel favorisant les échanges entre mondes germanique et slave ».
Un travail comparatif permettrait également de montrer comment la France importe, adapte ou rejette certaines images et de sortir du franco-centrisme. La France a longtemps eu une slavistique « littéraire » dominée par l’INALCO, le Collège de France (le poète polonais Adam Mickiewicz y occupant la première chaire de Langue et littérature slave) ou l’histoire culturelle, tandis que l’Allemagne a disposé plus tôt de centres beaucoup plus institutionnalisés.
L’ouvrage se conclut sur un diagnostic sans appel : « Les connaissances françaises de la Russie n’ont jamais vraiment pris leur distance avec l’exigence de la langue comme avec les lieux de sa préservation, les petites Russie, ou de sa transmission, l’université ». Face au nouvel enjeu de « décoloniser les études slaves », les auteurs affirment : « On ne travaillera plus sur la Russie comme avant ».
Aussi, l’apport de ce travail se mesurera peut-être moins à court terme qu’à sa fertilité dans la durée. En proposant une méthodologie rigoureuse, en mobilisant les outils des humanités numériques, en insistant sur les discontinuités et les recompositions rapides, Lépinay et Lezean offrent un modèle d’analyse applicable à d’autres aires culturelles. Leur enquête sur les « connaissances françaises de la Russie » constitue ainsi un travail véritablement pionnier, qui renouvelle en profondeur notre compréhension des mécanismes de production et de circulation des savoirs sur l’altérité.
Vincent A. Lépinay et Estelle Lezean, Connaissances françaises de la Russie. XIXe siècle - 24 février 2022, Paris, Presses de Sciences Po, 2025
Did you enjoy this article? close






