L’agenda 2030 est-il devenu l’alibi des autocraties? edit
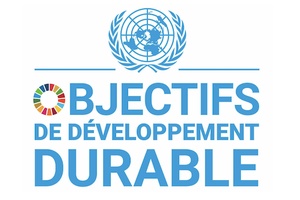
Les Objectifs du Millénaire du Développement, puis les Objectifs de Développement Durable (ODD) adoptés en 2015 avaient pour ambition d’unifier Nord et Sud autour d’un agenda commun. Ils rompaient avec la logique traditionnelle d’aide du Nord vers le Sud et affirmaient un esprit de coopération égalitaire, conforme à l’optimisme né de la chute du mur de Berlin : la démocratie paraissait irrésistible, le commerce, l’investissement et l’aide internationale devaient hâter son triomphe universel.
Utopie généreuse, certes, mais mobilisatrice. Elle autorisait à élaborer un agenda économique, social et environnemental partagé, malgré les dérives déjà visibles de certains régimes répressifs et la montée de l’intégrisme religieux.
De l’idéal d’une mondialisation heureuse au recul démocratique
Malgré des progrès économiques et sociaux indéniables, l’agenda 2030 n’a pas accompli la convergence espérée. Commerce, investissements et technologies n’ont pas rapproché les régimes : au contraire, ils ont parfois renforcé ceux qui s’opposent aux principes libéraux. Le numérique, loin d’approfondir la démocratie, a fragilisé nos institutions, brouillé la vérité factuelle et érodé la confiance civique.
La démocratie recule, y compris en Occident. Autocraties et intégrismes exploitent technologies et tensions sociales pour nous diviser. Le monde se réarme. Dans ce contexte, le langage flou des ODD, leur accumulation de chiffres et de slogans, entretiennent une confusion entre progrès réel et simple incantation.
Plus grave, ils placent sur un pied d’égalité avancées économiques, progrès environnementaux et respect des droits fondamentaux, occultant les pires répressions. Ainsi, la Chine peut se présenter comme championne des ODD tandis qu’elle écrase toute opposition, opprime Ouïghours et Tibétains et étouffe Hong Kong. Le « modèle » rwandais, fondé sur la répression, est valorisé malgré son incompatibilité avec les libertés fondamentales. Et les incohérences abondent : promouvoir l’égalité de genre tout en tolérant la burqa.
Certes, l’ODD 16 fait référence à la paix, à la justice et à des institutions efficaces. Mais il reste isolé, marginal, et transforme des droits fondamentaux en simples objectifs non contraignants, amoindrissant la force de la Déclaration universelle des droits de l'Homme.
Cette dépolitisation du développement durable interroge. L’agenda 2030 reste une boussole universelle utile, et ce d’autant plus que le Conseil de sécurité est aujourd’hui paralysé. Il structure l’action collective et rien ne semble en mesure de le remplacer. Mais peut-on ignorer qu’il masque parfois des violations graves des droits de l’Homme ? Pour préserver un consensus artificiel, ne fait-il pas des concessions dangereuses ?
Ces questions déjà cruciales le deviendront davantage encore à l’approche de 2030, lorsque se posera l’enjeu d’un nouvel agenda. La France et l’Europe devraient se préparer à ce débat, et éviter d’en laisser l’initiative à la Chine, à la Russie ou au « Sud global ». Une approche plus stratégique, plus politique, mais aussi plus humaine, est nécessaire. Car ce qui se joue derrière l’apparente neutralité technique des ODD, c’est un affrontement entre deux conceptions de l’homme : la dignité contre l’asservissement.
Faire de la démocratie le cœur d’un agenda renouvelé
Si l’on veut maintenir l’idée d’un agenda universel sans servir d’alibi aux autocraties, il faut recentrer le futur cadre sur la dignité humaine, dont la démocratie est la meilleure garante.
Cela oblige à réfléchir à l’idée même de développement. L’enrichissement matériel ne vaut que s’il contribue à la liberté et à la responsabilité des individus. L’économie doit être un moyen, non une fin. L’éducation, clé du développement, peut diffuser l’esprit critique mais aussi l’endoctrinement ; plusieurs régimes autoritaires affichent d’excellentes performances éducatives mises au service de la docilité.
La lutte contre la pauvreté dépend aussi de la démocratie : sans presse libre, liberté d’expression, syndicalisation, droit de vote, les pauvres sont démunis et vulnérables. Amartya Sen a montré que les famines sont rarement liées à la simple sous-production : elles prospèrent là où le pouvoir tyrannique empêche la transparence et la critique.
Environnement et démocratie sont également liés : les défenseurs de la nature sont persécutés dans les régimes oppressifs, et les régimes communistes ont illustré les dégâts causés par un pouvoir sans contrepoids. Lorsque l’idéologie prime sur la personne humaine, les mêmes dérives détruisent hommes et environnement.
Ainsi, liberté des élections, séparation des pouvoirs, liberté de la presse, indépendance de la justice et de l’université, libertés d’expression, de réunion, d’association, égalité entre les sexes devraient figurer au cœur du nouveau dispositif. Il s’agirait de passer du vague principe de « bonne gouvernance » à celui, plus exigeant, des conditions concrètes d’une véritable démocratie. L’aide à la démocratisation des institutions, encore marginale dans l’aide au développement, devrait devenir prioritaire pour l’Europe.
Deux obstacles majeurs se dressent. D’abord, la Charte des Nations unies ne mentionne pas la démocratie, afin de respecter la souveraineté des États. Mais la Déclaration universelle des droits de l'homme, complément indispensable de la Charte, en porte explicitement les principes, notamment l’article 21 sur la participation politique.
Ensuite, les adversaires de la démocratie dénonceront l’« arrogance » occidentale et invoqueront le passé colonial. Ce procès est inévitable, mais il ne doit pas dissuader l'action. Le soutien à la démocratie n’est pas une imposition culturelle : il répond à une aspiration universelle. Les peuples opprimés ne reprochent pas à l’Occident ses idéaux, mais ses incohérences.
L’accusation d’arrogance est d’ailleurs paradoxale : la démocratie n’affirme pas une vérité imposée, mais organise la tolérance, le dialogue et la limitation du pouvoir. Elle n’est pas l’idéologie du « Bien contre le Mal », mais un antidote au dogmatisme moral.
Même sans réforme des ODD, un effort diplomatique est indispensable pour contrer la montée du front autocratique, comme le souligne Anne Applebaum[1]. Le défi de ce siècle n’est pas le « choc des civilisations » qu’imaginait Samuel Huntington, mais la survie même de la démocratie, institution fragile, exigeante, vulnérable aux manipulations et aux dérives autoritaires. Ce combat doit se mener dans toutes les enceintes internationales, y compris dans celle du développement durable.
Comme le disait Raymond Aron en 1939 : « Je crois à la victoire finale des démocraties, mais à une condition : c’est qu’elles le veuillent[2]. » Cette volonté devrait nous inspirer aujourd’hui.
Did you enjoy this article? close




[1] Anne Appelbaum, Autocracy Inc. The Dictators who want to run the world, Penguin Random House, 2024.
[2] Raymond Aron, « États démocratiques et États totalitaires », communication présentée devant la Société française de philosophie le 17 juin 1939, réponse aux objections soulevées par Victor Basch. Publiée dans le Bulletin de la Société française de philosophie, 40e année, n° 2, avril-mai 1946, p. 41-51, et reproduite dans Raymond Aron, Paris, Éditions de L’Herne, 2022, p. 46.

