Une histoire du populisme edit
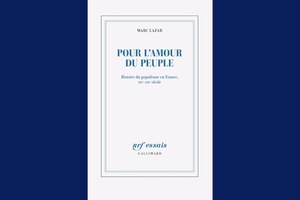
L’ouvrage que Marc Lazar consacre au phénomène politique du populisme en France est particulièrement bienvenu non seulement parce que ce phénomène a pris une dimension importante dans notre pays mais aussi parce que, plus généralement, il touche nombre de pays occidentaux, en Europe comme dans les Amériques, au point que l’avenir politique de ces pays paraît largement dépendant de sa réussite ou de son échec comme idéologie et comme mouvement politique. Après s’être attaché à cerner les traits principaux d’une notion qui demeurait très floue, l’auteur centre son ouvrage sur la France en distinguant les populismes du passé et ceux du présent. Estimant que le populisme travaille la société française depuis longtemps il examine d’abord successivement le boulangisme, choisi comme point de départ plutôt que le bonapartisme, les ligues des années 1930, le régime de Vichy, le poujadisme et les « pulsions populistes » de la gauche et du gaullisme. Il scrute ensuite ce qu’il nomme les néo-populismes contemporains : le populisme du Rassemblement national, celui de Jean-Luc Mélenchon et celui du mouvement des gilets jaunes.
Il ne s’agit pas d’une idéologie très structurée, ses nombreuses apparitions dans notre vie politique se présentant sous des aspects variés. Mais le populisme se caractérise, selon une définition que Lazar reprend à son compte, par un élément central et permanent : la vision d’une société qui se divise en deux camps homogènes et antagonistes, le peuple « pur » et l’élite « corrompue », et qui affirme dans le même temps que la politique devrait être l’expression de la « volonté générale ». Lazar, en auscultant le passé, recherche la présence de ce trait principal dans d’autres idéologies, fascisme, post-fascisme, autoritarisme, totalitarisme mais aussi, aujourd’hui, dans le national-populisme de droite du Rassemblement national, dans le populisme de gauche de Jean-Luc Mélenchon, et dans les Gilets jaunes, idéologies plus ou moins mâtinées de populisme.
L’auteur ne limite pas le populisme à une idéologie. Il estime, à juste titre, qu’il s’agit également d’une stratégie de conquête du pouvoir utilisée par des leaders et des partis politiques, insistant sur le rôle fondamental du leader plébiscitaire et charismatique qui prétend incarner la souveraineté du peuple et s’attache à mobiliser les foules autour de lui. « Reste alors, écrit Marc Lazar, à élucider le rapport que les populistes ont entretenu dans le passé et qu’ils entretiennent de nos jours avec la démocratie libérale et représentative. Ils se méfient de la représentation qu’ils critiquent durement voire rejettent totalement parce que selon eux elle instaure une classe dirigeante qui prétend représenter la volonté populaire alors qu’ils privilégient l’incarnation de cette même volonté dans la personne du chef. » Ce faisant, il aborde la question, que l’on peut juger centrale aujourd’hui, du populisme comme stratégie politique et institutionnelle et, plus précisément, celle de son rapport à la démocratie libérale.
La France et les États-Unis, pour se limiter à ces deux pays, ont été gouvernés depuis fort longtemps par des régimes de démocratie libérale. Ces régimes se caractérisent par une alternance au pouvoir de partis qui, au nom de leur acceptation commune du compromis, ne se considèrent pas les uns les autres comme des ennemis à détruire mais comme des adversaires à vaincre au moyen d’une victoire électorale. Ces régimes obéissent à la vision de Montesquieu selon laquelle, afin que le pouvoir soit toujours en mesure d’arrêter le pouvoir, il est nécessaire que des contre-pouvoirs existent et agissent pour d’éviter la survenue d’un régime despotique qui entraînerait la suppression des libertés. Or, qu’il s’agisse du parti trumpiste aux États-Unis ou du Rassemblement national et de LFI en France, l’appel à un peuple légitime pour chasser les élites illégitimes risque fort, c’est déjà le cas aux États-Unis, de transformer les adversaires en ennemis et d’introduire la violence dans les rapports politiques. Quant à leur préférence commune pour un pouvoir personnel affirmé, elle risque d’amener les leaders et ces partis à neutraliser, voire à supprimer, les contre-pouvoirs, qu’il s’agisse du pouvoir parlementaire, du pouvoir judiciaire, de la liberté de la presse ou des libertés universitaires. Certes, pour l’instant, ces partis se réclament toujours de la démocratie et des élections libres (encore que Trump ait montré lors de sa défaite de 2020 qu’il était prêt à inverser le sens des résultats électoraux) mais il apparaît néanmoins que c’est la démocratie libérale elle-même qui est en question aujourd’hui.
Ce régime, intrinsèquement fragile car toujours dépendant de la volonté commune des acteurs politiques à en respecter les règles de fonctionnement, notamment en acceptant de perdre les élections, est aujourd’hui particulièrement affaibli car devenu illégitime aux yeux d’une large partie des citoyens. Or la démocratie libérale repose sur un équilibre entre le pouvoir du peuple et celui des élites, entendu au sens des Grecs, les aristoi. Comme l’a montré Bernard Manin, la disparition de l’aristocratie avait été compensée par la création et le développement de partis politiques formant une nouvelle classe politique, élue par le peuple mais chargée de le représenter et de le diriger. Pour des raisons qu’il n’est pas possible de développer dans le cadre de ce texte, ces partis, en accord entre eux pour jouer le jeu de la démocratie représentative, sont aujourd’hui très affaiblis ou pénétrés ou concurrencés par des partis qui en critiquent la nature même de ce régime et proposent des transformations profondes de son fonctionnement.
C’est le cas en France de LFI et du RN qui, sur ce point, se rejoignent dans la suspicion des représentants élus au Parlement et par leurs propositions récurrentes de « redonner la parole au peuple » en multipliant les référendums d’initiative populaire et même, pour LFI, en donnant au « peuple » le pouvoir de révoquer ses représentants. On sait comment en 1793, ce pouvoir a débouché dans son application sur la dictature robespierriste. Qui d’autre que les représentants pourrait exprimer la « volonté du peuple » sinon un dictateur puisque cette « volonté générale », qui n’existe pas dans un peuple réel, naturellement divisé, ne peut être qu’inventée par un parti unique ou un despote. La question posée est alors de savoir si nos démocraties libérales survivraient de telles transformations et pourraient empêcher, ainsi réduites, leur remplacement par des régimes autoritaires. Certes, le danger semble aujourd’hui plus important aux États-Unis qu’en France, pays que Marc Lazar ne traite pas ici, mais son ouvrage nous donne les clés pour observer et comprendre les évolutions de notre système politique et des idéologies qui y nourrissent les mouvements populistes.
L’auteur le souligne à juste titre, la question du populisme est bien aujourd’hui une question centrale que les partisans de la démocratie libérale doivent prendre très au sérieux. Si l’idéologie populiste oppose un peuple sain à des élites corrompues, un régime populiste opposerait plutôt les anciennes élites libérales à de nouvelles élites autoritaires ; une opposition qui ne serait pas pratiquée de la même manière que celle qui oppose les élites libérales entre elles.
Marc Lazar, Pour l’amour du peuple. Histoire du populisme en France, Gallimard, 2025, 308 pages.
Did you enjoy this article? close






