Le roman biographique d’un sociologue «hors-classe» edit
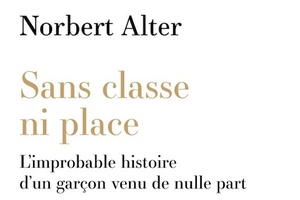
En 1977, un fils d’ouvrier non qualifié avait 5% de chance de venir cadre ou d’exercer une profession intellectuelle (8% en 2019). Quel pouvait être alors le taux de chance pour devenir professeur d’université d’un « sans classe, ni place », originaire d’une famille tellement pauvre et désocialisée (mère femme de ménage intermittente, père petit escroc habitué de la prison) que Norbert Alter ne trouve pas d’autre formule pour se présenter[1] ? Proche de zéro, probablement. Quand un sociologue use de son regard aiguisé pour dépeindre son milieu, comme l’a fait Richard Hoggart sur la classe ouvrière anglaise des années 1950, et tente de comprendre son improbable itinéraire, cela sonne juste. Et cela sonne d’autant plus juste qu’en rupture avec l’abstraction sociologique Norbert Alter se risque à un récit subjectif qui dépeint avec finesse les situations vécues durant son enfance et son adolescence, et qu’il va loin dans l’exploration intime.
Son épopée est racontée par un « ami » auquel le personnage principal, Pierre (donc lui-même), se confie et à qui il fait visiter, au fil d’un road-movie, les lieux symboliques de sa jeunesse. Ce choix narratif transforme son récit en un presque roman – à l’instar du livre Basse classe – de la romancière Kerry Hudson, recensé dans Telos[2].
Les affres de l’anomie
La mobilité ascendante ne se profile pas dans l’horizon de l’enfant que décrit Norbert Alter tant sa famille fonctionne hors normes : « La famille de Pierre, faute de discipline sociale, ne dispose d’aucun capital, même moral. Elle ne parvient pas à constituer de butin aussi maigre soit-il qui permet de dire que l’on occupe une place, que l’on fait partie d’une classe. » Au fond il aimerait bien appartenir aux milieux populaires, unis par des solidarités interpersonnelles et des habitudes, il désire pouvoir se lover dans une conformité sociale, comme ses camarades d’école. Subissant une précarité immuable (logements toujours provisoires, jamais rangés ou arrangés), son aspiration la plus profonde est d’habiter une vraie maison – symbolisée par des fenêtres avec rideaux, qui permettent de s’abriter des regards extérieurs, de créer une chaude intimité.
Enfant unique d’un couple qui se chamaille, qui pratique la violence à l’occasion, et dont chaque membre est absorbé par des difficultés de tous ordres, il rêve d’une vraie maisonnée, des proches unis par des liens affectifs dont les vies se coordonnent et s’emboitent les unes aux autres, comme son copain Antonio entouré d’une fratrie de dix enfants, qui l’accueille souvent pour la nuit. Dans l’univers de l’enfance malheureuse, on se projette peu, chaque jour est un nouveau défi, on tente de survivre psychologiquement, on se compare amèrement aux autres, mais sans espoir de quoi que ce soit. Marx, cité par Pierre, décrit ainsi le lumpenprolétariat auquel il appartient : « produit passif de la pourriture des couches inférieures ».
L’école comme foyer
La vraie maison de Pierre, c’est l’école qui d’emblée lui procure un confort mental car c’est un monde bien réglé : « il découvre que l’autorité peut être exercée et subie avec distance : elle n’a pas toujours pour fonction d’obtenir quelque chose de précis, mais de rappeler l’existence des rôles, des obligations réciproques ». De surcroit sa condition d’élève, partagée avec d’autres pour beaucoup d’activités différentes, lui permet de se sentir membre d’un collectif. L’école évoque donc pour Pierre « la douceur des journées », alors que comme le pointe l’universitaire qu’il est devenu plus tard « il devrait pourtant avoir été blessé par ce que les sociologues nomment pompeusement « la violence symbolique de l’école, la propension des classes dominantes à imposer leur culture aux «dominés», en méprisant leurs «habitus» à travers les programmes scolaires ».
Or l’école est la première institution qui lui octroie une place, un bien être, un peu de sens : « Le regard de ses maitres lui donnent la certitude de bien faire, de pouvoir respecter ce qu’il fait, ce qu’il est, d’en être fier ». Bon élève dans le primaire, il sombre au collège, n’arrive plus à se concentrer, part à l’école en vomissant tant il a le sentiment que le peu de maitrise qu’il avait acquis sur sa vie s’échappe. À cette époque, il traverse un événement traumatisant : sa mère « décide de refaire sa vie » , et sans aucun discernement à l’égard de l’adolescent qu’il est, le met dans la situation de spectateur et parfois participant de ses ébats avec son nouvel amoureux. Une mère aimante, presqu’incestueuse, incapable de poser des limites à ses débordements : des décennies plus tard, il trébuche sur les termes pour dépeindre sa génitrice. Il redouble, traverse une période de semi-délinquance, et mettra des années pour remonter la pente, à coups d’efforts solitaires et à l’aide de dictionnaires et d’astuces pour capitaliser une culture adaptée à son histoire, « une culture qui fertilise ce qu’il est ». Aspect notable : l’institution scolaire tient compte compte de sa situation familiale, qu’elle entr’aperçoit plutôt qu’elle n’en connaît la teneur réelle, l’encourage tout en fermant les yeux sur ses absences et ses lacunes. Pourtant sa situation est tellement atypique qu’il ne bénéficie pas des mesures d’aide allouées aux enfants en souffrance sociale.
À partir de 1’âge de 14 ans, il s’éloigne de sa mère, habite à droite et à gauche (parfois dans une voiture) et commence à travailler pendant toutes les vacances comme commis à tout faire dans un grand hôtel ; deux ans plus tard il entame un parcours dans la limonade (commis-caviste, garçon de comptoir, garçon de salle). Ayant obtenu son bac, ce qui est en soi un exploit pour l’époque (en 1964, 18% des jeunes présentent et bac et 11% le réussissent), il s’inscrit comme étudiant en histoire. Boursier enfin, il assure ses fins de mois grâce à un emploi de déménageur. Sa longue expérience dans des travaux physiquement harassants assortis d’horaires à rallonges lui permet d’enrichir sa biographie de récits sur le monde du travail et de l’exploitation. Et ce, sur des métiers ayant rarement été explorés de l’intérieur.
L’homme qui était écouté par les femmes
S’il est un domaine sur lequel ne s’aventure pas en général un universitaire, c’est bien son intimité amoureuse. Or pour rendre compte de son parcours, Pierre donne toute sa part aux rencontres et passions adolescentes, qui opèrent comme catalyseur de sa sortie de route vers « une autre vie ». Ces jeunes filles, puis jeunes femmes l’aideront à s’exprimer (notamment il leur parlera de la prison et des visites au parloir quand il va voir son père), elles colmateront ses fêlures, lui donneront espoir. Plus : comme dans les romans de Nicolas Mathieu, c’est par des relations avec des teenagers issues de milieux bourgeois ou semi-bourgeois que passe son éducation sentimentale. Elles lui présentent une sorte d’idéal féminin, où le genre est associé à une certaine plénitude : « les plus attirantes semblent dire, simplement par leur physionomie et leur gestuelle : je suis heureuse d’être une femme, je vous montre le bonheur que j’en tire ». Il y découvre un univers social plus doux, plus ouvert que le sien, un monde culturellement en train de changer : « Les lycéennes d’Ivry correspondent bien plus « aux petites bourgeoises, consacrées par le langage de mai 68. Elles se baladent dans une sorte d’entre-deux social qui les rend à la fois différentes et accessibles. Elles portent des vêtements à la mode, qui les mettent en valeur et les associent à la belle marche de la société de croissance ; elles vont parfois aux sports d’hiver et en reviennent bronzées (…), elles parviennent à penser le monde à partir d’un poème, d’un tableau ou de chansons. Elles font de la culture savante leur propre culture ; en écoutant Joan Baez, elles parlent de l’engagement ». Il constate aussi que dans ces familles l’adolescence peut aussi être abimée par des carences affectives et de l’incompréhension.
Transclasse : le succès d’une formule magique
Pierre est un vrai transclasse, non seulement par le saut professionnel qu’il effectue par rapport à son père (en 2015, selon l’INSEE, 28% des hommes occupent un emploi d’un niveau supérieur par rapport à celui leur père), mais surtout par l’incroyable distance sociale parcourue. S’il ne tournait pas lui-même délinquant ou marginal, il avait plus de chances de devenir ouvrier (il n’aurait pas passé le bac) ou cadre moyen (issue possible au bac dans les années 60). Or non seulement il a réussi à trouver une place, mais il a grimpé radicalement dans l’échelle des qualifications, des revenus et des statuts.
Certes, parlant de son enfance, il évoque comme beaucoup de transclasses la honte et la détresse ressenties en se comparant aux autres. Mais il a aussi à cœur de désigner les circonstances favorables et les rencontres, ces personnes bonnes fées, qui l’ont aidé à sortir de son contexte de naissance. « On ne prend pas place dans la société comme un voyageur s’assoit sur la banquette du métro. On a envie de faire société, de construire un espace et des liens qui nous donnent le sentiment d’être un humain reconnu comme tel ». Il s’emploie à faire la part entre les ressorts personnels et les personnes qui lui ont permis de se construire un destin, d’une part, et les déterminismes sociaux, de l’autre : « La traversée d’une vie ne résulte pas de l’exclusive soumission aux grands déterminismes sociaux, pas plus qu’à un individualisme étroitement calculateur ». La coopération humaine, le don contre-don à l’œuvre dans les rapports sociaux, y compris dans l’économie, figure d’ailleurs comme un point original qu’il a exploré dans ses travaux de sociologue des organisations[3].
Quoique doucement intégré aujourd’hui à la bourgeoisie culturelle, il demeure « subjectivement extérieur à ce milieu », et vivement sensible à la différence, souligne-t-il, un sujet qu’il a décliné dans son livre La Force de la différence[4]. Cette acuité à la différence est à l’évidence un atout pour exercer son métier.
Did you enjoy this article? close




[1] Norbert Alter, Sans classe, ni place, PUF, 2022.
[2] Monique Dagnaud, « Enfance et pauvreté déshumanisante », Telos, 19 février 2020.
[3] « Théorie de don et sociologie du monde du travail », Revue du Mauss, 2002, 02. Norbert Alter : « Mobiliser la théorie du don pour analyser la nature des rapports sociaux caractérisant le monde du travail a bien évidemment quelque chose de paradoxal : tous les bons manuels de gestion expliquent que l’entreprise est un lieu de profit, de calcul utilitariste, de praxis de la théorie économique standard. Ce paradoxe ne vaut cependant qu’à la condition de confondre la théorie du don avec une théorie de l’altruisme, alors qu’elle est, bien plus largement, une théorie de l’échange social, lequel intègre la question de l’intérêt, et celle de la violence. Ce paradoxe ne vaut également qu’à la condition de croire que la théorie économique standard reflète parfaitement les pratiques des acteurs, alors que toutes les observations menées par la sociologie du monde du travail montrent que l’efficacité de la firme suppose une capacité à coopérer et que la coopération est toujours un échange social.».
[4] Norbert Alter, La Force de la différence. Itinéraires de patrons atypiques, PUF, 2012.


