Monique Canto-Sperber et le républicanisme libéral edit
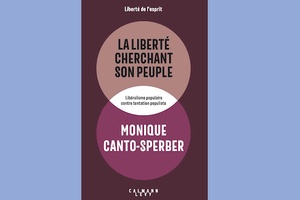
Monique Canto-Sperber poursuit de livre en livre sa réflexion sur le sens de la liberté dans les sociétés démocratiques. D’une part, elle montre l’existence d’un courant libéral à l’intérieur de la pensée socialiste, selon ses termes, l’« orientation libérale au sein du socialisme ». D’autre part, elle argumente en faveur d’un libéralisme attentif aux personnes, aux cas et aux destins particuliers. Elle s’inscrit ainsi dans la réflexion philosophique sur la dialectique de la liberté et de l’égalité propre aux sociétés démocratiques modernes. Elle analyse et prône le « républicanisme libéral » qui a nourri la démocratie sociale, la sécurité sociale, l’éducation nationale, la santé publique, la fiscalité progressive et elle en vante les bénéfices sur l’activité économique.
Le premier chapitre expose en termes clairs la définition opératoire qu’elle propose à la suite d’une lecture rapidement exposée des théories philosophiques de la liberté, d’Aristote à Isaiah Berlin, soulignant au passage qu’il n’existe pas d’opposition entre les libertés « formelles » et les libertés « réelles », les premières étant la condition d’existence des secondes.
À partir de ce fondement philosophique, elle aborde un certain nombre de débats actuels à la lumière de sa définition de la liberté en tant que possibilité de maîtriser son destin. Ce qui, pour elle, fait le caractère libéral d’une politique, ce n’est pas seulement son contenu, mais la manière dont elle permet à chaque individu de faire l’expérience de la responsabilité de soi, c’est-à-dire de pouvoir concrètement prendre les décisions qui le concerne dans l’orientation de son propre vie (choix de l’âge de départ en retraite, choix d’une filière de formation, etc.), plutôt que de devoir se conformer à une règle que l’État leur impose. L’auteur entend démontrer par des exemples choisis dans l’actualité que le libéralisme en ce sens est une condition nécessaire pour évaluer et légitimer les politiques publiques.
Pour ce faire, elle traite, entre autres, du wokisme, des politiques contre la pauvreté (en particulier des étudiants pauvres), de la retraite, du système d’enseignement (sur lequel elle avait déjà écrit un livre), des ambigüités de la politique contre le réchauffement climatique, du mode de scrutin et des tentatives de ranimer la flamme de la citoyenneté, des menaces contre la vie privée par les nouvelles techniques de surveillance par Internet.
Elle poursuit à la lumière de la vocation de la liberté ainsi définie des analyses portées par d’autres auteurs contre le dévoiement du principe d’égalité dans les différents courants qu’on peut réunir sous le terme de wokisme. Elle constate qu’ils ont pour effet d’aboutir à une orthodoxie de pensée constituant le seul corpus d’idées admissibles, à un conformisme fait de valeurs morales incontestables (le projet d’égalité), mais qui, appliquées aux questions d’identité et de genre, sont affirmées d’une façon dogmatique qui exclue toute nuance et toute prise en compte des conditions sociales particulières. Plusieurs siècles de réflexion qui ont permis la libération de la pensée sont niés par cette nouvelle orthodoxie de la pensée.
La liberté de pensée est en effet au cœur de sa réflexion et elle l’adopte en tant que critère essentiel dans ses analyses des débats du moment. S’agissant des politiques contre la pauvreté, il importe qu’elles puissent donner aux plus pauvres un soutien qui leur permet de bénéficier, en dépit de leur condition, de marges d’action. La politique contre la pauvreté doit ainsi reposer non seulement sur l’aspiration à l’égalité, mais sur la liberté.
Si le libéralisme économique est une condition nécessaire de la liberté, il n’est pas suffisant. Sur les retraites, Monique Canto-Sperber argumente en faveur de la prise en compte des cas particuliers et des destins divers. C’est pourquoi à la fixation de la retraite à un âge précis elle préfère la prise en compte du nombre d’années de travail. Ainsi seraient mieux actées les différences de fatigue au travail, les carrières des femmes souvent hachées en raison des maternités et les carrières longues qui concernent les plus modestes entrés jeunes sur le marché du travail.
Ella aborde longuement le cas des jeunes mal diplômés et leur vote pour les partis extrémistes et serait favorable à l’instauration d’un revenu étudiant qui donnerait aux plus modestes socialement la liberté d’apprendre. De façon générale, le sens de l’École doit être de contribuer à la liberté, qui est aussi condition de la croissance et de la mobilité sociale. L’École, à tous les niveaux, n’a pas su se réformer pour faire face à la massification de la fréquentation scolaire et il importerait, pour lutter contre les excès du pédagogisme et contre les revendications identitaires, d’accorder plus d’autonomie aux établissements et plus d’initiatives pédagogiques aux enseignants. Pour définir clairement les buts de l’École, il faudrait revoir la formation des enseignants.
Dans cette analyse de la modernité à partir de l’idée de la liberté, on ne sera pas surpris de lire le chapitre consacré aux menaces liées aux nouvelles techniques de surveillance. Nous laissons continuellement des traces de toutes nos activités et toutes nos démarches sur la Toile. Comment préserver sa vie privée, condition de sa liberté ? L’addiction aux écrans n’est-elle pas une nouvelle forme de « soumission volontaire » ? Si l’on imagine la survenue d’un régime moins démocratique que le nôtre, ses dirigeants disposeront de moyens de contrôle techniques comparables à ceux des Chinois.
L’auteur relit les termes des débats actuels du moment à la lumière de l’idée libérale qui permet d’en saisir les véritables enjeux qui sont politiques sans dissimuler ses convictions et ses choix. Cette conception de la liberté n’est-elle pas d’ailleurs une manière plus savante et plus théorique – à partir de la tradition philosophique – de renouveler l’inspiration des politiques publiques qui sont à l’origine, sous diverses formes concrètes, des politiques menées dans les nations européennes de la social-démocratie ? Les militants et les penseurs des partis de gauche qui semblent aujourd’hui négliger la réflexion « lente et profonde » (Tocqueville) auraient tout intérêt à lire cet ouvrage.
Monique Canto-Sperber, La Liberté cherchant son peuple. Libéralisme populaire contre tentation populiste, Paris, Calmann-Lévy, coll. « Liberté de l’esprit », 2025.
Did you enjoy this article? close






