Quotas genrés: une mauvaise réponse à une question mal posée edit
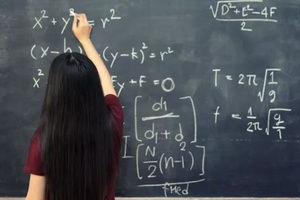
La France a besoin d’ingénieurs mais le niveau des élèves en mathématiques ne cesse de se dégrader : voilà un problème majeur auquel devrait aujourd’hui s’atteler un ministre de l’Éducation nationale ambitieux. Elisabeth Borne s’est décidée à aborder le sujet, mais par le petit bout de la lorgnette, celui du genre. Son approche du problème conduit tout droit à la proposition de quotas genrés dans les classes préparatoires scientifiques, une mesure qui vise moins à accroître le nombre des candidats aux études scientifiques qu’à modifier la proportion de filles et des garçons parmi eux. Trois critiques, morale, politique et épistémologique, peuvent être adressées à cette proposition.
La critique morale est la plus évidente. Une sélection (examen, concours, etc.), pour être juste, doit s'opérer sans distinction de race, de sexe ou d'origine. Les « progressistes » qui s'opposent à la « préférence nationale » devraient y réfléchir à deux fois : il n'est peut-être pas bien malin par les temps qui courent de banaliser la transgression des principes républicains. Elisabeth Borne ne propose rien de moins que l’institution d’un authentique sexisme d’État. Elle propose de s'asseoir sur le principe de l'égalité en droits afin d'instituer une discrimination objectivement sexiste, qui vise à empêcher des garçons motivés de devenir ingénieur pour les remplacer par des filles qui n’ont rien demandé. Si on voulait encourager le masculinisme en France, on ne s’y prendrait pas autrement.
D'un point de vue politique, une critique de gauche et une critique de droite sont également possibles. Si l'on considère que la priorité de la gauche est la lutte contre les inégalités sociales, force est de constater que le combat de madame Borne n'est pas le bon. En matière d'inégalités scolaires, l'inégalité hommes/femmes est dérisoire ; l'inégalité joue qui plus est, contrairement à ce qu'affirment les féministes, en faveur des filles et en défaveur des garçons. Comme tout professeur le sait, et comme le confirme depuis les années 2000 l'enquête internationale PISA, l'inégalité scolaire la plus criante en France est l'inégalité sociale, inégalité qui est à la fois économique, culturelle et territoriale. L'écart entre les privilégiés et les plus défavorisés tend en outre à s’accentuer, ce dont notre ministre, manifestement, n’a cure.
La critique de droite dénonce l'incapacité du système éducatif à répondre aux besoins de la nation. La France a aujourd'hui besoin de former davantage de médecins et d'ingénieurs ; le fait qu'il y ait davantage de femmes chez les médecins et davantage d'hommes chez les ingénieurs n'est à cet égard pas franchement le sujet. Le vrai sujet est que le système éducatif n'est plus au niveau. L’enquête internationale TIMSS, qui évalue le niveau des élèves en fin de primaire, montre que la France est le cancre de la classe européenne en matière d'enseignement des mathématiques. Ce n'est certainement pas avec une formation des professeurs à la « sensibilisation aux stéréotypes de genre » que l’on remédiera à cette situation.
La critique épistémologique est cependant à mes yeux la plus importante, car elle dévoile la manipulation idéologique et les mensonges par omission auxquels se livre Elisabeth Borne. Avant de pouvoir traiter comme il convient les véritables problèmes, et pour pouvoir le faire, il est nécessaire de se débarrasser de l'idéologie qui prétend imposer des solutions délirantes à des problèmes fictifs et controuvés. Il se trouve que le ministère de l’Éducation nationale est depuis quelques années tellement obsédé par « le genre », qu'il multiplie les statistiques sur le sujet. On croule sous les informations, disponibles sur le site du ministère. Bizarrement, mais c'est à cela que l'on peut mesurer le travail de l'idéologie, les faits les mieux établis réfutent l'interprétation qu'en donne le ministère : le ministère de l’Éducation nationale entretient en effet la propagation dans les médias de thèses féministes que ses propres statistiques démentent.
La thèse générale est celle du caractère systémique de la domination masculine, domination qui se réfracterait dans les pratiques et les résultats scolaires. Or rien n'est plus faux. Notre baromètre national est le Baccalauréat : si l'on considère une génération, 84% des filles obtiennent le Bac, contre seulement 75% des garçons. Cet écart est non négligeable, de sorte que s'il fallait diagnostiquer une discrimination scolaire systémique, il conviendrait plutôt d'admettre l'existence d’une domination des filles aux dépens des garçons.
Les experts-militants qui soutiennent cette thèse sont donc contraint d’ajouter une thèse ad hoc : les filles ont certes de meilleurs résultats, mais elles s'autocensurent, manquent de confiance en elle, manquent d'ambition, etc. En matière de stéréotypes sexistes, on ne saurait mieux faire ! Fort heureusement, en matières d’études supérieures, c'est faux. En réalité, les filles sont majoritaires dans les filières d’excellence : 27% des jeunes femmes et 21% des jeunes hommes sortant de formation initiale (en moyenne, en 2020, 2021 et 2022) ont obtenu un diplôme correspondant à un master, un doctorat, une école d’ingénieur ou une école de commerce.
Il ne reste aux féministes qu’un os à ronger, ce à quoi s’emploie notre ministre : les filles – c’est exact – restent minoritaires dans les écoles d'ingénieurs. Puisque les filles sont majoritaires dans les filières d'excellence, elles ne peuvent toutefois être minoritaires dans les écoles d’ingénieurs et les formations apparentées que parce qu'elles sont majoritaires dans toutes les autres filières. Notamment dans les études de médecine, que choisissent prioritairement les filles qui excellent dans les disciplines scientifiques. Cette donnée n'a pu échapper à notre ministre polytechnicienne ; en l’occultant, elle trahit son biais idéologique et sexiste. Si le ministère souhaitait réellement procéder à un rééquilibrage et contraindre les orientations en fonction du critère de genre de manière juste, il lui faudrait imposer des quotas dans toutes les filières d’excellence.
Cela dit, une mesure de contre-discrimination pourrait se justifier si l'on pouvait établir l'existence d'une discrimination sexiste à l'entrée des CPGE scientifiques. Or une telle discrimination n'existe pas. Le moment de l'orientation sur Parcoursup est aujourd'hui étudié de près. Une note d’information du ministère[1] est forcée de le reconnaître : « Les filles, à niveau équivalent, reçoivent un peu plus souvent des propositions d’admission de la part des établissements de ces filières [les filières scientifiques sélectives] que les garçons » ; le problème étant qu'elles déclinent tendanciellement plus souvent que les garçons lesdites propositions.
La sous-représentation des filles dans certaines filières scientifiques sélectives s'explique aisément par deux facteurs. Le premier, général, est une différence d'aptitudes universellement observée (dans les moyennes statistiques), et qui apparaît dès les premières années de la scolarité, entre les filles et les garçons : les filles sont en moyenne supérieures dans la maîtrise de la langue, les garçons, dans le domaine des mathématiques. Mais cet écart de niveau n'est pas tel qu'il puisse à lui seul expliquer la surreprésentation des garçons dans les écoles d'ingénieurs. Le second facteur, plus déterminant, tient aux choix d’orientation.
De fait, on observe la différence du choix de l'orientation dès la classe de première, au moment du choix des spécialités. La composition des spécialités scientifiques est à cet égard parlante. En terminale, les filles représentent 66% des élèves qui ont choisi la combinaison « Physique-chimie/SVT » ; elles sont 38% parmi les élèves ayant choisi la combinaison « Physique-chimie/Mathématiques ». On est encore au lycée, de sorte que le pauvre argument selon lequel les filles seraient effrayées par le manque de mixité ne tient pas !
Le choix s'explique dans une certaine mesure par le niveau en mathématiques, mais aussi, bien sûr, par l'anticipation des études supérieures visées. Les garçons sont plus nombreux – à niveaux scolaire et social équivalent – à ambitionner d'intégrer une filière scientifique sélective ; les filles, plus nombreuses à être attirées par le PASS (Parcours accès santé spécifique). Si l'objectif du ministère était de neutraliser les préférences subjectives pour imposer la parité dans les orientations, il lui faudrait commencer par imposer des quotas dans les spécialités au lycée, limitant ainsi, ce qui est une conséquence nécessaire, la liberté de choix. On pourrait ainsi mesurer la popularité réelle de la théorie féministe selon laquelle les filles s’autocensurent parce qu’elles sont victimes des stéréotypes de genre inconscients.
Une fois le bon diagnostic établi, il devient possible de mesurer les limites de la proposition d’Elisabeth Borne. Le ministère dispose de deux moyens, de deux moyens seulement, s'il veut modifier l'ordre des choses. Le premier est de rendre l'enseignement des mathématiques plus performant, pour les filles comme pour les garçons (à moins que l'on ne pousse l'égalitarisme jusqu'à vouloir empêcher les garçons de progresser en même temps que les filles). On n'en prend pas le chemin, c'est le moins que l'on puisse dire, le ministère ne parvenant plus à recruter des professeurs de mathématiques au niveau.
Le second moyen est la restructuration de l’offre de formation. Le ministère pourrait par exemple, s’il le juge utile, supprimer au lycée certaines spécialités, augmenter la capacité des spécialités scientifiques, imposer certaines combinaisons de spécialités ou revenir à l’ancienne filière scientifique. Si l’objectif est d’inciter les lycéens à choisir certaines filières (les formations STEM) plutôt que d’autres, il faudrait ouvrir ou fermer des places en fonction des exigences. De telles mesures conduiraient sans aucun doute les filles à s’orienter plus nombreuses vers les filières scientifiques.
Bref, plutôt que de se lancer dans l’idéologie paritariste, le ministère de l’Éducation serait mieux inspiré de se focaliser sur la première de ses missions, qu’il remplit de plus en plus mal, à savoir former les filles et les garçons, sans discrimination, de manière à leur permettre de s’engager dans des études supérieures fécondes. Il faudrait pour cela renoncer à la confusion idéologique entre, d’une part, l’ambition rationnelle d’augmenter le nombre de femmes ingénieurs et, d’autre part, l’objectif sexiste qui consiste à vouloir, au moyen de la discrimination positive, augmenter la part des femmes parmi les ingénieurs, aux dépens de celle des hommes.
Did you enjoy this article? close




[1] Note d’information n°24.20 – Mai 2024, Les différences d’orientation entre les filles et les garçons à l’entrée de l’enseignement supérieur.

