Européennes: l’inévitable hystérie? edit
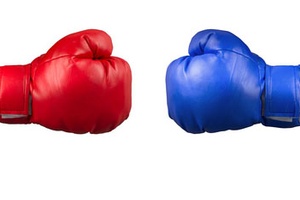
La campagne des élections européennes a commencé le 28 août à Milan. Il serait plus juste de parler de bataille, déclenchée par une canonnade de Viktor Orban contre Emmanuel Macron. Il y a « actuellement deux camps en Europe », lance le Premier ministre hongrois. Dans un camp, lui et le ministre italien de l’Intérieur Matteo Salvini commandent les forces voulant « arrêter l’immigration illégale ». En face, le camp ennemi « dirigé par Macron, à la tête des forces politiques qui soutiennent l’immigration ».
Dès le lendemain, depuis Copenhague, Emmanuel Macron réplique : « Ils ont raison ». Le défi est accepté.
« Eux » et « nous »
Cette confusion du champ politique avec un champ de bataille n’est pas nouvelle. Elle est la marque des mouvements nationalistes : le parti se confond avec la nation, et puisque l’intérêt national ne souffre pas le compromis, tout opposant politique devient un ennemi à détruire.
Un compatriote de Viktor Orban, Istvan Bibo, a décrit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale ces rhétoriques guerrières sous la forme d’ « hystéries politiques » ou « communautaires » (1). Son propos était d’analyser pourquoi l’Allemagne avait, de Bismarck à Hitler, entraîné l’Europe dans la guerre. Réfutant les explications essentialistes, Istvan Bibo pointait des événements historiques, ici « le processus douloureux et tumultueux de la naissance des nations modernes », en premier lieu de la nation allemande, qui peuvent « déformer l’attitude psychique de peuples entiers ».
L’hystérie politique, expliquait le politologue hongrois, résulte ainsi d’« états durables de peur collective qui s’emparent des masses à la suite de grands traumatismes historiques ». Ses symptômes sont « la méconnaissance de la réalité par la communauté, son incapacité à résoudre les problèmes posés par la vie, l’incertitude ou l’hypertrophie de l’évaluation de soi-même, les réactions irréalistes et disproportionnées aux influences du monde environnant ». La communauté hystérique est alors portée à « chercher quelqu’un ou un groupe d’individus sur qui elle puisse faire retomber ses propres responsabilités. » Elle ne cesse d’agresser le monde environnant, finissant par « susciter effectivement les sentiments et intentions hostiles dont elle avait imaginé l’existence ».
Le processus douloureux de la naissance des nations modernes pointé par Istvan Bibo continue aujourd’hui de produire ses effets. Car il a été prolongé par la construction européenne et la mondialisation des économies, un changement d’échelle qui tend par réaction à réactiver les aspirations d’identités nationales. Et il a été récemment exacerbé par la crise financière et la crise migratoire, sur fond de terrorisme islamiste.
Ces traumatismes sont réels. L’hystérie politique apparaît avec l’usage qu’en font Matteo Salvini, Viktor Orban et leurs épigones. Il y entre d’ailleurs souvent une forte part de cynisme. Donald Trump en témoigne, lorsqu’il doit répondre de ses violentes diatribes contre les Démocrates et les médias, désignés en « ennemis du peuple » : « Mes supporteurs m’aiment pour cela », constate le président américain, ajoutant « je ne serais pas ici (à la Maison-Blanche) si je n’avais pas fait ça » (2).
Et c’est ainsi que prospère l’hystérie politique. Aux États-Unis avec Donald Trump, qui fantasme le monde entier en prédateur des Américains. En Allemagne avec l’AfD, ennemie de l’euro puis des migrants. Au Brésil avec Jair Bolsonaro, qui se vante de « purger les rouges » du Parti des Travailleurs. En France, où La France insoumise et le Rassemblement national se retrouvent dans l’exaltation du peuple face aux élites mondialisées… Elle produit partout les mêmes effets, transformant le débat démocratique en une bataille sans merci, réduisant la diversité du champ politique en un affrontement manichéen entre « eux » et « nous ».
Macron, le pacte de Faust
La nouveauté est que l’hystérique trouve à lui répondre, dans un registre parfois proche, avec Emmanuel Macron. Le rapprochement du président français de la catégorie de l’hystérie politique, aux côtés (ou en miroir) de Matteo Salvini et Viktor Orban, peut évidemment choquer. Le fait est qu’il en utilise certains ressorts.
La simplification manichéenne, en premier lieu, quand il réduit le débat européen à l’affrontement de deux camps, progressistes contre nationalistes, libéraux contre illibéraux. Entre Macron et eux, rien : la droite de Laurent Wauquiez est renvoyée dans le camp de Viktor Orban, la gauche de Jean-Luc Mélenchon est assimilé à Marine Le Pen dans une « convergence des nationalismes européens ». L’agressivité des discours, ensuite, par exemple lorsqu’il dénonce à Bratislava « ces dirigeants avec ces esprits fous et qui mentent à leur peuple ». Il stigmatise sans ambiguïté Viktor Orban et le gouvernement polonais, les mêmes qu’il a accusés de vouloir « déporter » les migrants. La dramatisation émotionnelle de la situation politique, enfin, par le parallèle régulièrement établi entre les années 30 et l’Europe d’aujourd’hui. « Le monde dans lequel nous vivons est dangereux », insiste le président français.
La réaction d’Emmanuel Macron ne devrait pas surprendre. Il avait démontré au long de la campagne présidentielle sa maîtrise du registre populiste face à Marine Le Pen, jusqu’à la guerre des mots du débat télévisé de l’entre-deux tours. Et il théorisait récemment dans la Nouvelle Revue française : « Le grand enjeu, c’est de sortir de l’insignifiance ». Le pouvoir politique serait « sorti de l’émotion populaire », lui revendique d’y faire retour : « Les gens ne vous reconnaissent comme l’un des leurs que si vous prouvez que vous êtes capable de partager leur émotion. » Il se réjouit enfin du choc des passions en Europe, alors que « ce vieux continent de petits-bourgeois se sentant à l’abri dans le confort matériel entre dans une nouvelle aventure où le tragique s’invite. »
Mais la démarche est périlleuse. À camper une « opposition caricaturale entre les méchants populistes et les gentils progressistes européanistes », prévient le communicant Robert Zarader, on court « l’énorme risque de voir les plus caricaturaux l’emporter ». En témoigne la fulgurante ascension et non moins rapide chute du démocrate italien Matteo Renzi. Pire, s’inquiète un député macronien, engager le combat dans le registre hystérique des populistes relève du pacte de Faust : « À court terme, c’est nécessaire pour gagner ; à long terme, c’est dangereux ».
L’Europe emportée
« Nécessaire pour gagner »… Et si Emmanuel Macron n’avait pas le choix ? L’hystérie politique décrite par Istvan Bibo n’est plus le fait du seul camp populiste ou extrémiste, la pathologie a gagné l’ensemble du champ social. Elle le doit au vide créé par la fin des idéologies qui ordonnaient nos sociétés, au champ ainsi laissé à la « psychologisation du social, du politique, de la scène publique en général », analysée il y a déjà trente ans par Gilles Lipovetski (3). L’hystérie s’épanouit dans la postmodernité. Elle prospère grâce au primat de l’émotion sur la raison, des désirs des individus sur les contraintes des institutions. Et quand Marcel Gauchet écrit que le sujet se définit désormais « par la primauté de son expérience de lui-même et de ses propres représentations vis-à-vis de ce qui l’environne et de la sphère de l’objectivité » (4), on croit entendre Istvan Bibo décrivant « la méconnaissance de la réalité par la communauté, l’incertitude ou l’hypertrophie de l’évaluation de soi-même… »
Notre basculement dans un monde numérique explique également la stratégie d’Emmanuel Macron. Tout a été dit sur la radicalisation des opinions sur Internet par les « bulles de filtrage », sur la violence des échanges par émoticônes et en 140 signes (et même 280). Nous assistons à la banalisation et la légitimation de la violence dans le débat public, à sa « brutalisation », pour citer Romain Badouard, qui reprend une expression qualifiant le débat politique de l’entre-deux-guerres (5).
La surprise est que l’hystérie politique s’empare des élections européennes, les moins passionnées qui soient. Qui étaient, plutôt. Car au-delà de la volonté des acteurs, les événements, certains diront l’histoire, ont fait de l’Europe un objet de passions : la crise financière et son drame grec, le Brexit, la crise des migrants... Pour le meilleur et pour le pire, l’Europe est entrée en politique – postmoderne, numérique, hystérique.
Concluons avec Albert Camus. Il déplorait, au lendemain de la guerre, que « sur la plus grande partie du monde, le dialogue est aujourd’hui remplacé par la polémique (…). Elle consiste à considérer l’adversaire en ennemi, à la simplifier par conséquent et à refuser de le voir. » Et Camus insistait : « Il n’y a pas de vie sans dialogue » (5). Pas de démocratie, non plus.
(1) Istvan Bibo, Misères des petits États d’Europe de l’Est (Albin Michel)
(2) A lire en ligne sur Axios, « Trump on divise rhetoric Video »
(3) Gilles Lipovetski, L’Ere du vide (Folio)
(4) Marcel Gauchet, Le Nouveau Monde (Gallimard)
(5) « Internet et la brutalisation du débat public », de Romain Badouard, La Vie des Idées. Voir aussi : Francis Brochet, Démocratie Smartphone (Editions François Bourin)
(6) Albert Camus, « Le témoin de la liberté », in Conférences et discours (Folio)
Did you enjoy this article? close





