L’évolution du mouvement libertarien aux États-Unis et ses dérives edit
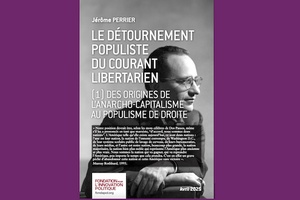
L’étude de Jérôme Perrier sur le mouvement libertarien aux États-Unis, publiée par Fondapol[1], présente un intérêt majeur. Outre qu’elle retrace de manière exhaustive son évolution au cours de la seconde moitié du XXe siècle elle aide à comprendre les phénomènes Trump (qu’il n’aborde pas directement) et Milei, en dévoilant, au-delà des personnalités, leur soubassement idéologique et politique. La richesse de cette étude nous a conduit à nous concentrer ici sur son apport principal, le rôle central joué par l’économiste Murray Rothbart (1926-1996) dans l’évolution de la branche la plus radicale du courant libertarien, l’anarcho-capitalisme, et sa fusion avec le populisme et la frange la plus conservatrice de la droite religieuse pour former ce que ce dernier nomme le « paléo-libertarianisme ».
Rappelons que le courant libertarien rassemble des individus qui radicalisent les thèses du libéralisme classique, jusqu’à l’anarchisme pour les plus fondamentalistes, ici dans le cadre d’une culture politique américaine qui est foncièrement individualiste et attachée à la propriété privée. L’une des idées principales sur laquelle va se concevoir et s’opérer cette fusion est que « l’État n’est rien d’autre que l’institutionnalisation de la prédation et du parasitisme. Il fournit un canal légal, ordonné et systématique, pour la prédation de la propriété privée ; il rend certain, sécurisé et relativement ‘‘paisible’’ la vie de la caste parasitaire de la société ». Rothbart s’inspire au départ des écrits de son ancien professeur à New York, l’économiste autrichien Ludwig von Mises, et notamment de son ouvrage majeur, L’Action humaine, paru en 1949. C’est d’ailleurs dans la lignée de cet ouvrage que Rothbart rédigera en 1962 sa propre somme théorique, Man, Economy and State.
Rothbart va être, selon Perrier, « le principal artisan du virage conservateur, pour ne pas dire réactionnaire, d’une majorité de libertariens américains durant la décennie 1970. Il raisonne – comme du reste l’immense majorité des libertariens les plus extrêmes – sur une vision jusnaturaliste qui radicalise le paradigme lockéen, en faisant de la souveraineté absolue de l’individu un droit inaliénable (d’où le refus de reconnaître une quelconque légitimité à l’État) ». Ce virage s’opère à partir d’une vision stratégique nouvelle, celle d’un rapprochement entre libertariens et conservateurs populistes de droite. « C’est sans doute, écrit Perrier, son texte “Right-Wing Populism : a Strategy for the Paleo Movement ”, publié en janvier 1992 dans le Rothbard-Rockwell-Report, qui exprime avec le plus de clarté les principes au nom desquels ce rapprochement doit s’opérer. Même si ce rapprochement va conduire les intéressés à se renier sur un certain nombre de points précis force est de constater qu’il ne s’agit pas tout à fait de l’alliance de l’eau et du feu, tant il est vrai qu’un certain nombre de passerelles idéologiques ont rendu possible ce qui n’en est pas moins un saut au regard de certaines positions passées des intéressés. » En résumé, « la tâche des paléo-libertariens est de sortir du gouffre sectaire libertaire et de forger des alliances avec les ‘‘réactionnaires’’ culturels et sociaux. Le nœud de l’argumentation rothbardienne tourne autour de l’opposition entre les dominés (le peuple écrasé d’impôts et de mépris) et les dominants (à savoir les hommes de l’État, mélange de politiciens, de technocrates, de patrons de grandes entreprises et d’intellectuels stipendiés). »
Selon Perrier, Rothbard « va pouvoir concilier son combat contre l’hydre étatique et son concubinage idéologique avec les « conservateurs » de stricte obédience. Car tous désignent un ennemi commun : les élites de la côte Est (les diplômés de la Ivy League) qui peuplent les lieux de pouvoir et imposent grâce à cette position dominante une idéologie progressiste destinée d’abord à entretenir et à faire prospérer la pieuvre étatique. Concrètement, les anarcho-capitalistes de droite (rebaptisés « paléo-libertariens » au début des années 1990) vont entamer aux côtés des héritiers de la Old Right (qualifiés au même moment de « paléo-conservateurs »), une véritable croisade contre le Warfare-Welfare State, sorte d’hydre à plusieurs têtes. Aux yeux de cette coalition libertaro-réactionnaire, cet « État-providence impérialiste » est en effet composé de divers éléments. D’abord le Big Government, avec ses programmes sociaux et leur revers, une fiscalité confiscatoire. Ensuite, l’interventionnisme militaire, destiné à alimenter le complexe militaro-industriel au nom d’une idéologie démocratique appelée à convertir le monde entier. Enfin, un prurit législatif destiné à promouvoir le multiculturalisme tout en luttant contre ce que les populistes de droite jugent être de prétendues discriminations, afin de mieux nourrir l’insatiable appétit réglementaire et coercitif du Léviathan. »
Rothbart définit lui-même ainsi son programme en janvier 1992 : « L’idée fondamentale du populisme de droite est que nous vivons dans un pays et dans un monde étatisés. Que l’élite dirigeante qui les domine est constituée d’une coalition comprenant les membres d’un État obèse, les dirigeants de grandes sociétés, et divers autres lobbies influents. Plus précisément, la vieille Amérique de la liberté personnelle, de la propriété privée et de l’État minimal a fait place à une coalition de politiciens et de bureaucrates associés à des élites financières et commerciales (par exemple les Rockefeller, les membres de la Trilatérale) voire dominés par elles ; et cette nouvelle classe de technocrates et d’intellectuels, comprenant les universitaires du Nord-Est et les élites médiatiques, représente dans la société la classe qui crée l’opinion. »
Perrier s’attache à identifier les différents éléments de correspondance idéologiques qui ont rendu possible cette convergence entre libertarianisme et populisme, détaillant les huit principaux chapitres de ce programme : diminution radicale des impôts ; couper radicalement dans l’État providence ; supprimer les privilèges raciaux et autres privilèges de groupe (en réalité démantèlement de tout l’édifice de la discrimination positive) ; reconquérir les rues : « pas de quartier pour les criminels » ; se rapproprier les rues : éliminer les clochards ; supprimer la banque centrale : « à bas les banksters » ; « America first » : « Come home, America. Cessons de distribuer des aides à tous ces mendiants étrangers. Arrêtons toute aide ‘‘au développement’’, qui n’est qu’une aide aux banksters, à leurs titres et à leurs industries d’exportation. Arrêtons tout ça et résolvons nos problèmes intérieurs » ; enfin, défendre les valeurs de la famille.
Conscient des critiques et des reproches de revirement que peuvent à bon droit lui adresser ceux qui ont suivi ses combats passés, Rothbart croit devoir conclure son manifeste de la manière qui suit : « Pour finir : chaque point de ces programmes populistes de droite est entièrement cohérent avec une position purement libérale. Cependant, toute politique du monde réel est une politique de coalition et il y a d’autres domaines où les libéraux pourraient bien transiger avec leurs partenaires conservateurs, traditionalistes ou autres au sien d’une coalition populiste. »
Perrier estime que « si le rapprochement entre anarcho-capitalistes et conservateurs traditionnalistes a été rendu possible par un certain nombre de points de convergences (au prix, encore une fois, de quelques contorsions idéologiques), il relève tout autant d’un calcul politique assumé et un brin cynique. Murray Rothbard, pourtant féru de théories abstraites, est également un stratège politique qui n’hésite pas à s’adapter aux circonstances du moment, et qui est prêt pour cela à faire preuve de la souplesse nécessaire pour parvenir à son but : gagner la guerre culturelle, préalable indispensable à la réalisation de ses idées les plus utopiques. »
Pour mener cette guerre avec succès, le stratège libertarien trouve dans le précédent de la conquête du pouvoir par les nazis la démonstration qu’« aucun mouvement « révolutionnaire » – c’est-à-dire aucun mouvement en faveur d’un changement social radical – ne peut réussir s’il n’a pas une idée claire de qui sont « les bons et les méchants ». Le populisme paléo-libertarien en action va donc consister à dresser le peuple contre ses élites en se faisant l’avant-garde du premier : « Si les nazis avaient une théorie claire et nette des bons contre les méchant écrit Rothbart, et que les marxistes ne l’ont pas, les libertariens possèdent également une théorie claire et nette des deux groupes. Par conséquent, les libertariens sont capables de donner une image bien plus convaincante des ennemis et des amis potentiels que les marxistes ne peuvent jamais en produire. » Dans un texte de septembre 1993, intitulé : « On Resisting Evil » il précise : « L’Amérique telle qu’elle existe aujourd’hui, ce sont deux nations : l’une est leur nation, la nation de l’ennemi corrompu, de Washington D.C., de leur système scolaire public de lavage de cerveau, de leurs bureaucraties, de leurs médias, et l’autre est notre nation, beaucoup plus grande, la nation majoritaire, la nation bien plus noble qui représente l’Amérique plus ancienne et plus vraie. Nous sommes la nation qui va gagner, qui va reprendre l’Amérique, peu importe le temps que cela prendra. C’est en effet un grave péché d’abandonner cette nation et cette Amérique sans victoire ».
Perrier se demande ensuite en quoi les paléo-libertariens violent avec ce programme nombre de principes libéraux fondamentaux. Pour répondre à cette question il examine des exemples économiques (la question des monopoles), politiques (la question de l’immigration) et culturels (notamment le droit à l’avortement, les droits LGBT et plus largement la question des discriminations).
La défense du pluralisme est un principe fondamental du libéralisme, et c’est la raison pour laquelle l’idée même de monopole heurte tous les auteurs libéraux, quel que soit le domaine où il s’applique. Or, dans le chapitre 10 (« Monopoly and Competition ») de son ouvrage Man, Economy and State, Rothbard entend démontrer que la notion de monopole ne saurait, « en aucune circonstance » être conçue comme une entrave au bon fonctionnement de l’économie de marché sauf si elle est l’œuvre de l’État ». Notons que c’est par la lecture de ce texte que Javier Mileï a connu en 2013 sa subite conversion aux thèses libertariennes les plus radicales.
Dans leur volonté de rapprochement avec la droite populiste les concepteurs de la stratégie « fusionniste » ont cherché à justifier le refus de l’immigration sans pour autant paraître renier leurs principes libertariens. Rothbart écrit ainsi dans The Ethics of Liberty (1982) : « il ne peut y avoir aucun droit humain à immigrer, car quelle propriété quelqu’un d’autre a-t-il le droit de fouler aux pieds ? » Ce faisant, conclut Perrier, « les libertariens ne renient pas ouvertement une liberté (celle de circuler librement) considérée comme naturelle par l’immense majorité des penseurs libéraux, dont un bon nombre ont eux-mêmes été des immigrés (que l’on pense, pour le seul XXe siècle, à Ayn Rand, Hayek, Mises, Popper, Mickaël Polanyi, et tant d’autres encore). » Remarquons que Donald Trump, qui a inscrit la question de l’immigration en tête de ses priorités politiques, justifie ses positions anti-immigration en utilisant, sans doute sans le savoir, l’un des points du programme de Rothbart : « pas de quartier pour les criminels », en considérant précisément que les immigrés sont des criminels.
Le libéralisme culturel
Selon la tradition libérale classique, à laquelle se rattache in fine le courant libertarien, la loi n’a pas à se substituer à la morale en se prononçant sur les comportements individuels dès lors que ces derniers ne portent pas atteinte aux droits d’autrui. Rothbard lui-même, dans les années 1960, pouvait écrire que « le libertarien approuve sans réserve ce qu’on appelle généralement les libertés civiles : liberté d’expression, de publication, d’association, liberté de se livrer à des ‘‘crimes sans victimes’’ tels que la pornographie, les déviations sexuelles et la prostitution ». « Force est pourtant de constater, écrit Perrier, qu’un tel point de vue est loin de refléter le positionnement de la grande majorité des libertariens aujourd’hui. Beaucoup, à l’image de Javier Milei, préfèrent abandonner le libéralisme culturel à la gauche pour mieux surfer sur les tendances conservatrices de la société selon la stratégie d’alliance avec la droite populiste. » Dans un article-fleuve, intitulé “The Religious Right. Toward a Coalition”, et rédigé juste après l’élection du Démocrate Bill Clinton à la Maison-Blanche, Rothbard a reconnu sans ambages son alignement sur la droite chrétienne en matière culturelle, le légitimant ainsi : « les conservateurs chrétiens tentent de riposter contre une élite de gauche libérale qui a utilisé le gouvernement pour attaquer et pratiquement détruire les valeurs, les principes et la culture chrétiens ».
Rothbard reconnaît que « la question de l’avortement est plus difficile ». Le problème n’est pas tant qu’il se reconnaisse lui-même comme pro-choice, mais tient à ce que la plupart des arguments pro-life sont faciles à réfuter selon une logique strictement libertarienne. Il faut alors que les uns et les autres acceptent de passer un compromis. C’est ainsi qu’il explicite ce qui a tout l’air d’un subterfuge : « Nous devrions décentraliser radicalement les décisions politiques et judiciaires dans ce pays ; nous devrions mettre fin au despotisme de la Cour suprême et du système judiciaire fédéral ; et ramener les décisions politiques aux niveaux étatique et local ». « En d’autres termes, explique Perrier, en renvoyant la question de la légalité de l’avortement à l’échelon local, on désamorce une querelle qui pourrait être un obstacle majeur à l’alliance entre les anarcho-capitalistes et la droite chrétienne. » Comment mieux dire que la stratégie de fusion avec la droite religieuse prend ici clairement le pas sur la cohérence idéologique, et que dans le combat contre l’hydre étatiste, l’alliance avec la droite la plus conservatrice et la plus illibérale en matière culturelle est une tactique d’autant plus assumée qu’elle paraît indispensable, aux yeux de ses instigateurs, à une conquête des masses populaires. Il s’agit désormais, ni plus ni moins, d’opérer une « révolution populiste par la base » (celle « des hommes blancs d’ascendance européenne »), contre « les élites dirigeantes égalitaristes, collectivistes et internationalistes », ce qui suppose de « se concentrer sur leurs doléances et leurs préoccupations » en s’appropriant leurs revendications : « des impôts élevés, trop de régulation gouvernementale (y compris la victimologie, les politiques de discrimination positive, l’environnementalisme antihumain) ; le système de protection sociale et l’État-providence ; la violence criminelle », sans oublier, bien entendu, « l’immigration par des hordes d’étrangers non assimilés à la culture américaine », ou encore « l’attaque du sécularisme contre la religion chrétienne. Comment mieux dire que ce sont bien les nécessités de cette coalition populiste et de la propagande propre à la souder qui l’emportent désormais clairement sur la cohérence des idées de liberté », conclut Perrier.
Did you enjoy this article? close




[1] Jérôme Perrier, Le Détournement populiste du courant libertarien, deux tomes, 56 pages et 53 pages, Fondapol, avril 2025.


