Gouvernance d’entreprise et pouvoir partagé. Un défi syndical? edit
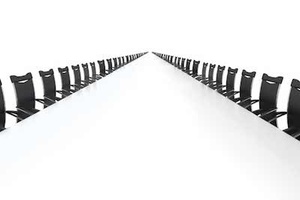
En décembre 2017, entre la réforme du Code du travail et un projet de loi sur la croissance et la transformation des entreprises, la CFDT a rendu public un document qui se veut innovant. Il s’agit de « repenser l’entreprise » à partir de ses finalités sociales et environnementales, de l’épargne salariale et surtout d’une gouvernance plus coopérative fondée sur un partage du pouvoir entre les directions et les élus du personnel. La proposition concernant la gouvernance d’entreprise part d’un constat devenu courant dans le monde syndical. Pour la CFDT, face à la place des actionnaires dans les Conseils d’administration ou de surveillance, il faut procéder à « un rééquilibrage entre capital et travail » fondé sur la prise en compte du capital humain dans la stratégie économique. À ses yeux, les représentants des salariés sont un atout pour la pérennité de l’entreprise et « le fait qu’ils ne soient pas guidés par la recherche de l’intérêt à court terme permet un rééquilibrage de la gouvernance au profit des intérêts de long terme. »[1]
Dans une période où les syndicats pâtissent d’un manque de visibilité malgré les mobilisations récentes sur le Code du travail, la proposition de la CFDT demeure très volontaire. Souhaitant dépasser la loi Rebsamen et les textes adoptés durant la précédente législature, la centrale veut amplifier la présence des élus des salariés dans les Conseils d’administration ou de surveillance. Elle revendique ainsi pour ces élus, l’attribution de 33% des sièges dans les entreprises de plus de 1000 personnes et de 50% dans celles de plus de 5000, ce dernier pourcentage s’inspirant de la cogestion en vigueur en Allemagne. Dans les faits, la centrale parle d’une « codétermination à la française », source pour elle d’une « modernisation des relations sociales ».
L’initiative de la CFDT peut en surprendre plus d’un. Longtemps, la CFDT fut réservée voire hostile à l’égard de la cogestion semblant lui préférer, notamment dans les années 1970, l’idée d’autogestion. Et ceci était d’autant plus patent qu’en France, la cogestion relevait pour beaucoup du « tabou ». Il ne faut pourtant pas oublier un élément d’importance. Suite au recentrage de l’organisation qui allait la conduire à une démarche résolument réformiste et contractuelle, la notion d’autogestion fut redéfinie en profondeur. Dès la fin des années 1980, Jean Kaspar qui succéda à Edmond Maire à la tête de la confédération l’évoquait comme une démarche non plus porteuse d’un « projet » révolutionnaire et politique mais bien comme une « méthode » visant à renforcer de façon concrète l’intervention des salariés sur les conditions et l’organisation du travail voire sur certaines décisions prises par l’employeur. L’autogestion renvoyait dès lors au « réalisme économique » de la CFDT qui impliquait une autre approche – une approche réformiste – de l’entreprise capitaliste. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le texte récent de la centrale sur la codétermination aborde l’entreprise comme un « projet commun fédérateur », un projet commun entre le capital et le travail.
Aujourd’hui, l’organisation de Laurent Berger semble vouloir accélérer le pas. Pour quelles raisons ? À l’évidence, le contexte politique issu du printemps 2017 mais aussi la déception que la CFDT a pu exprimer lors de la publication des ordonnances sur le Code du travail, n’y sont pas pour rien du moins dans un contexte très actuel qu’il faut toutefois dépasser. En effet, la revendication d’une « codétermination à la française » découle d’éléments qui débordent la conjoncture politique, économique et sociale de ces derniers mois. Depuis l’accord interprofessionnel et la loi de 2013, la compétitivité économique est reconnue comme l’un des enjeux essentiels du dialogue social, un enjeu qui par définition concerne directement la stratégie de l’entreprise et donc la gouvernance économique. Joue aussi, l’opinion des salariés telle qu’elle se dégage des observations faites par la CFDT sur le terrain, dans les bureaux et les ateliers. Dans l’enquête « Parlons Travail » organisée par elle à l’automne 2016 auprès de 200 000 travailleurs, 72% d’entre eux disaient souhaiter être plus associés aux décisions qui les concernent. Enfin, les propositions sur la codétermination reposent sur un constat repris avec insistance par ses dirigeants : à leurs yeux, la France aurait « le plus faible nombre d’administrateurs salariés » par rapport aux autres pays européens, accusant ainsi un profond retard (conférence de Laurent Berger, 19 décembre 2017).
Si de telles raisons peuvent expliquer l’initiative de la CFDT, elles ne disent rien de ses capacités à impulser une évolution des modes de gouvernance économique, et pour cause. La tâche s’avère ardue. En l’occurrence, les réserves et les oppositions sont importantes, multiples et souvent incontournables. Du côté patronal, il existe notamment depuis la crise de 2008, certains responsables comme Jean-Louis Beffa, Antoine Frérot, Louis Gallois, Jean Peyrelevade, Louis Schweizer qui prônent à divers degrés, la reconnaissance d’une influence accrue des salariés et de leurs représentants face à la décision économique. Mais il s’agit là d’individualités encore isolées. Du MEDEF à la CPME, dominent – et de loin – des sentiments mêlés d’hostilité et d’opposition à l’égard de toute extension de la présence des élus des salariés au sein de la gouvernance des entreprises. Du côté des syndicats, la CFDT peut espérer disposer d’une oreille attentive de la part de la CFE-CGC ou de la CFTC. Mais FO a toujours manifesté une opposition radicale à toute intervention des salariés et des syndicats dans la gestion des entreprises. Il s’agit là d’un trait historique et culturel éminent de la Confédération de l’avenue du Maine. Quant à la CGT ou SUD, leur défiance à l’égard des directions d’entreprise et de l’économie capitaliste, les entraînent à refuser toute forme de cogestion qui, aux yeux de beaucoup de leurs militants, rappellent un système allemand qu’ils identifient à de l’accompagnement syndical des stratégies patronales. En Italie, les trois grandes confédérations syndicales ont établi l’an dernier une plate-forme commune où la codétermination est clairement revendiquée. En France, cela est aujourd’hui totalement impossible.
Du côté des partis politiques et en particulier des partis de gauche, le problème est tout aussi sensible. Lorsque dans les années 1970, la CFDT prônait un socialisme autogestionnaire, elle était soutenue par un PS ou un PSU qui prônaient aussi l’autogestion de l’économie. On l’aura compris, ce passé est révolu du point de vue idéologique mais aussi du point de vue des forces en présence sur le terrain politique. Le PSU n’est plus et le PS est désormais trop faible pour appuyer éventuellement et de façon efficace des revendications syndicales sur la gouvernance des entreprises.
Dès lors, faut-il penser que la « codétermination à la française » est un projet dont l’application même partielle est remise aux calendes grecques ? Et s’agit-il là d’un trait propre à la France lorsque l’on sait le retard pris par elle en Europe, quant à la représentation des salariés dans la gouvernance des entreprises ? Au regard des réserves de tous ordres que suscite l’idée de « codétermination à la française », on peut sans grand risque, prédire une simple chose : les revendications syndicales concernant la gouvernance économique seront confrontées à beaucoup d’embûches et de nombreux handicaps. Mais n’est-ce pas là ce qui caractérise toute proposition de réforme touchant à la question délicate du pouvoir et de son exercice dans l’entreprise ?
[1]. « Repenser l’entreprise : les propositions de la CFDT », CFDT, Paris, 2017.
Did you enjoy this article? close





