Les classes moyennes sont-elles désavantagées par l’État-providence? edit
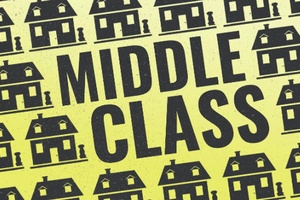
La question des classes moyennes, fortement ravivée à l’occasion du mouvement des Gilets jaunes, est à l’ordre du jour depuis une quinzaine d’années. Ce sont, d’abord, toujours les mêmes débats : de qui parle-t-on ? Une approche générale consiste à raisonner en « ni ni ». Les classes moyennes ne sont ni riches, ni pauvres ; ne vivent ni dans les quartiers aisés, ni dans les quartiers défavorisés ; ne travaillent ni en tant qu’exécutant, ni en tant que dirigeant. Ces trois « ni ni » sont loin de se recouper totalement, mais la démarche permet de délimiter – certes de façon discutable – ce dont on parle. L’exercice permet en tout cas de circonscrire rapidement ces catégories au centre du débat public.
Autrefois érigées, en France, en une catégorie unitaire, de taille relativement restreinte, quel est aujourd’hui leur dénominateur commun, quand elles rassemblent toute population dans une position intermédiaire entre les nantis et les moins bien lotis ? Captées dans des entre-deux, entre une France d’en haut et une France d’en bas, elles présentent une grande dispersion de profils. Pendant un temps, la classe moyenne a bénéficié d’une certaine unité, qui pouvait légitimer son singulier. Aujourd’hui, le pluriel s’impose. Au-delà des définitions, les classes moyennes vivent, après une période d’essor et d’ascension, un sentiment d’écrasement et de concurrence. Il est souvent souligné, de façon parfois polémique, que ces catégories centrales de la population seraient les oubliées du système de redistribution. Pas assez riches pour bénéficier des avantages fiscaux, pas assez pauvres pour bénéficier des prestations sociales ciblant les moins favorisées, les classes moyennes seraient les perdantes du système. Est-ce si vrai ?
Classes moyennes et fiscalité: une vieille histoire
En matière de prélèvements, les classes moyennes seraient étranglées, assommées voire martyrisées. Le diagnostic n’est pas vraiment neuf.
Au début du XXe siècle, la classe moyenne (alors au singulier, et majoritairement composée d’indépendants) se constituait et se mobilisait contre l’impôt sur le revenu. Plus précisément, des forces s’organisent en son nom, notamment à la Belle Époque et sous le Front populaire. En 1908 naît une « association de défense des classes moyennes », opposée au projet de création d’un impôt sur le revenu. Dans les années 1930, il se fonde une Confédération générale des syndicats de classes moyennes (CGCM) qui demande une diminution de la pression fiscale. Et, après la Libération, s’organise, toujours en réaction à la fiscalité, un Comité national des classes moyennes (CNCM) présentant la France comme « un pays de classes moyennes ».
Dans toute la période qui va jusqu’à la fin des Trente Glorieuses, on assiste à un essor des classes moyennes salariées qui accèdent, par la croissance, à une qualité de vie grandissante avec une foi élevée dans le progrès. C’est, toutefois, moins en termes de niveaux de revenus qu’en termes de représentation de leur place dans la société qu’il est fait référence aux classes moyennes. On peut alors en moquer le caractère petit bourgeois (expression qui devient plus dépréciative que descriptive). On peut, à l’inverse, en célébrer la contribution à une vie démocratique apaisée.
Assez peu présentes sur l’agenda politique des années 1970 au début des années 2000 (les questions de chômage, de nouvelle pauvreté, d’exclusion prennent le pas), les classes moyennes ne sont pas érigées en thème d’affrontement politique et très peu en objet d’expertise. L’impression générale est à un effacement des classes sociales, noyées dans une vaste catégorie moyenne qui s’élargit. Elles reviennent un peu d’actualité, en 1998, quand le gouvernement met, quelque temps, les allocations familiales sous condition de ressources : la classe moyenne est-elle concernée ou épargnée ? Mais c’est au cours de la décennie suivante qu’aux sujets de pauvreté et d’exclusion se greffent ceux de la déstabilisation et du déclassement de ces catégories centrales, elles aussi victimes des conséquences du chômage. Se pose alors, en termes très vifs, le problème de leur situation relative au sein du système socio-fiscal. Des polémiques se développent pour savoir si elles sont ou non sacrifiées par un système pour lequel elles cotisent sans en bénéficier autant que les plus favorisés, d’un côté, et les plus défavorisés, de l’autre.
Les classes moyennes sacrifiées: l’image de la courbe en «U»
Qu’en est-il, vraiment, de ce délaissement social ? Répondre à la question impose de pénétrer dans les logiques de la protection sociale à la française, entendue au sens large (des risques de Sécurité sociale à l’Éducation nationale).
Les mécanismes socio-fiscaux ne semblent pas favorables aux classes moyennes (les catégories situées entre les plus riches et les moins aisés). Les aides sociales (l’assistance) vont d’abord aux moins favorisés, les dépenses fiscales (les réductions d’impôt) profitent aux mieux lotis.
Une représentation du phénomène est une courbe en « U ». D'un côté, les moins aisés voient leurs revenus augmenter grâce aux prestations familiales, aux allocations logement et aux minima sociaux. De l'autre, les plus aisés tireraient davantage de bénéfices de la fiscalité grâce aux niches fiscales. Entre les deux, les classes moyennes seraient à la base du « U ». La courbe stylisée de la redistribution (prestations et fiscalité) suit, en effet, le profil d’un « U ». Au milieu, les classes moyennes ne bénéficient pas aussi nettement que les plus modestes des prestations, et pas aussi fortement des avantages fiscaux que les plus aisés.
La forme du « U » a été atténuée par des réformes très disputées du quinquennat Hollande : modulation des allocations familiales et abaissement du plafond du quotient familial. Mais le « U » est toujours discernable, un peu partout dans l’édifice socio-fiscal. Prenons par exemple le cas des étudiants dans l’enseignement supérieur : des bourses pour les étudiants de foyers modestes, de possibles réductions d’impôt pour les étudiants de foyers favorisées. Et toujours un entre-deux à la base d’un « U » de la redistribution.
Il s’avère par ailleurs possible de produire une courbe en « U » inversé pour figurer ce qu’il en est non plus sur le volet des dépenses socio-fiscales, mais sur celui des prélèvements. On place, en ordonnées, la pression socio-fiscale (en proportion du revenu des ménages), et, en abscisses le revenu primaire des ménages. Se profilent ainsi, d’abord, une augmentation de la pression fiscale liée au caractère progressif de l’impôt, puis, au niveau des classes moyennes, un plafond, et, enfin, une légère décrue. Celle-ci, liée à un effet dégressif, que certains disent « régressif », des prélèvements, est réservée aux 5% les riches et, plus précisément, aux 1% les plus riches. En considérant l'ensemble des prélèvements obligatoires (impôt sur le revenu, CSG, TVA, cotisations sociales), les économistes spécialistes du 1%, Camille Landais, Thomas Piketty et Emmanuel Saez, ont indiqué, en 2012, que la première moitié des personnes vivant en France a un taux effectif d’imposition qui va de 41% à 48 %. Les 40% suivant sont taxés entre 48% et 50%. Pour le 0,1% les plus favorisés, le taux de prélèvement tournerait autour de 35%.
Un État-providence plutôt favorable aux classes moyennes?
Les deux graphiques (en « U » et en « U » inversé) fournissent des arguments puissants (car à la fois très solides et imagés) à ceux qui estiment que les classes moyennes sont les perdantes du système.
Ce profil décrit, à sa manière, une réalité des incidences du système socio-fiscal sur le revenu des ménages. Mais il est souvent discuté dans les cénacles académiques. L’essentiel n’est peut-être pas dans la bisbille technique et philosophique sur l’orientation des mécanismes redistributifs. Un point important tient d’une nécessaire prise en compte des effets de la redistribution dans le temps long.
Les prestations permettent, en effet, à une partie de la population modeste de basculer, vers le haut, dans les classes moyennes. Si elles ne profitent pas pleinement, à un moment t, de gains complémentaires, elles se trouvent souvent dans cette situation parce qu’en t-1 ou t-2 elles vivaient dans des conditions moins favorables, conditions que l’État-providence a contribué à améliorer. Appartenant, dans le passé, à des catégories moins fortunées, elles ont prospéré au cours de leur trajectoire grâce, en particulier, au système éducatif qui vise à assurer leur promotion.
Surtout, le raisonnement autour du « U » est discutable car il ne repose que sur les flux financiers et ne prend pas en compte les transferts en nature, principalement les services publics. Or sur ce plan, il est certain que les classes moyennes usent beaucoup plus d’équipements socioculturels et éducatifs : les musées, les bibliothèques, les théâtres subventionnés, mais surtout les écoles et les universités. Les ménages des classes moyennes y ont moins recours que ceux des catégories supérieures mais bien plus que ceux des catégories modestes. La relative surreprésentation des classes moyennes dans l’éducation (qui, répétons-le, n’est pas grand-chose par rapport à la surreprésentation des classes supérieures) peut s’apprécier à partir de la composition sociale du Bac général ou des étudiants diplômés à Bac + 5. Les enfants de ménages dont la personne de référence provient des professions intermédiaires tirent clairement leur épingle du jeu, tandis que les enfants d’ouvriers n’accèdent que difficilement aux études supérieures et très difficilement aux classes préparatoires.
Les comparaisons internationales invitent aussi à revisiter l’analyse des liens entre classes moyennes et État-providence. La proportion des classes moyennes – définie comme la part des ménages se situant entre 70% et 150% du niveau de vie médian – est en partie liée au niveau de richesse de chaque pays. Cette proportion demeure plus élevée en France que dans beaucoup d’autres pays développés et ne s’est pas franchement réduite. De même, le niveau de vie moyen de ces classes moyennes s’est globalement maintenu, à la différence d’autres nations où ces classes moyennes sont politiquement fondamentales, comme les États-Unis.
Le point original à souligner, à partir de la comparaison internationale, tient dans un constat : le taux de prélèvement obligatoire est corrélé à l’importance des classes moyennes nationales. La corrélation entre l’importance des classes moyennes et le montant des dépenses sociales est, elle aussi, importante. Une part, plus ou moins grande selon les pays, mais toujours substantielle, des populations à bas revenus intègrent les classes moyennes grâce aux prestations sociales. Plus les dépenses sociales représentent une part importante du PIB, plus les classes moyennes sont importantes. Il est probable qu’un certain niveau de dépenses sociales est nécessaire à l’épanouissement des couches intermédiaires. Et, en retour, il est encore plus probable qu’une réduction des prestations sociales a pour conséquence une diminution de la taille des classes moyennes.
En un mot, plus les impôts et la redistribution sont élevés, plus les classes moyennes sont répandues. Il y a là un constat, pas forcément une causalité. Au Danemark, en Suède, en France ou aux Pays-Bas, là où les prélèvements sont hauts, les classes moyennes sont importantes. En Bulgarie, en Lettonie, en Irlande, en Espagne, la taille réduite des classes moyennes est tout à fait parallèle à de faibles prélèvements obligatoires.
La comparaison internationale signale que l’État-providence, avant de défavoriser ou d’oublier les classes moyennes, est l’un des moteurs de leur existence. Il ne faut pas imaginer pour autant qu’en augmentant à la fois la pression fiscale et les dépenses sociales les classes moyennes verraient mécaniquement leur taille augmenter et leur situation relative s’améliorer…
Did you enjoy this article? close





