Mériter ou hériter? Les nouvelles générations face à l’héritage edit
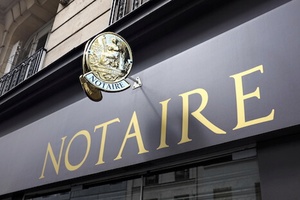
Si l’on est bac + 5 né pauvre, vaut-il mieux épouser une polytechnicienne issue d’une famille modeste (une rareté, puisque moins de 5 % des étudiants de Polytechnique ont un père ouvrier ou employé)[1] ou une prof de yoga héritière d’un trois pièces dans la rue du Bac ? Ou, version Fémina, est-il préférable de s’unir à un HEC[2] sans le sou plutôt qu’à un instituteur fils unique à qui ses parents ont légué une maison familiale en bord de mer ? Et bien, la rationalité recommande, pour qui, dans la trentaine, veut voir l’avenir en rose, de diriger son choix vers un ou une partenaire doté(e) d’un patrimoine de départ. Cette question fleure bon les romans du XIXe siècle, quand l’économie des biens s’immisçait sans pudeur dans les appariements matrimoniaux. Eugène de Rastignac, l’ambitieux étudiant en droit désargenté, s’interroge sur l’opportunité de se lier avec une riche héritière. Aujourd’hui, ce scénario perd de sa pertinence. Dans la « vraie vie », les unions se construisant sur des affects et, la moitié des couples se séparant, l’espoir d’enrichissement par le mariage est lourd d’aléas. Pourtant les données de l’INSEE sur l’évolution des revenus et des patrimoines des Français[3] ramènent droit vers les romans de Balzac ou de Zola.
Vers une société d’héritiers
En effet, le capital hérité permet plus sûrement d’avoir une vie confortable et sécurisée que les revenus amassés grâce à son salaire, même si on a un bon niveau de diplôme et un revenu de cadre supérieur[4] – les deux toutefois peuvent se cumuler puisque 69% des 25-34 ans enfants de cadres ou professions intellectuelles supérieures sont diplômés de l’enseignement supérieur long, contre 22% des jeunes issus d’un milieu ouvrier. Difficile de faire fortune si l’on ne s’appuie que de ses mérites universitaires, à moins d’être un chirurgien ayant investi son expertise dans une clinique privée, ou un startuper chanceux ayant raccroché ses activités avec l’écosystème de la Silicon Valley. Croissance des bac + 5 (un quart des nouvelles générations), relative dévaluation des diplômes, salaire de départ convenable mais progressant lentement, spectaculaire clivage de bien-être de vie entre héritiers et non héritiers : les fractures au sein des élites culturelles sont flagrantes.
Ainsi, les tableaux de l’INSEE incitent à réfléchir, et pas uniquement sur les stratégies matrimoniales. Aujourd’hui, dans la richesse globale des ménages, la part provenant de l’héritage est largement supérieure à la part épargnée (par une vie de labeur…) puisqu’elle représente près des deux tiers contre un tiers pour l’épargne. Exactement l’inverse de ce qui se passait dans les années 1970. Autrement dit, le travail et le salaire ne tiennent pas leur promesse d’enrichissement, et ce mouvement traverse profondément les inégalités socio -économiques : le poids de l’héritage dans le confort économique de chacun prend le pas sur la la capacité de chacun d’améliorer son niveau de vie par sa réussite dans son emploi. Le sentiment que le travail ne paie plus et qu’un niveau élevé de diplôme ne garantit plus de bonnes conditions économiques, ces désillusions atteignent nombre de trentenaires aujourd’hui[5]. Certes, le fait d’appartenir ou non à une famille qui détient du capital a, de tout temps, influé sur le destin de chacun, mais aujourd’hui cette situation qui semblait pouvoir être contournée grâce la méritocratie et à la carrière dans les entreprises est revenue au centre du jeu social. Le bon diplôme ne compense pas les atouts conférés par un solide héritage.
Les inégalités de patrimoine creusent sensiblement les distances entre les individus. Quelques chiffres l’illustrent. Les 50% des ménages français les moins bien lotis détiennent 8 % du patrimoine global, alors que les 50% des ménages les mieux lotis détiennent 92 % du patrimoine. Les personnes les plus démunies ont surtout du patrimoine résiduel (voiture, meubles, appareils électroniques, bijoux de famille), celles proches de la médiane (6e et 7e décile) sont surtout propriétaires de leur logement, les individus les mieux lotis (les fameux dix pour cent) détiennent un portefeuille diversifié (immobilier, épargnes diverses, actions, patrimoine professionnel, etc.). En vingt ans ces écarts de patrimoine ont augmenté, surtout en raison de la hausse de l’immobilier ancien dont la valeur a plus que doublé entre 1998 et 2021[6]. Tout en haut de la hiérarchie des fortunés, les 5% des ménages les mieux dotés en patrimoine détiennent plus de 1 035 000 euros et les 1 % plus de 2,2 millions d’euros, ces personnes appartenant pour la plupart aux catégories âgées[7]. Une béance s’est ouverte dans la société, entre les seniors et les nouvelles générations.
Les écarts générationnels
Certes, il n’est pas anormal que, dans la France contemporaine, la tranche d’âge des 50-69 ans soit la plus dotée en capital accumulé – un capital que recevront leurs héritiers, renforçant encore le fossé entre le petit nombre de leurs descendants et les autres – chez les 10 % des ménages les mieux dotés en patrimoine, la moitié a une personne de référence dont l’âge est compris entre 50 et 69 ans. Dans mon enquête sur les trentenaires bac + 5, 8% seulement d’entre eux indiquaient qu’ils allaient recevoir un « joli pactole » ; à la question « de quoi allez-vous hériter ? », l’immense majorité des bac + 5 répond « de belles valeurs et d’un bagage culturel ».
Il est pour le moins curieux que dans une société vouée à encenser « l’effort », la « méritocratie », et le succès scolaire, le train de vie matériel soit de plus en plus indexé sur les possessions familiales. Cette injustice touche particulièrement ceux qui ne peuvent compter sur un soutien financier familial pour « s’installer », acquérir un logement dans ou près d’un centre-ville, là où la plupart des diplômés occupent un emploi. L’effort financier pour accéder à la propriété s’est considérablement accru au cours des années : pour acquérir le même logement, avec le même taux d’effort initial et le même apport personnel, il faudrait compter théoriquement 23 ans en 2025 contre seulement une dizaine d’années en 1975, indique une note du Plan[8]. De ce fait, les jeunes ménages capables aujourd’hui d’accéder à la propriété sont surtout ceux qui sont aidés par leurs parents : les aides reçues (donations et héritages) creusent l’écart entre les ménages les plus modestes et les plus aisés[9]. À cela s’ajoute l’aide monétaire (argent donné lors d’un achat, parfois soutien financier régulier, dons divers) et en soutien immatériel (garde des petits-enfants) que prodigue plus de la moitié des adultes âgés en direction de leurs enfants longtemps après que ceux-ci ont quitté le foyer familial – un effort qui s’élève en proportion de leurs moyens.
À cette inégalité de patrimoine s’en ajoute une autre sur l’évolution des salaires : le salaire des jeunes (quel que soit le niveau de diplôme) a moins progressé que celui des plus âgés. Certes le niveau moyen des salaires nets s’est accru d’environ 12 % pour un jeune salarié en 2025 par rapport à un jeune entré sur le marché du travail entre 1975 et 1980. Mais les salaires ont progressé de façon plus forte pour le reste de la population, ce qui entraîne une dégradation relative de la situation des jeunes actifs[10].
Ces transformations au bénéfice des catégories âgées et relativement aisées font de la France et de beaucoup de pays européens des pays d’héritiers. Cette évolution est perçue par les jeunes ménages à travers des sentiments mitigés et contradictoires : incompréhension (la promesse républicaine n’était-elle pas celle d’un pays d’égalité des chances par l’école ?) ; perplexité et reconnaissance, puisque les générations vieillissantes ne sont pas si égoïstes et assurent à leur manière une redistribution privée par un accompagnement financier et moral ; et colère quant leur situation est trop en décalage par rapport à cette gérontocratie tranquille qui ne voit rien à se reprocher.
Les vingtenaires et les trentenaires expriment souvent un sentiment d’injustice générationnelle, parole diffuse qui englobe divers sujets d’anxiété face à l’avenir, comme le dérèglement climatique, les bouleversements géopolitiques, et l’insécurité économique – celle liée aux transformations travail/capital que nous avons décrites, et à la résurgence de l’héritage comme problème public. Pourtant, dans une société où la méfiance (la colère parfois) envers les institutions et les politiques est à son zénith, la famille, les liens avec les proches demeurent le premier lieu de confiance et d’attente des nouvelles générations, ce qui complexifie le débat sur la transmission économique. Ainsi, l’idée d’un alourdissement de la fiscalité sur l’héritage rencontre une hostilité quasi générale[11], même chez ceux qui ont peu de patrimoine ou un patrimoine modeste (et donc ne paient pas de droits de succession), comme s’il se dégageait un principe de base : on fait plus confiance à la transmission privée, et à l’usage que les héritiers peuvent en faire, qu’à la transmission vers l’État (nous laissons de côté le sujet de la taxation des 0,1 % des plus riches qui s’articule à la politique économique).
Did you enjoy this article? close




[1] Chiffres de 2018. Hervé Joly, « Le regard de l’école Polytechnique sur son recrutement social, de la fierté à la gêne », La Jaune et la Rouge, n° 797, septembre 2024.
[2] 13 % des étudiants des écoles de commerce ont un père ouvrier ou employé. Ministère de l'Éducation nationale – Données 2019-2020.
[3] Revenus et patrimoine des ménages, INSEE référence, éditions 2024.
[4] « Face à la « grande transmission », l’impôt sur les grandes successions », Fondation Jean-Jaurès, novembre 2024.
[5] Monique Dagnaud, Génération Reset. Ils veulent tout changer, Odile Jacob, 2025.
[6] Revenus et patrimoine des ménages, INSEE référence, éditions 2024, page 29.
[7] L’étude de l’INSEE reposant sur des données déclaratives, celles- doivent probablement être réévaluées à la hausse.
[8] Antoine Bristelle, « Jeunesse d’hier et d’aujourd’hui : le grand déclassement », Haut-Commissariat au Plan, Note Flash, octobre 2025.
[9] Bertrand Garbinti, Carole Bonnet, Sébastien Grobon, L’inégalité croissante d’accès à la propriété des jeunes ménages. « La part de jeunes ménages aidés par leur famille augmente au cours des années 2000. 20 % des premiers propriétaires récents âgés de 25 à 44 ans sont concernés en 2002. Ils sont 27 % en 2013 », Bloc-note écho de la Banque de France, 13 septembre 2017. En 2021 l’âge moyen de l’héritage, pour ceux qui héritent est de 60 ans et seulement 7, 2 % des moins de 30 ans ont reçu un héritage, 12% des personnes de 30-39 ans ; parallèlement 7, 8 % des moins de 30 ans ont reçu une donation, 9, 6 % des personnes de 30-39 ans ont reçu une donation.
[10] Note d’Antoine Bristelle.
[11] Plus de huit Français sur dix seraient favorables à baisser la taxation des héritages, selon un sondage d’Odoxa du 25 avril 2024.

