Les mondes idéaux de Pierre Clastres edit
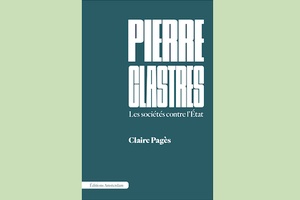
Comment repenser la question du pouvoir et de l’État en revisitant l’anthropologie politique de Pierre Clastres ? L’histoire des peuples sans histoire, c’est l’histoire de leur lutte contre l’État, soutenait l’ethnologue, disparu prématurément, laissant inachevée une œuvre exigeante, fruit de nombreuses années passées en Amazonie. Son livre majeur, La Société contre l’État[1], pose dans la société primitive la problématique du pouvoir et de l’État, souvent ignorée par l’anthropologie structuraliste de Levi Strauss (son directeur de thèse) avec laquelle Clastres avait rompu.
Filiations et lectures multiples
Dans un petit livre paru en 2024, Pierre Clastres : les sociétés contre l’État, Claire Pagès, professeure de philosophie à l’Université de Nanterre, réinterprète cette œuvre, déjà abondamment commentée du vivant de Clastres et qui a fait l’objet d’un colloque international à l’Unesco en 2009, au prisme de différents auteurs nouvellement convoqués[2].
Car Clastres (1934-1977) n’est pas une étoile filante, mais un élément d’une constellation. L’ethnologue avait fondé avec Miguel Abensour, Cornélius Castoriadis, Marcel Gauchet, Claude Lefort et Maurice Luciani la revue Libre, mêlant politique, anthropologie et philosophie pour aborder les questions de la domination dix ans après 1968 et donner à réfléchir à la liberté. Sans pourtant réévaluer à l’époque les acquis de la tradition libérale, ce que fera la revue Le Débat (1980-2020) pour ouvrir à d’autres questionnements plus tard sous l’impulsion de Marcel Gauchet, la réflexion sur la démocratie restera un des axes majeurs de la revue Libre. Les années 1970 sont contemporaines dans cette mouvance de la publication d’un livre majeur outre-Atlantique, La Théorie de la justice de John Rawls, articulant liberté individuelle et solidarité sociale dans un contexte où les États-Unis sont traversés en profondeur par divers mouvements sociaux. Dans l’après-guerre, il y avait déjà eu une critique de la vulgate marxiste face aux aveuglements d’une certaine intelligentsia dogmatique, afin de repenser l’autonomie du politique devant la question du totalitarisme tout autant fasciste que communiste[3]. Pour nombre de ces philosophes de l’après-guerre, la question du totalitarisme, destructeur de tout espace politique et décrypté comme forme avancée du mensonge social, devenait un véritable enjeu. En 1965, Raymond Aron publie Démocratie et totalitarisme pour repenser dix ans après Hanna Arendt ces articulations de manière critique. En rupture avec les Temps Modernes de Sartre, mais héritière des acquis de Socialisme et Barbarie (1949-1965) et d’Esprit puis de la revue belge Texture (1968-1975) notamment après le retentissement en France en 1973 de l’Archipel du Goulag, la revue Libre (1977-1980) veut refonder sur ces décombres une nouvelle philosophie politique. Dans cet esprit, Clastres s’efforce de repenser la démocratie comme un refus de la domination. C’est ainsi qu’il interprète les sociétés des Indiens Guayakis puis Yanomanis[4]. Que nous apprenaient donc finalement ces indiens ? Clastres analyse la genèse du politique à partir de la chefferie indienne, en montrant que ce n’est qu’une option parmi d’autres et que ce type de chef, quand il existe, agrège des attributs bien différents de ce que nous connaissons en Occident. Comment, dans ces sociétés des forêts amazoniennes sans chefs ou à chefs sans pouvoirs, peuvent co-exister différentes formes primitives d’organisation sociale refusant à la fois la domination et l’indivision[5] ?
Usages de l’État
L’ouvrage de synthèse proposé par Claire Pagès décline cinq chapitres autour de la pensée de Pierre Clastres et de ses contemporains. Il réinvestit toute une série de questionnements utiles pour comprendre rétrospectivement la démarche de l’anthropologue à vouloir repenser la société primitive comme une société sans État. Mais le malentendu ne viendrait-il pas de l’usage même de cette notion d’État au détriment de celle de politique ? Comme l’écrivait justement à l’époque l’historien Paul Veyne : « Cela ne veut pas dire du tout que notre tort est de croire à l’État, alors qu’il existerait que des États : notre tort est de croire à l’État ou aux Etats, au lieu d’étudier les pratiques qui projettent des objectivations que nous prenons pour l’État ou pour des variétés de l’État »[6]. Clastres semble très réticent envers la conception foucaldienne d’un pouvoir fluide et omniprésent qui est définie à la même époque dans Surveiller et Punir, mais le modèle de l’État reste son observatoire de choix pour analyser les différentes modalités des relations de pouvoir. Ce choix permet de faire contraster les sociétés indiennes, au risque – perçu mais pas toujours évité par l’ethnologue – de les décrire par ce qu’elles ne sont pas. Oui, elles n’ont pas d’État ; mais elles n’ignorent pas pour autant le politique, et parfois cela échappe à Clastres.
L’approche anthropologique peut devenir discutable lorsque l’idéalisation de ces sociétés contribue à renforcer les mythes du bon sauvage. Doit-on réduire la question du pouvoir au seul refus de l’autorité ? Et, comme le souligne Claire Pagès, le modèle occidental serait-il d’ailleurs le seul représentant d’un État perçu comme coercitif ?
Qu’entend-t-on, du reste, par pouvoir politique ? Claire Pagès reprend ici les débats avec le philosophe Claude Lefort pour les éclairer à partir de l’exemple soviétique, pointant l’excroissance d’une bureaucratie d’État autour de la singularité de l’État-Parti dans le contexte totalitaire de l’URSS stalinienne. L’État totalitaire y est alors décrit comme un modèle de monstre froid et inédit dans la socialisation/soumission de ses citoyens. Ce cas donnera lieu à quelques écrits de Clastres lui permettant de nourrir ses thèses[7], en se demandant dans quelle mesure des sociétés à la fois anciennes, traditionnelles, et de tailles restreintes peuvent nous donner à réfléchir sur d’autres rapports de domination existants dans la société communiste.
En dehors de son terrain amazonien, Clastres se ressource à la pensée de La Boétie autour de la servitude volontaire (1576), pour attester comment une société est induite à obéir sans se soustraire vraiment au pouvoir du souverain ou sinon voir comment les individus peuvent consentir de participer à leur propre domination[8]. De fait, son anthropologie politique n’est pas seulement le bilan théorique d’un travail de ce terrain (Brésil, Paraguay, Venezuela), mais la mise en avant d’une problématique centrale axée sur l’absence d’État qu’il lit comme un « refus du pouvoir » dans ces sociétés archaïques.
Les questions du pouvoir
L’interprétation de Claire Pagès revient sur la manière dont notre culture occidentale a repensé le problème du pouvoir en termes de relations hiérarchisées. Pierre Clastres a contribué à la déconstruire avec son analyse de la chefferie indienne. La parole du chef n’y est pas une parole de commandement et ce dernier doit manifester en permanence l’innocence de sa fonction. Le pouvoir y est pensé contre le groupe puisqu’il constitue un risque essentiel pour la société indienne[9]. Mais les micro-sociétés amérindiennes apparaissent à leur échelle comme très conservatrices, puisque tout changement implique des incidences sur leurs structures exogames et leurs fondements mêmes. Le pouvoir se doit d’être désamorcé pour parer à tout risque. Et Clastres, comme le commente Claire Pagès, initie finalement une pensée politique du social contre l’État.
La qualité de cet ouvrage tient dans cette capacité à réactualiser la pensée de Clastres mais aussi d’en montrer les limites, tout en reprenant différents maillons de cette pensée afin de mettre en perspective notamment le caractère protéiforme de l’État. Les sociétés indiennes qu’il a étudiées resteraient en-deçà du politique, à la différence de nos sociétés où au contraire on a assisté à une institution du politique. Mais cette institution prend bien des formes que Clastres, fixé sur les formes étatiques issues de la modernité, tend à ignorer de la même façon qu’il minore la dimension du politique dans sa saisie des sociétés sans État. L’historienne Nicole Loraux, citée dans cette réflexion d’ensemble, note à cet égard que « Clastres s’est construit une Grèce sur mesure, projetant la disposition hiérarchique de l’espace politique… » alors qu’en Grèce antique, le citoyen n’était ni un sujet, ni un dominé dans la rotation des tâches attribuées pour devoir faire fonctionner la Cité-Etat[10].
L’ouvrage de Claire Pagès soulève donc toute une série de questions. Existe-t-il d’autres modalités possibles du pouvoir à la lumière de l’expérience indienne ? Comment un projet social collectif arrive-t-il à se maintenir en évitant toute verticalité du pouvoir ?
En éclairant certaines filiations à la pensée de Clastres, Claire Pagès propose des continuités dialogiques entre différents auteurs. Pour éclairer les questions de pouvoir, elle se réfère à la sociologie de Norbert Elias dans ses écrits sur la société de cour et la formation d’un État qui s’inscrirait dans des perspectives évolutionnistes aux antipodes de ces sociétés dites sans histoire. La domination politique ne procède pas pour ces auteurs d’une division économique alors qu’Elias décrit les fonctions plutôt régaliennes de l’Etat : assurer la sécurité et l’ordre public, promulguer une justice et émettre la monnaie. Des fonctions souvent étrangères aux sociétés de chasse et de cueillette vivant en autarcie et qui, vivant dans une forme d’abondance comme le pointe à l’époque Marshall Sahlins[11], n’ont pas besoin de gérer les biens et les affaires sociales qui leur sont liées.
Claire Pagès s’efforce de comprendre aussi l’héritage de la pensée de Clastres, bien qu’elle ne soit pas toujours revendiquée en dehors de quelques écrits d’universitaires anglo-saxons d’inspiration anarchiste comme David Graeber ou James C. Scott. Elle en voit des applications concrètes et met en avant l’actualité des mouvements sociaux ou écologiques dans nos sociétés occidentales assignant l’État à ses obligations face au réchauffement climatique ou au respect de ses traités. On pourrait tout autant se demander si les relations de pouvoir hiérarchisées au sein de grandes entreprises ou organisations sociales peuvent faire écho aux problématiques du pouvoir initiées par Clastres. À ce titre, sa relecture pourrait aussi renvoyer à toute une autre partie du courant sociologique de Michel Crozier à Alain Touraine, jamais évoqués ici, qui dès les années 1960 s’efforçaient de repenser le pouvoir des organisations non plus en termes d’affrontements pour analyser et comprendre de manière stimulante et à partir d’enquêtes de terrains, les différents facteurs d’une cohésion sociale possible.
La leçon des Indiens?
Au travers de ces descriptions des sociétés indiennes, Pierre Clastres nous livrait indirectement une réflexion sur sa propre société, et ce trait s’est accusé avec le temps. Claire Pagès redécouvre Pierre Clastres comme un penseur iconoclaste au travers d’une relecture et d’un détour par la pensée sauvage qui semble toujours d’actualité, bien que son héritage puisse apparaître comme contrasté. Comme si cette pensée sauvage ne devenait pas si irrationnelle devant le chaos du monde aujourd’hui. Finalement la grande leçon des Indiens ne serait-elle pas de croire que le réalisme de leur politique réside dans leur imaginaire ?
Claire Pagès, Pierre Clastres : les sociétés contre l’État, Paris, Éditions Amsterdam, 2024, 155 pages.
Did you enjoy this article? close




[1] Pierre Clastres La Société contre l’État, Paris, Éditions de Minuit, 1975
[2] Voir notamment Miguel Abensour (dir), L’Esprit des lois sauvages : Pierre Clastres ou une nouvelle anthropologie politique, Paris, Seuil, 1987, où figure le texte posthume de Claude Lefort, « L’œuvre de Clastres », pp. 183-208. Voir aussi Marcel Gauchet, « Politique et société : la leçon des Sauvages », Textures, 75/10-11 et 75/12-13
[3] La revue Libre paraît à partir de 1977 sous la direction de Marcel Gauchet aux éditions Payot et donnera lieu à la publication de plusieurs articles de Pierre Clastres dans six numéros.
[4] Voir Pierre Clastres, Chronique des Indiens Guayakis, Paris, Plon, coll. « Terre humaine », 1972, traduit en anglais sous le titre Chronicle of the Guayaki Indians en 1981 par le jeune Paul Auster.
[5] Philippe Descola, « La chefferie amérindienne dans l’anthropologie politique », Revue française de science politique, n°38-5, p 818-827.
[6] Paul Veyne, « Foucault révolutionne l’histoire » in Comment on écrit l’histoire, Paris, Seuil, 1978, p. 220. Voir aussi, à propos de Surveiller et Punir, Gilles Deleuze, « Ecrivain non, un nouveau cartographe », Critique, 31/343-1975, pp. 1207-1227.
[7] Voir Pierre Clastres, Entretien avec l’Anti-mythes, Paris, Sens &Tonka, 2012, « Martchenko », Textures, 75/10-11 mais aussi sa critique virulente du marxisme dans Recherches d’anthropologie politique, Paris, Seuil, 1980 en écho aux thèses de Claude Lefort qui de la critique de la bureaucratie soviétique développa ensuite sa réflexion sur le totalitarisme dans Essais sur le politique, Paris, Seuil, 1986.
[8] Étienne de La Boétie, Discours de la servitude volontaire, Paris, Payot, 1976. Voir à cet égard, l’État en question dans François Châtelet et Evelyne Pisier-Kouchner, Les Conceptions politiques du XXe siècle, Paris, PUF, 198, notamment « La servitude volontaire repensée » et « la société contre l’Etat », pp. 982-989 et 1002-1113.
[9] Kristian Feigelson, « Le gai savoir de Pierre Clastres », L’Homme et la société, n°65/66-1982, p 107-119.
[10] Nicole Loraux, La Grèce hors d’elle, Paris, Klincksieck, 2021, pp. 421-424.
[11] Marshall Sahlins, Âge de pierre, âge d’abondance, Paris, Gallimard, 1976.


