L’euro ou la bataille des idées. À propos du livre de Brunnermeier, James et Landau edit
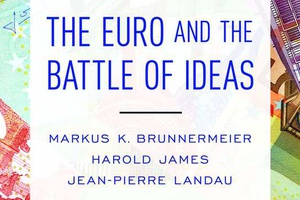
Et si la raison principale de la crise européenne était à chercher non dans l’institution incomplète de l’Eurozone ou l’élargissement précipité de l’Union à l’Europe centrale et orientale, non dans la gestion de crise ou les dysfonctionnements de la Troika, non dans le déficit démocratique ou la médiocrité des dirigeants européens post-Maastricht, mais dans une querelle idéologique franco-allemande qui plonge ses racines dans l’héritage politico-institutionnel de la Deuxième Guerre mondiale ? C’est la thèse que défendent trois économistes, Markus Brunnermeier, Harold James et Jean-Pierre Landau, dans un ouvrage dense et bien informé, The Euro and the Battle of Ideas. Leur idée est simple : c’est la méfiance permanente entre les deux puissances centrales de l’Europe fondée sur une incompréhension philosophique qui explique qu’il soit si difficile de s’accorder sur le diagnostic des crises, si long de parvenir à la formulation de solutions réparatrices et presque impossible de s’entendre sur des solutions de long terme. C’est ce conflit qui explique la place de la négociation permanente entre ces deux partenaires plus égaux que les autres, la difficulté de parvenir à des compromis et presque toujours leur caractère tardif, sous-optimal et source d’inefficacité économique. Les réponses à la crise, on le sait, ont été tardives et inadaptées. Elles ont souvent aggravé le mal avant de commencer à y porter remède. Les incompréhensions mutuelles ont été des source permanentes d’erreurs d’analyse sur les intentions et les objectifs poursuivis. Elles ont abouti à des compromis bancals forgés à la hâte pour préserver le système, repoussant chaque fois à plus tard le traitement de fond.
Un exemple permet de comprendre l’effet de ce conflit de visions. Lorsque la crise grecque éclate fin 2009 et qu’on découvre l’ampleur des déficits, des dettes masquées et du délabrement de l’État grec, le réflexe français est d’intervenir rapidement malgré la « no bail out clause » pour éviter la contagion et pour manifester une nécessaire solidarité européenne. L’attitude allemande à l’inverse est de refuser la remise en cause des normes d’intervention, de prévenir l’aléa moral pour que la Grèce ne puisse récidiver dans le futur, et surtout de prendre son temps pour élaborer la solution requise avec les bons partenaires (FMI ou pas). Lorsque la crise s’installe dans la durée et que le risque bancaire apparaît, un compromis est établi, fondé sur des concours financiers apportés à la Grèce… mais à des taux d’intérêt punitifs. La raison en est double : prévenir l’aléa moral en Grèce, et montrer aux citoyens allemands qu’on ne badine pas avec la culture de la stabilité. Ce compromis tardif et absurde pour un pays affaibli ne tiendra que quelques mois et les taux punitifs seront rapidement abandonnés.
L’idéologie importe donc !
À la base, pour nos auteurs, le conflit est donc philosophique : les Français ont été les meilleurs élèves de Keynes, ils ont tendance à penser que l’équilibre de marché est sous-optimal et qu’il faut la main visible de l’État pour remettre l’économie sur le sentier de la croissance. Comme de plus le pays est centralisé, le Parlement faible, et les groupes d’intérêts patronaux et syndicaux tournés vers l’affrontement, ses élites croient aux vertus des politiques discrétionnaires, à l’intervention micro-économique de l’État et à son rôle d’architecte et de garant de la solidarité.
Àl’inverse, les Allemands ont trouvé dans la philosophie ordo-libérale tout ce qui pouvait les guérir des délires autoritaires et dirigistes du IIIe Reich, tout ce qui pouvait protéger les libertés individuelles et notamment la liberté d’entreprendre dans un cadre légal protégeant contre les positions dominantes, les interférences de l’État et le micro-management réglementaire. Cette philosophie de l’action économique était confortée par les institutions établies après guerre : fédéralisme, démocratie représentative (rôle central du Bundestag dans les politiques publiques) contre-pouvoirs économiques (autorité de la concurrence) et politiques (Cour de Karlsruhe), indépendance de la Banque Centrale, et puissance des partenaires sociaux.
Dans leur ouvrage, nos auteurs procèdent en trois temps : d’abord analyser les quatre éléments théoriques de ce fossé idéologique rhénan, ensuite tester leur modèle sur les quatre grandes crises qui ont agité la zone euro depuis la faillite grecque de 2009, enfin montrer en quoi les dysfonctionnements du couple ont eu un impact sur l’ensemble des acteurs : FMI, BCE ….
Le premier principe clivant renvoie à l’adhésion très forte en Allemagne aux règles qui organisent la responsabilité des parties au sein d’un ensemble fédéral comme la Bundesrepublik ou quasi-fédéral comme l’Europe, par opposition au pouvoir discrétionnaire du politique dont use et abuse un pouvoir central non limité. La défense de l’empire de la règle est pour les Allemands une impérieuse nécessité justifiée par plusieurs raisons : la fédération étant par définition fondée sur un partage des compétences et donc des responsabilités entre Centre et États membres, seules des règles bien formulées et scrupuleusement mises en œuvre peuvent responsabiliser les décideurs. La règle, de plus, a cette vertu d’éclairer le long terme, d’éviter les improvisations et les mesures ad hoc : c’est en soi une technique de prévention des crises. La tentation est grande d’oublier la règle dès que le contexte change, que des groupes d’intérêt se mobilisent ou qu’une crise survient. Mais l’expérience historique (celle du fédéralisme américain) comme le respect du compromis politique fondateur (Traité de Maastricht) exigent aux yeux des Allemands le respect des normes quoi qu’il en coûte. En cas de crise aigüe il faut alors en passer par un défaut organisé, une restructuration de la dette voire une sortie de l’Eurozone. Pour les Français, à l’inverse, aucune règle, aucune constitution économique, ne peut prévoir et régler à l’avance la solution à apporter à une crise inédite. C’est la grandeur et la justification du politique de relativiser la règle, de tenir compte de contextes changeants, de ne pas perdre de vue l’œuvre commune et de déployer à chaque instant une stratégie adaptée. Les règles fournissent des cadres, elles ne sauraient réduire les politiques publiques à une technique, elles ne rendent pas obsolète la politique. En pratique le règne des choix discrétionnaires en politique évite la camisole de force des règles en situation de crise, crédibilise l’engagement de non-défaut et décourage les attaques spéculatives.
La deuxième grande divergence franco-allemande porte sur la prévention et le traitement des crises. Pour les Allemands le principe de responsabilité est premier, la « no bail out clause » est centrale, on ne peut venir en aide à un pays dont la situation est le résultat de l’accumulation de mauvaises décisions, dont les déficits et les dettes fabriquées à jet continu ont abouti à une situation d’insolvabilité. Privilégier la solidarité sur la responsabilité c’est perpétuer l’aléa de moralité et mettre en péril à terme la fédération. Pour les Français, à l’inverse, l’exigence de solidarité est au cœur du principe communautaire. Dans une fédération, même partielle, une certaine forme de fédéralisme fiscal doit être organisée et à tout le moins un fonds anti-crise.
Le troisième clivage porte sur l’appréciation même des crises financières, crises de liquidité avec les risques de contagion qu’ils emportent ou crises de solvabilité. En situation de crise, les Allemands diagnostiquent d’abord des problèmes de solvabilité dus à une gestion macroéconomique imprudente, source d’une envolée de la dette. C’est à corriger ces déséquilibres initiaux qu’il faut d’abord s’atteler, selon eux, là ou la vision française considère qu’il n’y a pas de problèmes d’insolvabilité permanents mais des équilibres multiples ; une action déterminée d’injection de liquidités peut faire reculer la situation d’insolvabilité. Pour les Français, les risques de contagion, d’amplification des crises, les boucles dettes publiques-dettes privées avec au bout le risque de crise systémique exigent le traitement des crises par des solutions de bail out (sauvetage sur fonds publics extérieurs), des interventions de la banque centrale et des fonds communautaires, là où les Allemands en viennent à privilégier des solutions de bail in (sauvetage interne par recapitalisation et effacement de dettes).
Enfin le dernier clivage franco-allemand porte sur la sortie de crise : faut-il privilégier les politiques de relance keynésienne, de soutien de la demande pour que la croissance retrouvée fasse baisser mécaniquement le poids de la dette, ou ne faut-il pas d’abord et avant tout assainir la situation financière du pays en crise par des politiques d’austérité et la soutenabilité de long terme de son modèle économique et social par des réformes structurelles ?
Les crises intervenues depuis 2009 dans l’Eurozone donnent à voir et à comprendre comment ces divergences idéologiques profondes ont structuré la réponse européenne.
La première crise grecque, déjà évoquée, s’est éternisée car elle a été le théâtre d’un affrontement sur la nature de la crise (de liquidité ou de solvabilité), sur l’appel ou non au FMI pour traiter un problème interne à l’Eurozone, sur l’aléa moral, l’exigence de solidarité et le risque de contagion. Le compromis bancal trouvé sera rapidement remis en cause et avec l’accord de Deauville les thèses allemandes font une double percée : non seulement le renflouement de la Grèce passe par des dispositifs assurantiels, mais avec l’adoption du Private Sector Initiative (PSI) un premier pas vers le bail in est fait, ouvrant ainsi la voie à la crise bancaire.
La contagion tant redoutée au secteur bancaire et la révélation des fragilités d’une union monétaire sans union bancaire et sans mécanisme significatif de solidarité va mener la BCE, à l’été 2012, à se dévouer et son président à prononcer la formule attendue par les marchés (« whatever it takes »…) pour garantir la pérennité de l’euro. Si les paroles prononcées par Mario Draghi ont eu un tel écho, c’est à la fois parce qu’il se hissait pour la première fois à sa responsabilité de prêteur en dernier ressort, mais aussi parce que la chancelière allemande avait laissé dire qu’il agissait avec son consentement. Les blocages institutionnels tant dans le cadre national que communautaire pouvaient être effacés par l’intervention déterminée de la banque centrale.
Avec la crise de Chypre un nouveau pas est franchi vers l’adoption de solutions de bail in et la prise de distance des États dans le sauvetage de leurs systèmes bancaires, alors même que l’union bancaire reste incomplète, que le fonds de résolution est sous-financé et que le fonds de garantie des dépôts tarde à voir le jour.
Le retour de la crise grecque, à l’été 2015, fait resurgir tous les différends franco-allemands : restructuration de la dette et solvabilisation à terme, austérité mortifère contre relance de l’investissement, sortie provisoire de l’euro contre détricotage de l’union, risque de défection du FMI et exigences maintenues de réformes structurelles, objectifs irréalistes d’excédents budgétaires primaires contre déblocage de nouvelles tranches de crédit. Le compromis trouvé pour prévenir la panne ne règle rien et prépare les crises à venir, mais il évite toutefois le Grexit.
Au terme de ce double parcours théorique et pratique nos auteurs s’interrogent. Pourquoi les Européens qui, en données agrégées, font aussi bien si ce n’est mieux que les Américains en termes de déficit et de dettes, sont-ils en crise permanente ?
Pourquoi les Allemands et les Français ont-ils tant de mal à s’entendre alors que les différends sont relativement récents si l’on s’inscrit dans une perspective historique ?
Pourquoi les peuples européens privilégient-ils le repli national alors qu’aucune solution durable aux problèmes identifiés ne peut venir des nations prises individuellement ?
Que la performance globale soit meilleure que la somme des déséquilibres individuels est une évidence ; c’est une autre manière de dire que l’Europe est incomplète, que la zone euro n’est pas optimale et que la gestion de crise a aggravé les choses.
Le repli des peuples sur la nation s’explique par la fable de la « win-win globalization », l’absence de réelle capacité budgétaire européenne ou le caractère problématique de l’hégémonie allemande : on ne peut pas durablement convaincre les peuples européens qu’une ouverture économique et une intégration régionale qui génèrent davantage d’inégalités et d’instabilité et qui renvoient l’adaptation au niveau national, en l’absence de mécanismes européens réels de solidarité et de redistribution, soient une source de progrès. Le fait que les peuples du Sud aient gagné à la convergence pré- et post-intégration à la zone euro et qu’ils n’aient pas fait les réformes nécessaires n’excuse pas le caractère intransigeant et pour partie inopérant des politiques actuelles.
S’agissant des racines historiques du conflit idéologique franco-allemand, les auteurs développent leur thèse : ce ne sont pas des traits culturels ou historiquement ancrés mais le résultat d’une expérience historique remontant à la Deuxième Guerre mondiale qui expliquent les différends tenus aujourd’hui pour acquis. Avant la guerre, les Allemands étaient étatistes et les Français libéraux. Ce sont les leçons tirées de la guerre qui ont conduit à cette inversion des positions.
Ce livre est d’une grande richesse et l’évocation sommaire de quelques thèses et résultats ne rend pas justice à un travail qui porte aussi sur les bouleversements des systèmes financiers européens et l’inadéquation des outils de régulation, sur les transformations à l’épreuve de la crise d’institutions comme le FMI ou la BCE et même sur la micro-politique franco-allemande puisque nous participons aux échanges de Merkel et Sarkozy sur les plages de Deauville.
La frustration n’en est que plus grande lorsque les auteurs nous annoncent qu’ils ne vont pas ajouter leurs voix au concert des réformateurs des institutions et des politiques européennes, ou lorsqu’on croit comprendre que dans leur vision l’approche allemande par la règle est justifiée pour une fédération en formation et l’approche française justifiée pour la gestion de crise. Ainsi la relance serait possible pour ceux qui ont maîtrisé leurs finances publiques, les autres devant privilégier la consolidation budgétaire et fiscale. Ainsi encore on ne saurait créer des Eurobonds ou instituer une union de transferts dans le contexte actuel… mais il faut trouver une solution pour la dette excessive accumulée, etc. Enfin les règles n’ont plus de sens quand les peuples s’insurgent et que la construction menace de rompre.
Que penser au total de l’exercice auquel se sont livrés Brunnermeier, James et Landau ?
Ils ont eu raison d’insister sur les divergences idéologiques, parce qu’elles nourrissent les représentations, déterminent les modes d’action et ont au total un effet sur les résultats économiques. Mais ce qu’ils nomment différences philosophiques s’ajoute à des différences d’intérêts et à des pratiques politiques fortement différenciées. Certes, passer des compromis entre conceptions différentes de l’action économique peut aboutir à des absurdités comme l’illustre le cas de la première crise grecque. Mais même cet épisode ne se comprend pas sans l’analyse de la politique intérieure allemande de l’époque ou des intérêts des uns et des autres en matière de protection des banques allemandes et françaises engagées en Grèce.
De même, s’il est vrai que les Allemands défendent « leur voie particulière » et les Français leur « universalisme », il est pour le moins singulier de prétendre que les Allemands étaient étatistes avant la Deuxième Guerre mondiale et les Français libéraux ! La construction lente du fédéralisme allemand, l’agglomération progressive de royaumes et de principautés autonomes, l’importance du Mittelstand des hausbank… ne sont pas des inventions récentes. À l’inverse il y a une profonde continuité entre Colbert, Clementel, De Gaulle… et Bastiat, souvent invoqué dans le livre, a moins façonné notre culture interventionniste que Napoléon ou les planistes d’avant et d’après guerre.
Le vrai problème réside autant dans la divergence des philosophies de l’action que dans l’incapacité européenne à sortir de la gestion de crise pour refonder un édifice dont l’épreuve de la crise a révélé les dramatiques insuffisances : absence de dispositif de gestion de crise, absence de prêteur en dernier ressort, absence d’une union bancaire opérationnelle, faiblesses de la gouvernance communautaire avec la bascule opérée à l’intergouvernemental.
Dès lors la vraie question est la suivante : quel type de choc faut-il imaginer pour que les Français et les Allemands commencent à se parler et à se comprendre vraiment ? Les crises économiques et financières à répétition, la crise des migrants, la montée des tensions à l’est au sud ne suffisent-ils pas ?
Certes l’Europe n’est pas le pire des mondes et n’est pas aussi mal gérée qu’on se plaît à le dire. Les positions affichées avec force par les uns et les autres ne sont pas aussi fortes qu’ils le pensent. La France ne peut s’abstraire des engagements pris au motif que c’est un pays fondateur, qu’elle assure la défense de l’Europe ou quelle détient la vérité économique. La France ne peut différer à l’infini son adaptation à la mondialisation et à l’Europe et prétendre bénéficier du parapluie allemand. L’Allemagne de son côté ne peut nier qu’elle est la grande bénéficiaire de l’Eurozone, qu’elle bénéficie des effets de spécialisation et d’agglomération au sein d’une zone monétaire et économique intégrée. Elle ne peut nier qu’elle dispose d’une base de relance de l’investissement dans une zone qui accumule un excès d’épargne et l’investit mal.
La polycrise (économique, financière, des migrants, du Brexit, du commerce international, démocratique…) doit hisser le niveau de la négociation. L’Europe est le seul mécanisme d’assurance à la hauteur de la multiplicité des crises. En situation de crise extrême, la solidarité doit primer sur la prévention de l’aléa moral (les auteurs proposent des obligations indexées sur le PIB, des « GDP bonds »)
Il en est de même pour les pays les plus endettés. La camisole de force n’est pas la solution, dès lors il faut réformer pour trouver un sentier de croissance soutenable et en même temps préparer l’avenir en investissant et donc en acceptant de décaler dans le temps le retour aux grands équilibres. Il faut retrouver le bon usage des crises.
Les solutions peuvent donc être aisément dessinées : un budget euro consistant, des engagements vérifiables de conversion à la culture de la stabilité, une forme de mutualisation de la dette. Il faut traiter spécifiquement la dette héritée et excessive, européaniser le système bancaire en combinant assurance mutuelle et strict contrôle du risque. Il faut enfin un dispositif permanent de traitement des chocs asymétriques... faute de quoi, de crise en crise, l’Europe se délitera et se décomposera.
Vous avez apprécié cet article ?
Soutenez Telos en faisant un don
(et bénéficiez d'une réduction d'impôts de 66%)


