Humains, humanismes et inhumains selon François Hartog edit
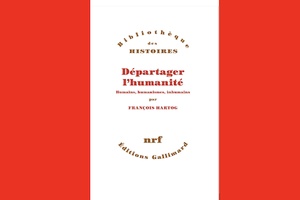
Qu’est-ce que l’homme ? Emanuel Kant disait que c’était la question essentielle de la philosophie. François Hartog ne propose pas une philosophie supplémentaire, mais, comme il l’a fait de manière magistrale avec le temps et ses « régimes d’historicité[1] », il nous offre avec son dernier ouvrage[2] une ample réflexion historique qui permet de mettre en perspective les interrogations contemporaines. Les questions sur ce qu’est l’humain – et comment le définir, en faisant le partage avec ce qu’il n’est pas – n’ont pas cessé d’être formulées, avec des réponses différentes et changeantes selon les périodes de l’histoire de la pensée occidentale. Car, disons-le d’emblée, le livre porte quasi exclusivement sur l’Occident. Cela aurait pu être encore plus passionnant si les autres civilisations avaient été envisagées. Mais, même comme cela, le parcours historique présenté est tout à fait suggestif.
Tout part, pour l’auteur, de l’anthropôs grec, qui assume sa condition de « mortel » mais trouve sa définition la plus audacieuse dans le fait d’être un « animal rationnel ». Le logos le distingue de toutes les autres créatures et, comme l’ont montré les travaux de Jean-Pierre Vernant, est au fondement de la création de la cité. Néanmoins, la pensée grecque n’est pas allée sans des interrogations sur ce que pouvait être une vie après la mort. Et elle n’a pas pu se contenter d’une survie dans la renommée (la « gloire » d’Achille) ni de sa prolifique mythologie. L’essor des « cultes à mystères » – comme celui d’Éleusis – a souligné ce manque, tout comme une part de la réflexion philosophique, comme chez Platon, avec le mythe de la transmigration des âmes. Rome n’a pas changé fondamentalement la manière de penser l’Homme, mais elle a apporté une réflexion approfondie sur ce qu’était son humanité (l’humanitas), avec la culture qui permettait de vivre pleinement une vie d’homme, mais qui posait, en même temps, des frontières et des barrières entre les hommes eux-mêmes (barbares, esclaves, femmes...).
Avec le christianisme, une véritable révolution s’est opérée, et cela de deux points de vue : avec la promesse de l’éternité pour tous les croyants, hommes et femmes ; avec la portée universelle du message (la « bonne nouvelle »), donnant ainsi une consistance forte à l’idée d’une même humanité. Une nouvelle anthropologie s’est imposée (« l’homme chrétien »), non sans s’appuyer – sans « recruter » pourrait on même dire – toute une part du savoir antique au service de la religion. Cela a maintenu, cependant, une confrontation au sein même de la pensée chrétienne entre deux types d’humanisme.
Le conflit s’est évidemment affirmé avec l’influence prise par l’humanisme proprement dit, du XIVe au XVIe siècle qui, prenant appui sur l’héritage de l’Antiquité, a défendu l’excellence de l’homme. Le face à face entre les deux humanismes, l’homme humain et l’homme chrétien, a été la grande affaire des Temps modernes. Dans les chapitres qu’il y consacre, l’auteur rappelle certes une histoire connue. Mais tout à fait intéressante, par exemple, est l’analyse croisée qu’il y présente des conceptions de trois figures majeures qui se répondent et se contredisent : Montaigne, Pascal et Voltaire. Les Lumières débouchent sur l’idée de la perfectibilité infinie de l’homme, comme on le voit particulièrement avec Condorcet. Les critiques achevées de la religion, au XIXe siècle, en arriveront à faire de l’homme sa propre création, « l’homme étant un dieu pour l’homme » (comme chez Feuerbach).
Pourtant, dès la fin du XIXe siècle, l’humanisme triomphant des Lumières est remis en cause par ces « maîtres du soupçon » qu’ont été, de manière très différente, Marx, Nietzsche et Freud, en montrant les illusions d’un sujet souverain. Le premier XXe siècle a mis en évidence – on ne peut pas plus – la part d’inhumanité qu’il y a dans l’homme, avec les deux guerres mondiales, les camps de la mort, l’arme atomique, pour ne parler que de l’essentiel. Malgré les ambitions, après 1945, de refonder un humanisme sur la dignité de l’homme avec, notamment, les grandes Déclarations universelles des Droits de l’Homme, les critiques et les mises en cause de l’universalisme occidental, de nature diverse, se sont accumulées, avec les contestations venues avec l’anticolonialisme, l’affirmation des mouvements identitaires, les préoccupations écologiques évidemment et, plus récemment, les conceptions post-humanistes ou transhumanistes, qui rendent difficile de redéfinir simplement l’homme et l’humanisme. Bruno Latour, philosophe et sociologue récemment disparu, proposait de parler désormais de « terrestres » et non d’« humains », à tel point que François Hartog, dans ses réflexions finales, suggère de remplacer la fameuse phrase de Térence, « Je suis homme, et rien de ce qui est humain ne m’est étranger », par cette affirmation : « Je suis homme, et rien de ce qui est non humain et inhumain, ne m’est étranger »… C’est dire notre incertitude aujourd’hui. D’autant plus que l’auteur souligne ce paradoxe actuel : la crise de l’humanisme coïncide avec la valorisation de l’humanitaire. Mais il s’agit d’une exigence qui s’inscrit dans le présent, et n’a pas de fondements assurés, ni dans le passé ni pour l’avenir. Peut-être alors, faut-il se contenter d’une « morale provisoire » en disant, avec Rémi Brague, un philosophe contemporain que cite l’auteur : « Notre humanisme n’est rien de plus qu’un anti-anti- humanisme[3] ».
Did you enjoy this article? close




[1] Voir, entre autres, de François Hartog, Chronos, L’Occident aux prises avec le temps, Gallimard, 2020.
[2] François Hartog, Départager l’humanité. Humains, humanismes, inhumains, Gallimard, 2024, 342 p, 22,50 €.
[3] Rémi Brague, Le Propre de l’homme. Sur une légitimité menacée, Flammarion, coll. « Champs essais », 2015.


