La technocratie macronienne, du rêve de l’administration des choses au cauchemar populiste - 1 edit
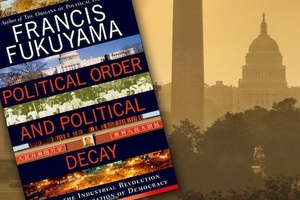
Après plus d’un mois durant lequel la France semble s’être arrêtée pour vivre au rythme des protestations des gilets jaunes, et alors que se multiplient les prises de parole dénonçant l’arrogance d’un pouvoir technocratique sourd aux cris du « peuple », il nous semble plus que jamais nécessaire de prendre un peu de champ et de sortir de nos débats franco-français qui virent trop visiblement à la fièvre hexagonale. Nous proposons donc au lecteur un court détour dans le passé et dans l’espace, qui devrait nous permettre, à l’issue de cet exercice volontaire de décentrement, de revenir sur notre actualité française du moment, munis de quelques perspectives originales, en espérant qu’elles seront susceptibles de nous éclairer de manière plus substantielle sur notre présent que le commentaire quotidien effectué le nez collé au guidon.
Dans Political Order and Political Decay[1], publié en 2014, le politologue américain Francis Fukuyama explique longuement que les fondements d’un ordre politique efficace – c’est-à-dire capable d’engendrer le développement économique –, sont au nombre de trois : la présence d’un État fort ; le respect de l’état de droit ; et enfin des gouvernants devant rendre des comptes. Alors que la quasi totalité des ordres politiques du passé (et un bon nombre de ceux du présent) sont des régimes patrimoniaux fondés sur le népotisme et l’exploitation de rentes, le miracle politique moderne résiderait dans l’émergence d’un pouvoir fort mais cependant contraint, véritable clé d’une saine gouvernance. Contrairement à une idée reçue, le clivage fondamental de notre monde ne séparerait pas les démocraties d’un côté, et les non-démocraties de l’autre, mais bien plutôt les pays corrompus (ou « néo-patrimoniaux »), et ceux où l’autorité centrale est suffisamment forte pour faire respecter l’état de droit et où les dirigeants sont sanctionnés s’ils n’œuvrent pas au profit de tous – ou au moins du plus grand nombre. Bref, l’opposition-clé serait entre les kleptocraties, en proie au clientélisme et à la corruption, et les gouvernements impersonnels, où le bien commun ne peut se confondre avec le patrimoine des dominants.
C’est bien ce clivage-là, essentiel, qui expliquerait in fine la présence ou l’absence de développement économique, et non pas la seule démocratisation, dès lors qu’un pouvoir issu des urnes peut fort bien s’accommoder d’une très haute dose de clientélisme et de corruption. C’est ce que montrent jusqu’en Europe un pays comme la Grèce ou le Sud de l’Italie, dans la mesure où leur retard économique a une explication fondamentalement politique (et non pas naturelle, géographique, ou culturelle). L’Inde – la « plus grande démocratie du monde », comme on se plaît à l’appeler – offre une autre illustration de notre propos, avec des populations de plus en plus exaspérées devant la faillite de gouvernements trop faibles pour faire respecter le droit, et même tout bonnement incapables de fournir à leurs concitoyens certains services élémentaires. C’est ainsi que dans le Nord du pays, le clientélisme et la corruption ont abouti à ce que la moitié des instituteurs continuent à être payés alors même qu’ils n’assurent pas les cours, et ce depuis de très nombreuses années ! Selon Fukuyama, l’absence d’ordre étatique solide jouerait également un rôle fondamental dans le sous-développement d’une bonne partie de l’Afrique, alors qu’à l’inverse, la Chine aurait eu la chance historique d’avoir connu très précocement un État puissant.
Cette précocité d’une autorité centrale forte serait d’autant plus une bénédiction pour les Chinois qu’il s’avère infiniment plus facile d’assurer la transition d’une autocratie vers une démocratie que celle d’un État patrimonial vers un État moderne, impersonnel. Quelques exemples suffisent à s’en convaincre. Les Américains ont pu exporter en Irak la démocratie électorale, mais ni un pouvoir fort ni l’état de droit, comme en témoigne le chaos qui a suivi l’invasion de 2003 (une intervention que Fukuyama a approuvée, avant de devenir un critique sévère de la politique néoconservatrice de l’administration Bush). De même, si les Russes ou les Ukrainiens ont pu voter dès le début de la décennie 1990, nul ne peut nier que la corruption règne en maître dans l’ancien espace soviétique, et que cette réalité désolante empêche tout développement économique digne de ce nom. Le fait que les dirigeants de Kiev et de Moscou soient issus des urnes (qu’ils aient nom Poutine, Iouchtchenko ou Ianoukovytch) n’empêche nullement ces démocraties illibérales d’être ce que Daron Acemoglu et James A. Robinson ont appelé dans leur désormais classique Why Nations Fail ?, des « économies extractives », c’est-à-dire des contrées où une coalition d’élites en quête de rentes (rent seeking elites) utilisent le pouvoir pour empêcher une libre compétition, tant sur le plan économique que politique. Bref, pour reprendre le vocabulaire de Fukuyama, ce sont là des pays qui ont connu une forme de « repatrimonialisation », à rebours du processus historique de modernisation politique censé conduire de la « tyrannie des cousins » (profondément enracinée dans des phénomènes biologiques comme la sélection naturelle par gênes parentaux ou l’altruisme réciproque) au gouvernement impersonnel de la loi.
Ce qui nous conduit à une autre question : comprendre pourquoi tous les pays ne cheminent pas tout naturellement en direction de ce l’auteur appelle de façon métonymique la « voie danoise » – sorte de quintessence de l’équilibre parfait au cœur de toute bonne gouvernance : un État respecté et respectable, au service du droit et dont les dirigeants doivent rendre des comptes afin de s’assurer qu’ils fournissent bien les services auxquels sont en droit de prétendre des citoyens ayant confiance dans leurs institutions. Pour répondre à cette question, Fukuyama développe une autre idée forte : les pays où un État moderne a historiquement précédé la démocratie auraient aujourd’hui une bien meilleure gouvernance que ceux qui ont étendu le droit de vote avant même d’avoir édifié un État fort, pouvant s’appuyer sur une bureaucratie solide et compétence pour résister aux assauts des divers intérêts particuliers. Pour notre auteur, le séquençage aurait une importance considérable puisque l’histoire prouverait que ce sont les pays ayant connu l’émergence d’un État fort et d’une bureaucratie autonome avant de connaître une extension du suffrage qui constitueraient aujourd’hui les modèles de démocratie libérale les plus accomplis.
Pour illustrer son propos, Fukuyama s’attarde très longuement sur l’exemple de la Prusse, estimant que la bureaucratie mise en place par la dynastie des Hohenzollern à partir de la fin du XVIIe siècle a permis la sélection de bureaucrates selon le mérite et la compétence technique, fondant par là-même le modèle de l’ethos bureaucratique moderne. S’estimant menacés par les puissances rivales encerclant leurs domaines, quelques souverains prussiens sont parvenus à édifier une administration royale centralisée à partir d’une armée permanente (ce qui semblait une gageure en 1660). Deux siècles plus tard, dans l’Allemagne bismarckienne, cette bureaucratie institutionnalisée et ayant une très haute idée de sa mission est devenue le principal contrepoids au despotisme du pouvoir exécutif – bien plus qu’une responsabilité démocratique encore embryonnaire. En ce sens, la sphère bureaucratique, longtemps dominée par les militaires, va jouer un rôle décisif dans l’émergence d’une « autocratie libérale » se voulant fondée sur la notion de Rechtsstaat. Un « État légal » dont Fukuyama écrit qu’il s’est avéré être « une excellente plateforme pour le développement économique ». En d’autres termes, la guerre a favorisé l’émergence en Prusse d’une élite méritocratique et partiellement autonome, si bien que le pays a su concilier État fort et état de droit – et ce très précocement, bien avant de développer la responsabilité des gouvernants devant un corps législatif élu. L’armée prussienne aura ainsi été un puissant moteur de modernisation en devenant le creuset de cet ordre bureaucratique que Max Weber théorisera au début du XXe siècle – en ayant bien sûr en tête la discipline, la haute compétence technique et l’autonomie relative des élites administratives prussiennes puis allemandes.
La manière laudative dont Fukuyama décrit l’exemple prussien peut sembler quelque peu surprenante de la part d’un politologue vivant aux États-Unis, c’est-à-dire dans un pays où l’on se complaît à disserter sans fin sur le poids excessif du gouvernement. D’autant que la vision que l’auteur offre de l’ordre politique américain est pour le moins nuancée, pour ne pas dire dépitée. Ayant connu une démocratisation précoce, antérieure à l’émergence d’une bureaucratie digne de ce nom, les États-Unis ont été le théâtre, au XIXe siècle, d’une vie politique dominée par le clientélisme et la corruption, tant à l’échelon local qu’à l’échelon national (avec le Spoil System mis en place à la faveur de la présidence « populiste » d’Andrew Jackson). Mais après l’assassinat du président Garfield en 1881 et l’adoption du Pendelton Civil Service Reform Act, deux ans plus tard, le pays est enfin parvenu à se doter d’un solide corps d’administrateurs recrutés sur leurs compétences et dotés d’une relative autonomie. Ce que Fukuyama considère comme un progrès semble pourtant être de plus en plus remis en cause aujourd’hui, et Political Order and Political Decay dresse un tableau assez sombre du système politique américain actuel, qu’il décrit comme gangréné par divers phénomènes (étroitement liés) : la montée en puissance des intérêts particuliers aux dépens de l’intérêt général, qui débouche sur une véritable « vétocratie », synonyme d’impuissance publique, et sur une « repatrimonialisation » de la vie politique américaine.
Trois facteurs se combinent pour expliquer l’incapacité croissante des dirigeants américains à légiférer de manière satisfaisante : une méfiance instinctive à l’égard du pouvoir, enracinée au plus profond de la culture politique des citoyens ; une stricte séparation des pouvoirs (les fameux Checks and Balances) qui accroît le nombre de veto players ; et enfin une polarisation idéologique croissante qu’aggrave le système des primaires (en laissant libre cours aux activistes les plus radicaux dans chaque parti). Ces trois éléments combinés aboutissent ainsi à un blocage de plus en fréquent des institutions, accroissant un peu plus chaque jour le fossé entre la population et une élite politique (au Congrès notamment) largement discréditée.
De ce point de vue, la longueur de la procédure budgétaire et les désormais fameux Shutdowns auquel elle aboutit de plus en plus souvent, sont un bon révélateur des dérèglements politiques plus généraux qui ont cours à Washington. Les rivalités entre la Maison-Blanche et le Capitole, mais aussi entre les Démocrates et les Républicains, multiplient les points de blocage, d’autant que la situation est aggravée par l’absence d’une haute fonction publique permanente, partiellement autonome, recrutant parmi les esprits les plus brillants, et qui aurait une vision stratégique de long terme la rendant apte à inspirer une législation cohérente. En d’autres termes, les États-Unis n’ont rien qui ressemble de près ou de loin au prestigieux et influent Civil Service britannique (que détestait Margaret Thatcher et dont l’inénarrable série télévisée Yes Minister offre la satire la plus féroce) ou à notre puissante énarchie, sur laquelle pleuvent actuellement toutes les critiques.
Mais là n’est peut-être pas le plus grave. La longueur et la décentralisation de la procédure budgétaire accroissent aussi considérablement les occasions qu’ont les lobbyistes et les multiples groupes d’intérêt d’exercer leur influence. Ce qui nous conduit au second volet de la crise politique américaine : ce que Fukuyama appelle sa « repatrimonialisation ». Si le lobbying jouit aux États-Unis d’une reconnaissance et d’une légitimité qui n’ont pas d’équivalent chez nous, il n’en reste pas moins qu’entre 1971 et aujourd’hui, les firmes de lobbying sont passées de 175 à plus de 1200, pour un chiffre d’affaire total avoisinant les 3,2 milliards de dollars par an ! Leur efficacité est d’autant plus redoutable que la fragmentation du processus législatif américain multiplie les prises possibles pour les divers agents d’influence, prenant d’assaut à la moindre occasion tout élu susceptible de faire pencher la balance en leur faveur. C’est ce qui explique par exemple, selon Fukuyama, que le fameux Obamacare ait fini par faire plus de 900 pages, ou encore qu’après 2008, il n’y ait pas eu de véritable réforme bancaire, tant le lobby de Wall Street a su démontrer sa redoutable efficacité. Et l’auteur de conclure que cet activisme sans frein des lobbies a abouti à une véritable « repatrimonialisation » de l’État américain, devenu la proie d’insatiables intérêts particuliers. Ces derniers seraient ainsi les grands responsables du « déclin politique » à l’œuvre à Washington – et dont l’élection du populiste Donald Trump apparaît comme une conséquence évidente (bien que le livre de Fukuyama soit sorti avant l’élection de 2016).
À la lumière de ces diverses analyses, la situation de la France apparaît sous un jour assez nouveau, et nos débats hexagonaux sur la dérive technocratique d’Emmanuel Macron et sa supposée déconnexion de la France d’en bas raisonnent différemment. Fort de sa longue tradition étatique et de sa haute administration particulièrement puissante, notre pays semble offrir une face sensiblement différente d’une crise politique pourtant tout aussi profonde que de l’autre côté de l’Atlantique. C’est donc à la lumière de ce décalage historique et géographique que nous essaierons de l’expliciter dans le second volet de ce papier.
[1] Seul le premier tome a été traduit en français en 2012 aux Editions Saint-Simon, sous le titre Le Début de l’Histoire. Des origines de la politique à nos jours.
Did you enjoy this article? close





