Vaccin Covid 19: aux racines de l’échec français edit
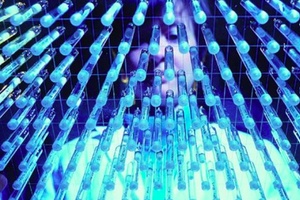
La recherche biomédicale française, tant dans le secteur académique que dans l’industrie, n’a pas été en mesure de répondre à la situation d’urgence créée par la pandémie de COVID-19. En cause, un rétrécissement de l’environnement institutionnel (sous-financement, bureaucratie, contractualisation abusive…), aux antipodes des conditions nécessaires aux percées d’une recherche de classe mondiale.
Dans la rubrique « In depth » de son numéro 372, du 24 avril 2021, la revue Science publie un article intitulé « After vaccine failures, France laments biomedical decline »[1]. On y lit notamment que parmi les membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, la France est le seul pays à n’avoir pas su produire un vaccin anti-Covid. Dans le même article, la journaliste rappelle qu’entre 2011 et 2018 les financements de la recherche en France ont chuté de 28% alors qu’ils augmentaient, au cours de la même période, de 11% en Allemagne et de 16% au Royaume-Uni. Cet échec retentissant a donné lieu à la publication d’un article dans Telos, « La deuxième mort de Louis Pasteur » (Jean-Louis Missika et Carlos Moreno, 7 janvier 2021) relatant la genèse de la recherche anti-Covid dans les grandes nations scientifiques depuis le séquençage du virus par les chercheurs chinois... et le décrochage français.
Anatomie d'un échec
Le constat est amer en effet. À la différence des États-Unis, avec les vaccins de Moderna et de Johnson & Johnson, de l’alliance États-Unis-Allemagne, avec Pfizer-BioNTech, de la Chine avec SinoVax, de l’alliance Royaume-Uni-Suède avec AstraZeneca, et même de la Russie avec Sputnik V, la recherche biomédicale française, tant dans le secteur académique que dans l’industrie, n’a pas été en mesure de répondre à la situation d’urgence créée par la pandémie de COVID-19.
On a beaucoup ironisé sur l’échec du candidat vaccin de l’Institut Pasteur, ainsi que sur le report sine die de celui de Sanofi. À l’instar des vaccins de Johnson & Johnson, AstraZeneca, et de Sputnik V, le projet de Pasteur reposait sur l’utilisation d’un vecteur viral génétiquement modifié pour exprimer la protéine « Spike », la spicule, cette clé d’entrée qui permet au virus SARS-Cov2 de se fixer sur son récepteur pour pénétrer dans ses cellules cibles. Toutefois, alors que les autres « vaccins vecteurs » reposent sur l’utilisation d’adénovirus de primates auxquels notre système immunitaire n’a jamais été exposé – suscitant alors une double réponse immune primaire, contre le vecteur et contre la protéine virale –, le vaccin Pasteur utilisait, lui, un vecteur dérivé du virus de la rougeole, certes très immunogène, mais contre lequel 95% de la population est immunisée. Or le système immunitaire, réagissant très rapidement contre ce vecteur, ne pouvait être sensibilisé efficacement contre la protéine du SARS-Cov2. De sorte que la réponse était inévitablement trop faible pour être protectrice.
Quant au candidat vaccin de Sanofi, dont le principe reposait sur l’injection d’une forme modifiée de la protéine Spike, il s’est révélé lui aussi insuffisamment efficace, du fait d’une erreur de dosage. Résultat : la quantité effective de protéine injectée aux volontaires était très nettement inférieure aux prévisions, et le système immunitaire s’est trouvé ici aussi trop faiblement activé.
Ces deux échecs – défaut de conception et défaut de dosage – n’ont en eux-mêmes rien d’exceptionnel. L’échec fait partie intégrante de la recherche, dans tous les domaines. Il serait trop facile par conséquent d’imputer aux seuls scientifiques la responsabilité de cette situation déconcertante. On sait que la prise de risque, l’attente de l’inattendu et parfois l’insuccès sont le pain quotidien du chercheur. Pour se donner les meilleures chances de réussite, il faut pouvoir multiplier les hypothèses, explorer les pistes, mener en parallèle plusieurs approches. Et sont nécessaires pour cela le sens de l’investissement, en argent comme en durée, et l’esprit de souplesse. Au delà même des explications données par l’article de Science, la responsabilité est donc à chercher aussi du côté de l’histoire politique et institutionnelle.
Une dégradation de l'environnement institutionnel
Les choix gouvernementaux faits par notre pays en matière de recherche biomédicale au cours des deux dernières décennies sont en effet marqués par trois phénomènes convergents. Tout d’abord, une diminution drastique des moyens financiers et humains alloués à la recherche, spécialement marquée dans le domaine pharmaceutique, sur fond de volonté quasi-obsessionnelle depuis 2011 de limiter la progression des dépenses publiques : le papier de Science, s’appuyant sur une étude du CAE publiée en janvier 2021, montre bien l’importance des coupes qui ont conduit à un sous-investissement chronique dans la recherche.
En second lieu, la nouvelle structuration des financements, par laquelle les dotations récurrentes aux laboratoires ont été réduites au profit des contrats personnalisés (type ANR) dont bénéficient des projets déjà largement conceptualisés, qui traduisait un contrôle accru sur l’activité des scientifiques toujours plus contraints de monter des dossiers complexes et de justifier leur existence dans un climat de forte défiance et de compétition féroce.
Enfin, la décision de recentrer la recherche biomédicale autour des structures hospitalières qui a été illustrée notamment par la création à partir de 2011 d’Instituts hospitalo-universitaires (IHU), sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Le principe semblait frappé au coin du bon sens : rapprocher la recherche biomédicale du lit du malade. Mais il aboutissait du même coup à soumettre la recherche aux impératifs opératoires du court terme et les chercheurs à la hiérarchie hospitalière.
Le déclin de la vaccinologie à l’Institut Pasteur est emblématique de cette politique. Si celui-ci s’impose toujours comme une des grandes institutions savantes européennes, c’est d’abord parce qu’il s’est tourné vers une recherche fondamentale de haut niveau, gage d’indépendance scientifique. Mais il s’est éloigné du même coup de la lutte contre les maladies infectieuses – qui était sa vocation première.
Le phénomène est illustré de manière frappante par la fermeture de l’hôpital Pasteur en 1999, sous l’impulsion de l’Agence régionale de l’hospitalisation de l’Ile-de-France. Elle avait « estimé qu’il y avait trop de lits de maladies infectieuses en région parisienne depuis la baisse de l’hospitalisation de malades du sida » (professeur Bertrand Dupont, cité dans Libération, 6 mai 1999). Cet hôpital était la trace historique d’une culture scientifique et thérapeutique orientée vers la lutte anti-infectieuse, qu’il s’agisse des maladies autochtones ou des pathologies tropicales. L’activité de veille sanitaire et de recherche était conduite notamment à travers le réseau des Instituts Pasteur d’Outre-mer (les IPOM, au Maghreb, en Afrique subsaharienne, en Extrême-Orient) dont la création accompagna en son temps le déploiement de l’empire colonial français. Cette extension hors-les-murs de l’établissement permettait la mise en œuvre d’une recherche intégrée allant de l’identification et de l’isolement des pathogènes à la prévention et au traitement des maladies infectieuses. Est-ce après l’échec des projets vaccinaux contre le Sida et contre le paludisme au tournant des années 2000 que l’Institut Pasteur s’est éloigné de la recherche vaccinale ? Quoi qu’il en soit, l’expertise est alors passée au secteur industriel, notamment chez Sanofi. Conséquence de ces mutations : la recherche académique française n’a plus eu les moyens de concevoir et encore moins de produire un vaccin nouvelle génération, surtout au rythme imposé par l’actuelle pandémie du COVID-19.
Notre pays a donc raté le grand virage des vaccins à ARN messager (ARNm). Est-il possible de l’expliquer ? Les choix de la France en matière de politique scientifique peuvent être compris comme une adhésion à ce que le philosophe des sciences Thomas S. Kuhn[2] appelle la « science normale », c’est-à-dire une science déjà validée, par opposition aux révolutions scientifiques que caractérisent des changements de paradigme. Ces révolutions ont ceci de particulier qu’elles échappent tant à la logique cumulative de la science normale qu’à son mode de fonctionnement et aux principes théoriques qui les sous-tendent. Le bouleversement paradigmatique nous arrive nécessairement du dehors, sous forme d’accidents ou d’anomalies au sein de ce que laissait attendre le paradigme établi. On ne peut ni planifier son avènement ni anticiper sa provenance. Or c’est bien à une véritable révolution et à un changement de paradigme qu’on assiste aujourd’hui dans le champ de la vaccinologie avec le développement des vaccins ARNm. Gageons qu’il n’y aura pas de retour en arrière.
La France ne manque pas de culture médicale et scientifique, ni d’esprits brillants. Mais les décisions structurelles d’ordre politique et institutionnel que nous avons soulignées, s’ajoutant à une tradition académique centralisatrice fortement élitaire ainsi qu’à une politique de financement très bureaucratisée, ont abouti à une échappée des personnalités les plus créatives vers la recherche fondamentale et à une précarisation croissante des équipes. Le tout constituant autant de freins à l’innovation, en matière vaccinale ici, favorisant une science à la fois « normale » et normative. Aux yeux du monde scientifique préoccupé, en France comme ailleurs, par l’impératif de cette recherche urgente au cours de l’année 2020, la visite du président de la République au docteur Raoult, guidée par des raisons de politique intérieure, est apparue comme symptomatique : plus qu’une diversion, une dérive. La France faisait le spectacle ; les autres travaillaient.
Révolutions scientifiques et percées innovantes
Ils travaillaient, entre autres, à cette innovation du vaccin ARNm, qui allait tout bouleverser. Le principe est simple : vous prenez une partie du génome viral et vous la mettez dans la cellule sous la forme d’un brin d’ARNm permettant aux protéines virales d’être exprimées dans des conditions proches de celles de l’infection naturelle, ce qui favorise une réponse maximale du système immunitaire. La mise en œuvre de la recette est évidemment plus complexe : elle a demandé dix ans de recherche. Mais le résultat est là, et le vaccin ARNm a toute chance de devenir le marqueur d’un profond changement de paradigme.
La genèse de ce vaccin, tant sur le plan sociologique que scientifique, est remarquable et c’est sur cette histoire que nous souhaitons revenir brièvement pour terminer. Le parcours de Katalin Kariko, biologiste hongroise fuyant le régime communiste au milieu des années 80 pour s’installer aux États-Unis, illustre bien la distance qui sépare la science normale d’un changement de paradigme. La carrière académique de Katalin Kariko est relativement modeste, davantage marquée par les difficultés matérielles que par des réussites éclatantes, si ce n’est une conviction poussée jusqu’à l’obsession concernant l’utilisation de l’ARNm pour la vaccination, et un article fondateur publié en 2005 dans la prestigieuse revue Immunity[3]. Article qui en France est passé inaperçu ou dans lequel personne n’a vraiment cru : pesanteur de la science normale au pays de Pasteur ?
Dans ce travail, réalisé en collaboration avec l’immunologiste Drew Weissman, Katalin Kariko montrait que des modifications chimiques simples de la séquence de brins d’ARNm introduits dans des cellules humaines permettaient de les masquer aux défenses immunitaires et de prévenir leur dégradation, ouvrant la voie vers une possible utilisation vaccinale. Entre 2005 et 2015, la même équipe a amélioré patiemment les méthodes de production, de purification et de conditionnement des ARNm chimiquement modifiés, sous la forme de nanoparticules lipidiques. Ces travaux réalisés loin des projecteurs académiques et médiatiques ont débouché en 2017 sur la publication d’un deuxième article dans la revue Nature démontrant que l’administration chez l’animal de nanoparticules d’ARNm permet de conférer une immunité protectrice contre le virus Zika, cause de perturbations graves du développement cérébral en cas d’infection durant la période fœtale[4]. En 2020, ces travaux ont conduit à la mise au point rapide des vaccins anti-COVID-19[5] utilisés actuellement pour endiguer la pandémie.
Lors d’un entretien télévisé au printemps 2020, Katalin Kariko répondait aux questions sur les promesses du vaccin ARNm anti-COVID-19, qu’elle serait contente si son travail pouvait se révéler utile. Et si cela méritait aussi un Nobel ?
[1] Science 372 (6540), 331-332. DOI: 10.1126/science.372.6540.331
[2] Thomas S. Kuhn, La Structure des révolutions scientifiques (1962, 1970), tr. fr., Paris, Flammarion, 1983.
[3] Kariko et al., “Suppression of RNA Recognition by Toll-like Receptors: The Impact of Nucleoside Modification and the Evolutionary Origin of RNA”, Immunity 2005, 23:165.
[4] Pardi et al., “Zika virus protection by a single low-dose nucleoside-modified mRNA vaccination”, Nature 2017, 543:248.
[5] Sahin et al., “COVID-19 vaccine BNT162b1 elicits human antibody and TH1 T cell responses”, Nature 2020, 586:594.
Did you enjoy this article? close






