Mort du PSOE? edit
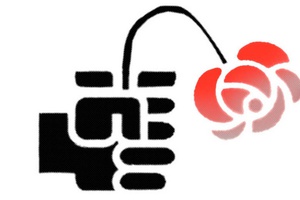
Dimanche 25 septembre, Basques et Galiciens étaient appelés à renouveler leur parlement régional. Au Pays basque, 1,7 million d’électeurs étaient convoqués, 2,2 en Galice, soit presque 4 millions (11% du corps électoral national). La participation a été de 60% au Pays basque et de 63,7% en Galice.
Depuis 1980, la participation moyenne aux onze élections régionales basques est de 65,8% avec un record de 79% en 2001 et un plus bas de 59,7% en 1994. On était donc dans une fourchette basse. Le Parti Nationaliste Basque (PNV) qui a gouverné de 1980 à 2009 et depuis 2012 a gagné avec 37,7% des voix, suivi de EH-Bildu – des indépendantistes proches de l’ETA – (21,2%), de Podemos (14,8%), des socialistes (11,9%) et du Parti Populaire (10,1%).
En Galice, la participation moyenne est de 59,7% depuis 1981 (dix scrutins régionaux). Avec un taux de 63,7% on est cette fois-ci dans une fourchette haute qui dit la capacité de mobilisation du Parti Populaire dans ce fief électoral tenu par Manuel Fraga de 1989 à 2005 et depuis 2009 par Alberto Núñez Feijoo. Le PP a obtenu 47,5% des voix, Podemos (sous l’étiquette En Marea) 19%, le Parti Socialiste de Galice 17,9% et les nationalistes galiciens (de gauche) 8,3%.
Pour comprendre pourquoi ces résultats sont catastrophiques pour les deux fédérations socialistes concernées, il convient tout simplement de mesurer leur recul électoral sur huit ans :
Voix obtenues par le PS du Pays basque (PSE) aux différents scrutins depuis 2008
National 2008 : 430 000 - 38,8%
Régional 2009 : 318 000 - 30,7%
National 2011 : 255 000 - 21,8%
Régional 2012 : 212 000 - 19,1%
National 2015 : 162 000 - 13,3%
National 2016 : 164 000 - 14,3%
Régional 2016 : 126 000 - 11,9%
Voix obtenues par le PS Galicien aux différents scrutins depuis 2008
National 2008 : 750 000 - 40,6%
Régional 2009 : 524 000 - 31%
National 2011 : 457 000 - 27,8%
Régional 2012 : 297 000 - 20,6%
National 2015 : 350 000 - 21,3%
National 2016 : 345 000 - 22,2%
Régional 2016 : 254 000 - 17,9%
Au Pays basque, les socialistes ont divisé par 3,4 leurs résultats ; en Galice par 2,9. La concurrence de Podemos n’explique pas tout. Le mouvement de gauche radicale n’est apparu que lors des scrutins municipaux de 2015. En décembre 2015, Podemos obtient 317 000 voix au Pays basque (26%) et 333 000 en juin 2016 (29%). En Galice, sous le nom de Marea, Podemos obtient 410 000 voix en décembre 2015 (25%) et 344 000 en juin 2016 (22,2%). La chute vertigineuse du PSOE s’explique par une double perte d’électeurs vers Podemos et vers l’abstention. La déroute des socialistes s’amorce avant l’apparition de Podemos, mais l’offre électorale de ce nouveau mouvement semble empêcher le redressement du PSOE.
Ces résultats confirment une géographie électorale qui fait du PSOE le grand parti du sud de l’Espagne, mais un sud qui se réduit à l’Andalousie et à l’Estrémadure. Le PSOE ne dépasse la barre des 30% qu’en Estrémadure (34,5%) et en Andalousie (31,2%). Il se maintient autour des 25% en Castille-la Manche (27,3%), dans les Asturies (24,8%), dans la Rioja (24,3%), en Castille-Léon (23,1%), en Cantabrie (23,5%) et en Galice (22,2%). Il est autour ou sous les 20% à Valence (20,8%), à Murcie (20,3%), aux Baléares (20,1%), à Madrid (19,6%), en Navarre (17,4%). En Catalogne, le PSC est tombé à 16% en juin 2016 (558 000 voix et 7 députés), alors qu’en mars 2008, les socialistes obtenaient 45,3% des voix (soit près d’1,7 million) et 25 députés.
Ces données sont indispensables pour déchiffrer la crise qui corrode le PSOE jusqu’en ses soubassements. Seul le PASOK en Grèce a connu un effondrement supérieur. Mais est-ce une consolation? N’est-ce pas plutôt une prémonition, ce que pense assurément Pablo Iglesias?
Grand parti de gouvernement, le PSOE s’est littéralement fracassé à l’épreuve des scrutins successifs de 2011, 2015 et 2016. L’enjeu stratégique était donc de savoir comment redresser la barre.
Une crise durable
En 2011, le PSOE avait défenestré José Luis Rodríguez Zapatero en l’empêchant d’être candidat à sa succession. Alfredo Pérez Rubalcaba avait accepté la difficile mission de “sauver les meubles”. Avec 28,8% des voix et 110 députés, il obtenait le plus mauvais score du PSOE depuis les premières élections libres en 1977. Tous les observateurs s’entendaient alors pour estimer qu’il s’agissait d’un plancher électoral pour les socialistes. En juillet 2014, dans une opération assez complexe où se nouèrent des alliances contradictoires pour empêcher Zapatero de pousser son candidat, le socialiste basque Eduardo Madina, les militants du parti élirent Pedro Sánchez comme secrétaire général. Sánchez était un homme de paille du clan González-Rubalcaba. Il présentait bien mais avait une expérience politique très courte de conseiller municipal de Madrid et de député de 2009 à 2011 et depuis 2013. À Madrid, ceux qui se prétendaient bien informés savaient qu’il était une sorte de leader de transition dans l’attente de l’arrivée de la présidente d’Andalousie Susana Diaz.
En janvier 2016, Pedro Sánchez a tenté de former un gouvernement et pour cela il avait signé un programme de législature avec les centristes de Ciudadanos (cf. notre article sur Telos). Podemos lui a refusé son soutien : le résultat ce furent les élections de juin et le nouveau recul socialiste.
Depuis juin, Pedro Sánchez a choisi de voter non à une investiture de Rajoy. Il a refusé la proposition de grande coalition faite par Mariano Rajoy. Puis le 31 août et le 2 septembre, les 85 députés socialistes ont voté non aux deux tours du scrutin d’investiture du candidat populaire. Et c’est là que les choses se sont gâtées pour lui. En effet, il avait sondé Podemos et les nationalistes catalans pour envisager la constitution d’un gouvernement alternatif au PP (voir le paragraphe « Deuxième hypothèse : la majorité Frankenstein » de cet article).
Le double revers électoral de dimanche 25 septembre a décidé Felipe González et les siens de lancer l’assaut contre Pedro Sánchez. Mardi 27, l’ancien président du gouvernement espagnol et leader charismatique du socialisme espagnol s’est dit « trompé » par Pedro Sánchez qui l’avait assuré que les députés socialistes d’abstiendraient lors du second tour de scrutin pour l’investiture de Rajoy. Celui-ci aurait alors été investi président et un gouvernement, sous contrôle du parlement, se mettait en place.
Convaincu que Sánchez cherchait l’accord des indépendantistes catalans, Felipe González est allé plus loin encore dans la critique et a clairement indiqué que le PSOE ne pouvait pas s’allier « avec ceux qui veulent casser l’Espagne ». Il fallait agir vite et c’est ce qui s’est passé entre mercredi 28 quand 17 membres du bureau national du PSOE ont démissionné en espérant alors que le secrétaire général s’effacerait de lui-même, et samedi 1er octobre. En effet, le bureau national n’étant plus composé que de moins de la moitié de ses membres, il perdait de ce fait sa qualité de bureau national. Sánchez a refusé cette interprétation et ce fut la journée critique de samedi. Le comité fédéral a refusé par 132 voix contre 107 la proposition que Pedro Sánchez avait faite de la convocation d’un Congrès extraordinaire en novembre et d’élections primaires samedi 23 octobre. Désavoué, il a dû prendre acte de sa défaite.
Selon toute vraisemblance – mais la politique espagnole est-elle encore vraisemblable? –, cette situation ouvre la possibilité d’un déblocage parlementaire. On peut raisonnablement penser que Rajoy va à nouveau se présenter devant les députés, sur proposition du roi Philippe VI, et que cette fois-ci le PSOE s’abstiendra (au moins une partie de ses députés) permettant la composition d’un exécutif. Ne disposant que de 137 députés sur 350, et même avec l’appoint critique des 32 députés centristes, chaque texte devra être négocié. Le prochain gouvernement, s’il sortait de cette conjoncture, serait vraiment sous le contrôle du parlement. Le PSOE s’est trop abîmé ces jours-ci pour pouvoir affronter sans risque majeur une nouvelle campagne électorale et un nouveau scrutin. L’urgence est à la reconstruction.
L’attente des réponses socialistes
Pour autant, les socialistes espagnols devront répondre à des questions majeures qu’ils ont éludées :
1º/ sur le plan économique et social, quel projet décident-ils de porter? Face au radicalisme de Podemos et face à l’obsession budgétaire à la Schäuble, existe-t-il une voie moyenne? Qu’ont à dire les socialistes sur la question majeure de la répartition de la valeur ajoutée quand ses conditions de production sont devenues négatives pour les salariés?
2º/ sur la Catalogne, les socialistes ont été inconséquents. Entre 2003 et 2010, Pasqual Maragall puis José Montilla ont présidé la Generalitat avec une majorité composée du PSC, de la Gauche Républicaine de Catalogne (ERC) et des communistes et écologistes. Les socialistes ont cautionné le début de la dérive indépendantiste. Le PSOE est cassé en deux sur cette question. Zapatero a laissé faire, González veut éviter le pire, c’est-à-dire la sécession. La présidente andalouse Susana Diaz le dit et le répète : l’unité de l’Espagne n’est pas négociable. Si rébellion il y a eu contre Pedro Sánchez, c’est qu’une nouvelle coopération politique avec les indépendantistes catalans est apparue comme la liquidation assurée du socialisme espagnol aux yeux d’une fraction du parti qui s’est révélée majoritaire.
Le PSOE n’est pas mort, mais il présente tous les symptômes d’une maladie possiblement mortelle. Il subit la crise de la social-démocratie européenne doublée d’une interrogation majeure sur le sort de l’Espagne. Loin de garantir la double résolution de ces inconnues, les soubresauts de la crise du PSOE, même s’ils ouvrent la voie à un gouvernement espagnol, disent la gravité des maux qui menacent la stabilité et la paix de la société espagnole.
Vous avez apprécié cet article ?
Soutenez Telos en faisant un don
(et bénéficiez d'une réduction d'impôts de 66%)

