Les foules numériques sont-elles les nouvelles forces du mal? edit
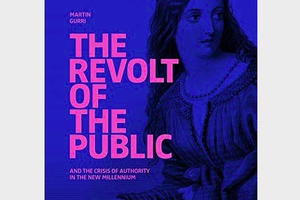
Dans un essai publié en 2014 et réédité en 2018, le politologue américain Martin Gurri examine les contours de ce qu’il nomme « la révolte du Public ». Suivant l’histoire des médias et rappelant les étapes technologiques de la circulation de l’information (l’invention de l’écriture, l’apparition de l’imprimerie, l’alphabétisation des individus et la presse, l’explosion des mass médias) il s’interroge sur les mécanismes à l’œuvre pour modeler ou réveiller l’esprit des lecteurs ou des spectateurs et revitalise la question : comment se forme et se recompose l’espace public ? Il se focalise sur le changement de paradigme né de l’Internet (The Fifth Wave, ainsi nommée par lui) : en donnant la parole à tout le monde, chacun exprimant ses intérêts et ses émotions du moment, le Digital Age anéantit l’idée d’une société organisée selon une hiérarchie des savoir et des positions – dans le gouvernement, les entreprises, les universités. Vertical, centralisé, assis sur le socle des hauts cadres et des professionnels, pratiquant des délibérations compliquées, une obsession des normes et des procédures, guidé par des stratégies et une planification, et filtré par les grands médias et les dispositifs culturels, ce mode de fonctionnement ancien est devenu illégitime, car il entre de plein fouet en conflit avec un nouvel acteur : l’amateur. L’internaute lambda exige d’être écouté et est devenu hermétique à l’information et aux messages circulant dans les médias anciens.
Le pouvoir du faible et la puissance des liens faibles
L’auteur poursuit alors son analyse. Les réseaux pratiquent un égalitarisme fanatique sans craindre d’engendrer des dysfonctionnements sociaux majeurs. Une seule personne, un seul événement, une seule alerte puissamment répercutée sont capables d’entrainer des milliers d’individus dans un mouvement d’opinion viral. Et cette foule numérique peut éventuellement agir dans l’espace physique : occupations de places, de ronds-points, etc. Ce nouvel acteur (le Public) se positionne radicalement contre le centre de la société, contre les pouvoirs organisés, campe sur un refus absolu de l’ordre établi et fonctionne selon un élan unilatéral sans accorder la moindre considération pour les autres parties prenantes du jeu social. Sa dynamique et son mode de pensée s’orientent alors aisément vers une démarche nihiliste, la violence pour la violence, aucune réponse politique ne pouvant apaiser cet embrasement –qui n’a alors d’autre voie que de s’éteindre de lui-même. Prendre le pouvoir n’est pas le projet du Public, sa stratégie est plutôt de provoquer un maximum de nuisance. Ainsi la principale ligne de clivage dans les sociétés modernes n’est pas le conflit gauche/droite, mais le conflit entre des élites organisées et un Public indiscipliné, un Public qui vise à semer le désordre sans apporter de solution et sans vouloir remplacer les dirigeants anciens. Cette montée d’adrénaline inopinée, cet ouragan dévastateur, installe ainsi une épée de Damoclès qui pèse sur les sociétés libérales – mais aussi sur les régimes autoritaires. Dit autrement, à tout moment, le pouvoir des faibles, coordonnés à travers des liens faibles, la rencontre anonyme dans la galaxie numérique, menace de déstabiliser le monde ancien – organisé, lui, selon des liens forts (système de valeurs, institutions, hiérarchies organisationnelles).
Le livre répertorie des cas d’école : les Indignés, les blogueurs dans les pays autoritaires du Moyen Orient ou en Chine. Aujourd’hui, dans ses interviews Martin Gurri cite à l’envi les Gilets Jaunes, et en effet ce mouvement a relancé le débat sur les thèses du livre. Notons que, dans les exemples cités, la composante du Public varie fortement selon les pays et les régimes – ce qui ne semble pas contrarier le raisonnement de l’auteur.
Conscient du caractère abrupt de sa proposition, Martin Gurri, bien sûr, ne va pas jusqu’à imputer entièrement la vague populiste (droite ou gauche) à ce changement de paradigme technologique, mais il l’implique fortement. Ce faisant, il ébranle nombre de travaux de recherche, qui de Ochaï Benkler (The Wealth of Networks, 2006) à Clay Shirky (Here comes everybody, 2008), ont vu dans les réseaux sociaux et la culture du partage l’humus d’un changement démocratique. Le succès de The Revolt of the Public tient dans la puissance imaginaire de la thèse avancée : la foule numérique comme un monstre sans tête. Or tout sociologue des médias sait qu’il n’existe pas Un Public –victime d’un déterminisme technologique-, mais des publics, qui s’emparent à leur façon des outils de communication, et ce dans des contextes socio-historiques particuliers.
Les publics de la Fifth Wave
L’examen de la communication publique (les blogs d’intérêt général et politique, les débats des sites d’information) et semi-publique (les réseaux sociaux comme Twitter, Linkedin et Facebook) révèle l’entrechoc, et parfois l’entremêlement, de deux cultures. Celle dominée par les affects, en substance le déploiement au grand jour des passions privées, des revendications, des amertumes et de la colère –c’est sur cet espace public que disserte Martin Gurri. Celle, dominée par la connaissance et la réflexion, qui étend à l’infini les dispositifs d’information et d’opinions autrefois exclusivités des journalistes et des intellectuels –c’est cet espace public que l’auteur minore. De ce fait, l’espace délibératif du Net est écartelé entre ces deux tropismes. De surcroît, n’oublions pas l’existence du bloc majoritaire des internautes : celui des silencieux, qui se contentent de visionner les contenus ou sont absents de la scène délibérative du numérique.
Certes, on peut s’étonner qu’autant de pulsions se livrent dans la nouvelle scène publique. À la fin du XXe siècle, le système télévisé a ouvert la boîte de Pandore : de lucarne sur le monde, elle s’est muée en un relais d’opinions faisant se succéder en plateaux, notamment dans les magazines, humeurs, peurs, espoirs, indignations de figures de la société civile. La Web culture a pris le relais des médias d’images et a amplifié ces tendances : le propos partisan, l’état d’âme, l’exaltation, l’invective, la dénonciation, le ricanement méchant, l’affirmation péremptoire, la rumeur, l’insinuation y bourgeonnent plus fréquemment que l’opinion balancée et maîtrisée – dans ce mouvement, la radicalisation des positions s’est accentuée d’un cran. Ce déferlement de subjectivités est finalement conforme à l’évolution psychologique de l’individu contemporain et la nouvelle arène publique rassemble souvent des individus hystérisés les uns envers les autres.
Pourtant, parallèlement, des communautés virtuelles entretiennent un bon niveau de débat public. Elles forment l’avant-garde de l’activité intellectuelle de l’Internet et investissent deux pôles : la blogosphère d’information générale et politique (dont une part est logée au sein des plateformes d’information) ; certains réseaux professionnels (des réseaux de chercheurs, ou par exemple Linkedin) et d’innombrables sites collaboratifs qui déclinent des problèmes publics comme l’éducation, l’écologie, la santé, les phénomènes migratoires, etc. Le Web a fait éclater les frontières entre paroles d’autorité et paroles profanes : entre les propos des journalistes reconnus et des experts déversés dans la presse écrite et la télévision, d’un côté, et paroles d’acteurs concernés ou engagés, d’amateurs éclairés ou de penseurs du dimanche, de l’autre. Des enseignants, des professionnels des médias, du marketing ou du social, des cadres économiques, et au fond bien d’autres personnes, usagers ou simplement anonymes impliqués, rejoignent cette armée qui nourrit le débat public – ils usent de formes langagières plus spontanées et plus subjectives que les militants patentés. Cet intérêt à participer se manifeste donc d’abord chez les professions intellectuelles, et plus largement chez les bac + 5 et plus, déjà dans l’ensemble plus politisés que la moyenne – mais cette sphère est socialement ouverte, notamment grâce aux actifs des associations.
Les couches diplômées du supérieur et urbaines sont encore, et de loin, les plus engagées dans la Web attitude – les premières à pratiquer les réseaux sociaux, à opérer des achats en ligne, à utiliser les messageries instantanées comme WhatsApp, à s’investir dans l’économie du partage ou à effectuer des démarches administrative en ligne, comme le montrent les dernières données du Credoc. La même inclination existe aux États-Unis où la forte consommation d’Internet, la participation à un réseau d’échanges d’informations et de commentaires comme Twitter[1] est fréquente chez les diplômés, les moins de 50 ans, les urbains, et les personnes dotées d’un bon revenu[2]. Dans le cas de Twitter, la participation est aussi corrélée avec le fait d’être « démocrate ». Depuis le début, les cadres, les professionnels de l’information et de la culture et les étudiants tirent donc la révolution numérique.
Au delà de la métaphore saisissante d’une armée sans tête et sans foi, la thèse de Martin Gurri peine à convaincre. Selon les pays, la composition de la foule numérique diffère ainsi que sa stratégie : quoi de commun entre les étudiants de la Puerta del Sol mobilisés par le chômage massif des jeunes en Espagne, les blogueurs d’Egypte qui en appellent à la démocratie, et les Gilets jaunes – petite classe moyenne des périphéries et zones rurales remontées contre le prix de l’essence et les impôts ? Dans les démocraties, face aux nouveaux croisés, « l’ancien monde » est loin d’avoir désarmé et avec constance renvoie la balle en usant de la sémantique argumentative, puisant dans le spectre des valeurs, des idéologies et des familles politiques forgés historiquement. Enfin, dans tous les cas cités, les urnes (en Espagne ou en France) et/ou la force répressive (en Iran, Tunisie, Egypte) ont redirigé, voire anéanti, l’intensité de la révolte du Public.
La thèse de Martin Gurri touche une réalité quand elle décrit l’émergence d’acteurs en colère, galvanisés par le sentiment de puissance que procurent les réseaux sociaux. Elle est franchement discutable quand il s’agit de désigner un cataclysme technologique, des forces du mal irréfragables, dont les démocraties, et les autres régimes, ne sauraient se relever.
[1] https://www.pewinternet.org/2019/04/24/sizing-up-twitter-users/
[2] https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/03/14/about-a-quarter-of-americans-report-going-online-almost-constantly/
Did you enjoy this article? close





