-
7 April 2025
Conflits de valeurs et devenir de la démocratie en Europe
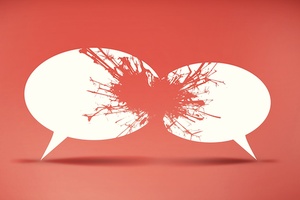
Depuis l’entrée des chars russes en Ukraine le 24 février 2022, l’opposition entre les autocraties et les démocraties représentatives ne cesse de s’envenimer et met l’Europe sous pression. Au cœur de ce clivage, il y a un conflit de valeurs. Ce conflit et son issue ne se jouent pas seulement au niveau des États et de leurs élites: leurs ressorts sont dans les populations européennes. read more
-
5 April 2025
Les relais Paris-Moscou
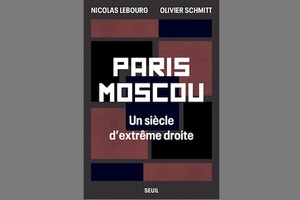
Dans un ouvrage paru en 2024, Nicolas Lebourg, chercheur au CNRS, et Olivier Schmitt, professeur à l’Université du Sud-Danemark, retracent l’histoire des liens entretenus par l’extrême droite française avec l’URSS puis la Russie aujourd’hui. En s’appuyant notamment sur certaines archives policières, ce livre revient sur un siècle de relations tumultueuses animées par de nombreux récits d’espionnages plus ou moins véridiques qui ont scandé cette histoire particulière. read more
-
1 April 2025
A-t-on le droit de parler de «menace russe»?

Les déclarations du président de la République le 5 mars invitant le pays à un sursaut de son effort de défense face à la «Russie qui est une menace pour la France et pour l’Europe» ont ouvert un débat. Peut-on le trancher et dans quel sens? Oui, en prenant en considération les trois facteurs par lesquels s’analyse une menace: les capacités, le sentiment d’hostilité et l’intention hostile. read more
-
31 March 2025
Les migrants climatiques et la flèche de Zénon

Les migrants climatiques semblent devenus une problématique centrale de notre époque. La recherche s’est structurée autour d’un débat sur leur causalité, entre ceux qui voient dans les phénomènes climatiques la cause majeure et ceux qui insistent sur le caractère multicausal. Mais en s’attardant sur la bonne détermination du phénomène, on retarde sa prise en compte par les acteurs politiques des pays industrialisés. C’est d’autant plus regrettable que, on l’a vu avec le Covid, l’incertitude sur les modèles n’empêche pas la prise de décision. read more
-
28 March 2025
Napoléon et Poutine

La garde rapprochée de Vladimir Poutine a réagi violemment à l’allocution du président de la République le 5 mars dernier, notamment à son affirmation selon laquelle la Russie est devenue une menace pour la France et pour l’Europe. Serge Lavrov, le chef de la diplomatie russe, a comparé Emmanuel Macron à Adolf Hitler et Napoléon. Une comparaison grotesque, bien sûr. En revanche, comparer Napoléon au dictateur russe à propos de leurs guerres respectives, l’un à la Russie et l’autre à l’Ukraine, est tout à fait justifié. read more
-
21 March 2025
Financement de la défense: la quadrature du cercle

Sans le soutien des États-Unis, les Européens seront en difficulté pour protéger l’Ukraine et décourager la Russie de grignoter d’autres morceaux de l’ancien empire soviétique. Au minimum, l’Europe devra accroître ses moyens militaires, et cela va coûter cher. Pour la France, la facture pourrait être de 2 ou 3% du PIB. Quelles sont les solutions envisageables pour financer cet effort? Il en existe quatre. read more
-
20 March 2025
L’émergence d’un patriotisme européen

La seconde élection de Donald Trump a porté aux commandes de la plus grande puissance militaire et économique mondiale un parti dont le nationalisme est le principe directeur. Ce nationalisme agressif suscite des effets de contagion ou plus simplement des réactions. Mais, plutôt que de réveiller les vieux nationalismes, la politique de Trump fait naître en Europe un sentiment nouveau. read more
-
18 March 2025
À propos de «l’égoïsme crasse des boomers»

Emmenée par des économistes comme Sylvain Catherine ou Maxime Sbaihi, une nouvelle doxa s’est développée, selon laquelle les boomers retraités vivraient sur le dos des jeunes actifs qui doivent financer leurs confortables retraites, d’autant plus que les premiers sont propriétaires alors que les seconds peinent à accéder à la propriété. Mais à bien des égards ce procès en iniquité intergénérationnelle paraît bancal, et surtout il ouvre sur des solutions qui manquent le coeur du problème. read more
-
14 March 2025
Guerre d’Ukraine: dans la tête de trentenaires français et allemands

Il n’a pas fallu un mois après le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche pour découvrir qu’il abandonnait l’Ukraine et soutenait les visions impérialistes de Vladimir Poutine. Plongés dans ce séisme géopolitique les Européens se trouvent face à eux-mêmes. Les gouvernements sont sommés de s’unir, d’agir, d’engager un bras de fer. Mais les opinions publiques suivront-elles? Une façon d’instruire cette question est d’interroger les différences entre sociétés. read more
-
13 March 2025
Couples et divorces dans la société de la longévité

L’hétérogénéité des modes de vie des seniors se renforce. La vie en couple, en particulier, voit des évolutions contrastées. D’un côté, avec la hausse de l’espérance de vie, ce modèle est désormais central pour les octogénaires. D’un autre côté, avec le phénomène des «divorces gris», la vie en couple a reculé pour les hommes de 65 à 75 ans depuis 1990. Il faut considérer de près ces évolutions pour envisager les politiques publiques de la société de la longévité. read more
-
12 March 2025
Les Français ont rompu avec l’Amérique de Donald Trump

Le 5 mars dernier, le Président de la République a analysé, dans son allocution, la situation actuelle créée par la guerre en Ukraine. Plusieurs sondages d’opinion réalisés au même moment nous permettent de savoir comment l’opinion publique française a réagi à la situation actuelle. De ces données il est possible de tirer trois enseignements majeurs. read more
-
6 March 2025
L’Europe et l’Ukraine sans l’Amérique?

En épousant ouvertement les thèses russes sur la guerre et en préconisant un accord avec Poutine, quels qu’en soient les coûts pour l’Ukraine et l’Europe, Trump renverse la table. Que peut et doit faire l’Europe? En réalité, nous avons deux impératifs. Le premier est d’adopter rapidement des mesures crédibles: des actes concrets, pas des intentions ou des procédures. Le second est de ne pas faire de promesses que nous ne saurions pas tenir. L’écart entre ces deux impératifs est très subtil, mais pas impossible à gérer. read more
-
5 March 2025
Le débat sur les retraites doit être fructueux

La concertation entre les partenaires sociaux est maintenant engagée. Les enjeux sont lourds, et elle ne peut se limiter au seul domaine des retraites: toute décision peut en effet avoir des conséquences bien au-delà de ce domaine. Par ailleurs, la concertation ne peut totalement ignorer le contexte de crise internationale que nous connaissons, et les choix que ce contexte nous imposerait si les menaces actuelles s’amplifiaient. read more
-
26 February 2025
Couple franco-allemand: que pouvons-nous attendre de Friedrich Merz?

En appelant à un «renouvellement et un approfondissement» des relations avec la France, Friedrich Merz entend insuffler un nouvel élan à la relation bilatérale. Si le discours et les réflexes franco-allemands sont plus ancrés chez Friedrich Merz que chez son prédécesseur, il faut néanmoins les relativiser. read more
-
25 February 2025
Dépenses militaires versus dépenses sociales?

Les appels à des efforts accrus en faveur des dépenses militaires vont-ils avoir un vigoureux impact sur les dépenses sociales? Rien n’est écrit, mais la perspective est crédible, tant les deux systèmes de protection sociale et de défense se trouvent face à des pressions monumentales. Le premier, qui suscite des inquiétudes quant à sa soutenabilité, voit se profiler des déséquilibres financiers très amplifiés tandis que demeurent des besoins insatisfaits. Le second, appelé à très significativement se renforcer, doit répondre aux menaces d’un monde transformé. Le premier pourrait être conduit à réduire la voilure afin que le second monte en puissance. read more
-
22 February 2025
L’héritage politique de Victor Hugo
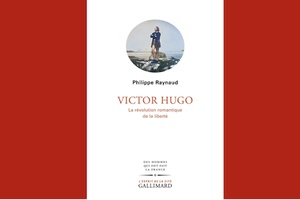
Hugo est immensément populaire mais quel sens a pour nous aujourd’hui son humanitarisme, qu’on ne peut séparer de sa foi dans le progrès? Que reste-t-il du lien qu’il avait établi entre le patriotisme, la justice internationale et une vision exaltée des États-Unis d’Europe? Un ouvrage de Philippe Raynaud interroge la part qu’il a à notre patrimoine politique commun. read more
-
19 February 2025
L’axe Trump-Poutine et la politique française

Le petit monde politique français commence à s’agiter en vue de l’élection présidentielle prochaine comme si le tremblement de terre politique de niveau 10 qui secoue le monde actuellement n’était pas ressenti dans l’Hexagone. Comme si ce qui apparaît comme un nouveau pacte germano-soviétique façon 1939, mais cette fois entre les deux empires russe et américain, n’allait pas avoir des effets majeurs sur les candidatures et les campagnes électorales. read more
-
18 February 2025
Conseil ou Cour constitutionnelle?

Les limites et les critiques qu’on peut porter sur le Conseil constitutionnel – trop proche des politiques, formé de membres incompétents – tiennent à l’histoire particulière de cette institution, qui au fil du temps est devenue une «cour». Les nominations cette année de trois politiques sont fidèles à l’esprit de la Constitution, mais elles apparaissent contradictoires avec cette évolution. read more
-
17 February 2025
Le glas du Conseil constitutionnel?

Le Conseil constitutionnel occupe une place sans commune mesure avec celle imaginée par le général de Gaulle. Les critiques qui accompagnent le renouvellement du tiers de sa composition tous les trois ans en sont la trace la plus régulière. Mais ces procès prennent une dimension particulière aujourd’hui car ils interviennent à deux ans de la prochaine élection présidentielle dans laquelle l’éventualité d’une victoire d’une candidate populiste suscite des inquiétudes. Les objections soulevées ne peuvent plus être balayées au seul motif qu’elles sont émises par des universitaires qui rêveraient d’y siéger. read more
-
15 February 2025
Calmann-Lévy et l’antitotalitarisme libéral
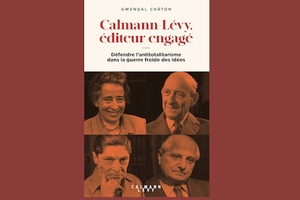
L’antitotalitarisme a une histoire plurielle et, pour cela peut-être, trop mal connue. Un livre remarquable de Gwendal Châton fait revivre un de ses lieux d’élection, les éditions Calmann-Lévy, qui accueillirent la collection « Liberté de l’esprit » dirigée par Raymond Aron. Un pan essentiel de l’histoire du libéralisme français. read more




