Le centre introuvable de Waldeck-Rousseau edit
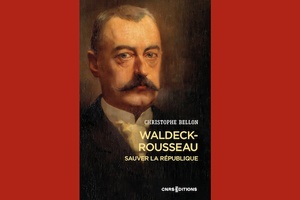
Christophe Bellon consacre une biographie magistrale à Waldeck-Rousseau[1]. L’entreprise est méritoire, car si le personnage a marqué l’histoire de la troisième république, il s’est effacé de nos mémoires. Il en est pour partie responsable : quoi de plus étrange pour nos temps d’ambitions déréglées que cet homme taciturne et austère, que Barrès peignait « figé dans son silence, comme un brochet dans sa gelée » (p 356) ! Il meurt à 57 ans sans avoir rédigé de mémoires, après une longue carrière politique où seul le devoir semble l’avoir attiré.
Il abandonne d’abord à regret sa carrière d’avocat pour se présenter à la députation à Rennes en 1879 ; ministre de l’Intérieur dans l’éphémère cabinet Gambetta (14 novembre 1881-26 janvier 1882), puis ministre de l’Intérieur et des Cultes dans le deuxième ministère Ferry (21 février 1883- 6 avril 1885 ), il se réjouit en tombant de pouvoir faire accepter une démission présentée déjà depuis plusieurs mois ; redevenu simple député, il ne monte que deux fois à la tribune entre 85 et 89, et ne se représente pas aux élections de 1889. Le boulangisme lui semble une conspiration des mécontents avec les appétits, il s’en tient donc éloigné et ne rentre en politique qu’avec son élection comme sénateur de la Loire en 1894, quand il croit possible de mener des réformes sociales grâce à une union des républicains modérés et de la droite ; il devient enfin président du Conseil et ministre de l’Intérieur et des Cultes (22 juin 1899-7 juin 1902), le plus long ministère de la troisième république.
Waldeck-Rousseau est un moderne Cincinnatus, guidé par la volonté intangible de fonder la république ; assurer un compromis laïque ; pacifier le rapport des classes.
Fonder la république
Né le 2 décembre 1846, Waldeck-Rousseau va se donner pour objectif de clore le grand magasin des rancunes qu’est le 19e siècle, en un temps où la succession des crises menace la république : le 16 mai, Boulanger, Panama, Dreyfus… Il est l’héritier du libéralisme du 19e siècle dont il reprend la recherche d’un « juste milieu ». Son père René-Valdec Rousseau[2], avocat, est à la fois — chose rare — républicain et catholique sous la monarchie de Juillet, puis député sous la Constituante en 1848 et préoccupé par les questions sociales, ce qui le rapproche d’Ozanam. C’est un démocrate libéral, qui vote Cavaignac en décembre 1848 et se retire sous l’Empire. Son fils va reprendre l’ambition d’être l’aile droite de la gauche. Il fréquente les opposants à l’empire, amis de son père, les Jules : Dufaure, Favre et Simon ; de ce monde ancien il partage les goûts littéraires : il apprécie le spiritualisme exalté du Jocelyn de Lamartine, Balzac, Guizot. Il a comme ces centristes du 19e siècle le souci d’éduquer la démocratie. Jeune avocat, il prend pour modèle rhétorique les discours de Thiers, et entre comme stagiaire dans le cabinet de Dufaure. Comme tant d’autres il sort de la religion catholique dès ses années de formation au profit d’un subjectivisme spiritualiste ; inscrit au barreau de Nantes, le jeune avocat rentre dans les conférences Saint Vincent de Paul, prie mais ne va pas à la messe, apprécie le rôle historique de l’Église mais juge indéfendables les états du pape et lit La Vie de Jésus de Renan ; il réhabilite la deuxième république dans un article d’avril 1869 intitulé « Ce qui tue les Républiques » tout en défendant contre Hugo l’idée que le salut n’est pas dans la destruction d’un pouvoir mais dans l’éducation des gouvernés.
Ce pragmatisme modéré caractérise son entrée en politique après la crise du 16 mai 1877. Ce qu’il veut, c’est une république d’ordre allant de Gambetta à Thiers, ce qui suppose à la fois une réforme parlementaire pour dégager une majorité modérée et un exécutif efficace. « Comme Guizot avant lui » (p. 509), il va mettre l’autorité au service des libertés avec autant d’habileté et de sens du compromis dans les manœuvres parlementaires que de poigne comme ministre de l’Intérieur.
Il s’investit d’abord dans la consolidation de la majorité parlementaire dans l’espoir de constituer un grand parti conservateur à l’anglaise. Il siège d’abord en 1879 dans la gauche républicaine (celle des Jules) mais va vite choisir Gambetta, plus rassembleur, qui le nomme en novembre 1881 ministre de l’Intérieur. Le jeune ministre de 34 ans s’efforce de promouvoir le scrutin de liste car il vaut mieux que l’électeur connaisse moins la personne de son député que ses principes — c’est aussi un moyen de lutter contre la corruption et contre l’émiettement à la Chambre. Le projet de modification du scrutin déposé par Gambetta le 14 janvier 1882 provoque sa chute le 26 janvier. Le scrutin de liste ne s’imposera en 1885 que brièvement : dès 1889 on reviendra au scrutin uninominal. Waldeck-Rousseau œuvre aussi au rétablissement de l’ordre. Il veut aller vite, fait arrêter Louise Michel lors des manifestations au père Lachaise autour de la mort de Blanqui. Ministre de l’Intérieur et des Cultes dans le ministère Ferry (21 février 1883, 6 avril 1885), il fait passer une grande loi sur les communes en 1884 pour donner une assise à la république dans les campagnes ; à son retour en politique comme sénateur de la Loire en 1894 il combat à nouveau pour la formation d’un grand parti tory républicain : les élections de 1898 montre l’échec de cette entreprise, la France républicaine reste un miroir brisé du fait du scrutin d’arrondissement et les républicains ne s’accordent pas.
L’affaire Dreyfus va relancer l’urgence d’un gouvernement de « Défense républicaine ; il s’y est peu intéressé d’abord. Le 1er mars 1899, il écrit encore (p. 419) : « Je n’appartiens à aucune ligue, et personne n’a voulu rester plus longtemps étranger que moi aux incidents que les partis ont su faire naître d’une affaire purement judiciaire. » Il s’inquiète surtout de la faiblesse du gouvernement. À la chute du ministère Charles Dupuy en juin, le président Émile Loubet — élu le 18 février 1899 — fait appel à Waldeck-Rousseau qui va rétablir l’ordre grâce à un ministère de combat : président du Conseil, il prend le portefeuille de l’Intérieur et des Cultes ; il nomme le général marquis de Galliffet, le « fusilleur de la commune », à la guerre, ce qui lui assure le soutien de l’armée, et le socialiste Alexandre Millerand devient ministre du Commerce, de l’Industrie et des Postes ; accueilli selon Clemenceau à l’assemblée le 26 juin par « un long hurlement de hyènes », il allie la fermeté et l’esprit de compromis. La fermeté : arrestation de Déroulède, constitution du sénat en haute cour de justice, sanctions contre les officiers antidreyfusards. Mais il montre aussi une volonté d’apaisement : il renonce à la cassation du verdict de Rennes et propose que le président de la République accorde la grâce à Dreyfus, (décret du 19 septembre) et il propose à la chambre la loi d’amnistie qu’elle adopte le 24 décembre 1900 (Dreyfus en est choqué). Galliffet peut démissionner : la paix a été rétablie, le ministère va durer jusqu’à 7 juin 1902.
Ce qui singularise Waldeck-Rousseau est le choix par trois fois du ministère de l’Intérieur. Dès 1871 le relèvement de la France est pour lui une affaire de politique intérieure. La politique étrangère ne lui importe guère. Il éprouve peu d’émotion à la perte de l’Alsace-Lorraine, est peu familier de l’idée de patrie ; il est favorable à l’armée de métier, étranger à l’idée de revanche, hostile à tous les nationalismes qu’il juge « manifestations ridicules, presque indécentes, dangereuses ». La question coloniale ne le retient pas davantage ; il n’a pas anticipé les effets de la politique coloniale de Ferry dans la chute du ministère lors de la séance à l’assemblée du 30 mars 1885 où la panique saisit les députés devant un revers militaire. C’est sa limite. Mais c’est aussi le revers de sa persévérance à chercher des transactions dans les conflits religieux et les luttes de classe.
Le compromis laïque
De son milieu familial Waldeck-Rousseau avait hérité le respect des croyances mais aussi celui de la liberté de conscience. Contre l’emprise de l’Église catholique il est donc favorable à un « anticléricalisme de nécessité », et à une séparation incluant un concordat au moins comme transition nécessaire. Par là il s’éloigne des radicaux.
Très tôt il tente un élargissement de la majorité républicaine vers la droite catholique : Léon XIII est dans cette stratégie un interlocuteur de choix, surtout quand l’encyclique De Rerum Novarum en 1891 tend à faire de la question sociale la question centrale. Il noue aussi des relations avec le Sillon de Marc Sangnier fondé en janvier 1904. Cette recherche de ce qu’en 1894 on appelle un « esprit nouveau » laisse les républicains modérés déchirés entre une union avec les radicaux (la « concentration républicaine ») et l’ouverture à droite. Ministre des Cultes en 1899, Waldeck-Rousseau là encore est un ministre à poigne, efficace. Il empêche le clergé de s’immiscer dans la politique ; il ne choisit pour évêques que des libéraux et les traite comme des préfets ; il fait emprisonner les prêtres qui critiquent le gouvernement et défend le Concordat parce que la séparation nuirait à l’efficacité du contrôle par l’État.
En même temps, il fait preuve d’esprit de compromis : le projet de loi qu’il dépose sur les congrégations le 14 novembre 1899, débattu du 21 janvier au 29 mars 1901, s’en prend aux congrégations enseignantes, bras armé de l’étranger, et qui conduisent à séparer deux jeunesses, (le discours célèbre du 28 octobre 1900 reprend cette vieille idée qu’on trouvait déjà chez Victor Cousin) ; mais il plaide pour que les congrégations autorisées entrent dans le droit commun des associations. Les chambres durcirent considérablement ce projet. En 1901 Waldeck-Rousseau parraine la création de l’Alliance républicaine démocratique, quelques mois après la fondation du parti radical ; aux élections du 27 avril et du 11 mai 1902 les radicaux l’emportent, Waldeck-Rousseau a perdu le combat des idées. Fatigué, il ne veut pas gouverner avec les radicaux et pousse Émile Combes à lui succéder ; il s’en repent vite : la loi sur les congrégations devient une loi d’exclusion que Waldeck-Rousseau combattra sans succès comme sénateur ; il meurt le 10 aout 1904, dix jours après la rupture de relations diplomatiques avec le Vatican.
Pacifier les luttes de classes
La question sociale était sans doute ce qui tenait le plus à cœur à Waldeck-Rousseau et le champ dans lequel il a obtenu des résultats durables. Il en partageait le souci avec Gambetta et réussit à faire voter la réduction du temps de travail (loi Nadaud) et la loi Target sur la libre constitution des syndicats (juin 1881). Avec Ferry la tâche était plus malaisée ; Ferry se préoccupait d’éducation plus que de social. Waldeck-Rousseau se montre là encore un démocrate libéral dans la tradition du 19e siècle : il rejette le socialisme, route de la servitude, quoiqu’ à vrai dire le risque lui en paraisse faible ; il veut promouvoir l’émancipation et pas l’assistanat, s’inscrire dans la déclaration des droits de 1789 qui n’attaque pas la propriété et maintenir l’équilibre entre les intérêts du capital et ceux des ouvriers, mais il cherche aussi à acculturer les républicains à la question sociale avec habileté en choisissant les rapporteurs les plus aguerris. Il obtient un consensus républicain sur la protection de l’enfance, sur la suppression de l’obligation du livret ouvrier, sur l’exercice du droit de grève élargi par la loi Waldeck-Rousseau du 21 mars 1884. Il prend une loi sur la durée de la journée de travail le 30 mars 1900. Il aurait voulu faire davantage, il ne disposait pas d’une majorité.
Surtout il plaide inlassablement au sénat d’abord puis au ministère pour l’arbitrage des conflits : la question mutualiste et l’arbitrage lui semblent un champ privilégié pour rapprocher les républicains et la droite sociale — ce qui lui vaut d’être taxé d’angélisme par la presse et les patrons mais apprécié par les ouvriers du bassin de Saint-Étienne, ses électeurs, qui l’appellent en arbitrage lors des grandes grèves du tournant du siècle. Signe de la mémoire ouvrière de l’action de ce ministre qui disait pourtant n’être pas peuple et se voulait libéral : Waldeck Rochet né en 1905, successeur de Maurice Thorez comme secrétaire général du Parti communiste française, porte son nom.
La lecture de cette biographie laisse une impression mélancolique : Waldeck-Rousseau assure la survie de la République au milieu des orages ; il a des disciples (André Tardieu, Paul Reynaud, Alexandre Millerand, Joseph Caillaux, Aristide Briand), mais il échoue à fonder un parti puissant du « juste milieu » et à consolider une majorité stable ; il attire l’estime pour sa rare vertu mais pas la reconnaissance nationale. La République du centre, dont François Furet, Pierre Rosanvallon et Jacques Julliard annonçaient en 1988 l’arrivée tardive dans la culture politique française, était encore un siècle plus tôt une république introuvable.
Did you enjoy this article? close




[1] Waldeck Rousseau, Sauver la République, CNRS éditions, 2025. J’emprunte ici l’expression de centre introuvable au livre d’Aurelian Craiutu, Le centre introuvable, la pensée politique des doctrinaires sous la Restauration, Plon, 2006.
[2] Il intégrera son deuxième prénom à son nom de famille tout en en changeant l’orthographe.


