L’affaire Renault ou l’Etat raider edit
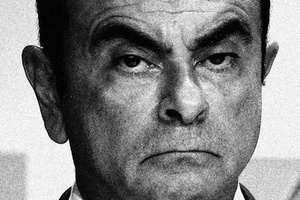
On connaissait l’État développeur soucieux de créer les conditions d’émergence d’entreprises innovantes, on connaissait l’État régulateur veillant à assurer une juste concurrence au profit du consommateur, on ne connaissait pas jusqu’ici l’État raider capable, comme un spéculateur, d’user de la loi pour perpétrer un coup de force et s’arroger des avantages indus violant ainsi, sinon la lettre, du moins l’esprit de la Loi. C’est pourtant ce que vient de faire l’État actionnaire en montant provisoirement dans le capital de Renault pour sécuriser l’application automatique des droits de vote doubles prévus par la loi Florange, avant dans un deuxième temps de céder un volume supérieur d’actions tout en conservant la même influence en droits de vote à moindre coût. Ce raid est choquant au moins à trois titres.
L’État détourne l’esprit de la loi Florange censée renforcer les droits de l’investisseur de long terme au détriment de ceux des actionnaires de court terme qui font des aller retour rapides avec leurs titres.
L’État use d’un procédé retors pour renforcer sa main dans Renault au mépris du Conseil d’administration (CA) et des accords de long terme passés avec Nissan.
L’État tente ainsi d’affaiblir un patron qu’il a nommé et qui joue un rôle décisif dans l’Alliance, pour des motifs qui n’ont rien à voir avec la stratégie, la gestion ou la performance du groupe.
Essayons de comprendre la logique du coup de force avant que l’épisode ne finisse en pantalonnade ou en crise ouverte.
Au départ, il y a la volonté du législateur de privilégier les investisseurs patients de long terme au détriment des spéculateurs court-termistes, en leur accordant automatiquement des droits de vote doubles après deux ans de détention des titres. Cette disposition qui limite objectivement le droit de propriété de l’actionnaire et rompt le principe « une action égale une voix », se justifie par un impératif supérieur : donner à l’entreprise le temps de mettre en œuvre une stratégie sans être soumise au diktat des hedge funds ou des investisseurs activistes. Si donc l’État Français avait souhaité renforcer son engagement de long terme dans Renault et était prêt à investir dans ce sens avec l’accord des autres partenaires de l’Alliance en montant dans le capital et en maximisant les droits de vote, tout le monde aurait salué le geste de l’État actionnaire. Du reste la volonté de Bolloré, la même semaine, d’agir en investisseur de long terme dans Vivendi s’est illustrée par sa montée dans le capital qui lui a permis de maintenir l’application de la Loi Florange. Dans ce cas, Bolloré a agi, non pour un bénéfice immédiat, comme l’État Français, mais pour se donner le temps de définir la stratégie de Vivendi après sa sortie des télécoms, alors qu’il se propose d’investir dans les média et que les investisseurs activistes de court terme le pressent de distribuer l’argent qui est dans la caisse.
La montée inopinée dans le capital de Renault a un tout autre objectif et une toute autre portée. L’État entend d’abord monter pour quelques semaines dans le capital le temps d’assurer le rejet d’une résolution du Conseil d’administration de Renault renonçant au bénéfice de la Loi Florange. Ainsi l’État ayant défait le CA où il est minoritaire et ayant sécurisé des droits de vote doubles pour le même investissement pourrait par la suite réduire rapidement sa participation dans Renault tout en préservant son influence. Loin de conforter son engagement financier à long terme, l’État entend en fait baisser son investissement chez Renault comme dans d’autres entreprises publiques, constituant ainsi au passage « une cagnotte » dont l’usage serait trouvé à l’approche des élections.
Cette grossière manœuvre, comme il fallait s’y attendre, a suscité la riposte immédiate du CA qui a décidé de maintenir la résolution anti-votes doubles ; elle a aussi ouvert une période de crise avec Nissan, détenteur de 15% du capital mais qui avait renoncé jusqu’ici à exercer ses droits de vote. Or, entre le moment où Renault était venu au secours de Nissan et aujourd’hui, le rapport de forces interne à l’Alliance s’est inversé : c’est Nissan qui aujourd’hui fait la croissance, les résultats et l’expansion de l’Alliance et c’est Renault notamment en France qui poursuit son déclin et fragilise l’Alliance par ses contre-performances.
D’où la question : pourquoi l’État français, qui jouit d’une position privilégiée dans l’actionnariat de l’Alliance, prend-il le risque d’une guerre ouverte avec Carlos Ghosn, bâtisseur de l’Alliance, et les partenaires japonais, alors qu’il n’a objectivement guère d’atouts ?
Trois réponses sont envisageables.
La première est qu’il s’agit d’une opération de pieds nickelés de Bercy qui a rapidement buté sur la détermination de l’entreprise, de son management et de sa gouvernance. Le blitzkrieg en chambre devait réussir sans soulever l’attention des principaux acteurs. L’État aurait voulu ainsi sur la forme infliger une leçon à Ghosn sans que cela porte à conséquences puisque l’État, une fois le forfait commis, non seulement revendait les actions récemment acquises mais en cédait aussi des anciennes pour se faire de la trésorerie. Cette tentative a fait long feu.
La deuxième est que l’État actionnaire s’est saisi d’une opportunité pour affirmer la prééminence de la propriété par rapport au pouvoir. La prétention de M. Ghosn à cumuler des salaires stratosphériques chez Renault et chez Nissan malgré la volonté contraire de l’État Français était insupportable pour les gouvernants socialistes et l’occasion a fait le larron. Si telle était la motivation on reste interdit devant le risque industriel pris pour un symbole élimé et alors que tant d’autres problèmes attendent d’être traités par un gouvernement qui assiste impuissant à l’effondrement industriel du pays.
Reste la dernière explication : le mandat de Ghosn arrivant à son terme, et l’actionnaire dominant n’étant pas satisfait d’une stratégie qui a mené à l’effondrement de la production des sites français de Renault, le gouvernement aurait tenté d’établir un nouveau rapport de forces pour préparer les échéances à venir. Si tel était le cas on ne comprendrait pas les satisfecit donnés à Ghosn récemment en échange de l’engagement d’un meilleur plan de charge pour les usines françaises et encore moins l’usage de l’arme des votes doubles.
La manœuvre ayant été éventée et la stratégie financière court-termiste de l’État confirmée, il ne reste plus à l’État actionnaire qu’à limiter les dégâts et à assurer les partenaires japonais et Carlos Ghosn qu’il ne récidivera pas et que l’entreprise continuera à s’autogérer.
On peut seulement regretter au passage que le gouvernement, auteur de la Loi Florange, l’ait discréditée par un usage opportuniste et qu’une occasion de s’interroger sur les raisons de la crise automobile française ait été manquée.
Une fois dissipées les miasmes de cette affaire, trois problèmes resteront à l’agenda politique. D’une part l’État ne sait toujours pas exercer son métier d’actionnaire, la création de l’APE n’a pas écarté les tentations d’intervention des cabinets. D’autre part l’État ne sait que faire des participations publiques : est-ce un héritage, est-ce un vecteur de défense du capitalisme autochtone, faut-il les réduire, les redéployer, les accroître ? Enfin, quelle stratégie l’Etat entend-il promouvoir : réindustrialiser, défendre l’emploi, promouvoir l’attractivité du territoire national ?
Vous avez apprécié cet article ?
Soutenez Telos en faisant un don.
(et bénéficiez d'une réduction d'impôts de 66%)

